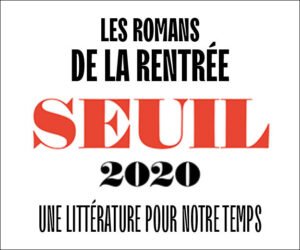État-nation et définition ethno-religieuse de la citoyenneté
L’actualité internationale ne cesse de nous rappeler l’acuité, dans un monde contemporain supposé voué à la sécularisation, de la définition ethno-religieuse de la citoyenneté. Aux antipodes du sionisme originel, Israël identifie désormais celle-ci au judaïsme. En mal de sondages d’opinion favorables, le président de la République de Turquie rend à l’islam Sainte-Sophie. Le Liban étouffe sous le poids d’un confessionnalisme politique apparemment indépassable. Les guerres civiles de Syrie, d’Irak et du Yémen semblent largement s’être rabattues sur l’opposition entre sunnites et chiites (ou alaouites). Héritages de feu l’Empire ottoman dont tous ces territoires étaient peu ou prou des provinces ?
Oui, en partie, mais l’hypothèse doit être élargie. Car en Inde Narendra Modi poursuit une politique d’exclusion de la nation de son importante minorité musulmane. La Birmanie et le Sri Lanka empruntent eux aussi cette voie. En Europe, en Amérique du Nord, la place de l’islam dans la cité est également questionnée de manière de plus en plus polémique, tout comme dans la Russie de Vladimir Poutine. Parlera-t-on alors d’une « islamophobie » généralisée ? Sans doute, mais pas seulement : la plupart des pays dits musulmans ne sont pas en reste en matière de définition ethno-religieuse de la citoyenneté, au détriment des chrétiens, des juifs, voire des autres obédiences islamiques que celle à laquelle s’identifie l’État, comme en Turquie, en Iran ou au Pakistan.
De toute évidence le problème déborde le cadre de chacune des principales religions, ou des États qui y semblent associés. Dans leur dénominateur commun, ces configurations politiques doivent donc être comprises à la lumière tamisée d’une sociologie historique et comparée de la formation de l’État, plutôt que mises sous le projecteur aveuglant de l’explication culturaliste et de son « illusion identitaire ».
Deux idéaltypes
On peut opposer, sur un mode idéal-typique, la domination impériale et la domination stat