Réforme de la justice : de nombreuses questions, mais un débat impossible
Le statut du ministère public français, le « parquet », mais aussi l’ensemble des équilibres institutionnels, internes et externes, de la justice se retrouvent donc une fois encore sous les feux de l’actualité.
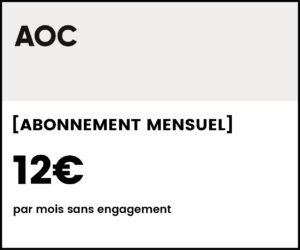
Une opinion de plus sur ces questions ne serait d’aucun intérêt. Ce n’est donc pas une tribune qu’on va lire mais un bref inventaire de quelques-unes des difficultés qu’elles soulèvent et que les contraintes du traitement médiatique conduisent souvent à négliger. Le présent texte se veut donc une invitation à débattre d’autant qu’il n’y a pas à ces questions institutionnelles complexes de réponse toute faite, de remède unique qui seul nous assurerait du progrès vers une justice meilleure. Bref, prenons le temps de réfléchir avant d’asséner une réponse.
L’histoire de ce débat est ancienne. Elle prend source à des moments marquants de l’histoire de la justice depuis deux siècles. Des strates multiples parmi lesquelles on citera l’échec de l’expérience de justice révolutionnaire, un XIXe siècle marqué par une magistrature aux ordres, toute entière nommée par le pouvoir politique et épurée par chaque nouveau régime, le choix de la Troisième République pour sortir de l’ornière du recrutement sur concours des magistrats, une paupérisation de l’institution assumée sur un siècle par les gouvernements des Troisième, Quatrième et Cinquième République, le souvenir traumatique d’une soumission quasi unanime de ce corps au régime de Vichy, et après 1968, en sens inverse, la crainte parfois fébrile des politiques quant à l’avènement d’un gouvernement des juges « rouges ».
La magistrature française est aujourd’hui encore parfois renvoyée à ces épisodes qui seraient la marque de vices inhérents à la structure du « corps ». Depuis toujours, son principal partenaire, le barreau, s’en méfie et elle le lui rend bien. La judiciarisation de la vie politique depuis un demi-siècle ne facilite pas ses relations avec les pouvoirs exécutifs et législatifs. Quant à ses relations aux mé
