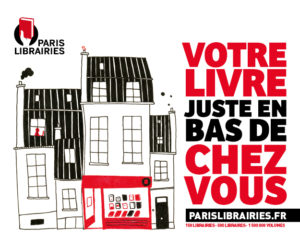L’imagination, notre Commune (2/2)
Donner le ton c’est, en musique, faire entendre la note – résultat d’un tonos, c’est-à-dire d’une tension spécifique sur la corde de l’instrument – qui va, par la suite, engager toute la tonalité d’une œuvre. L’expression convient très bien à Kant, non seulement parce qu’après lui la philosophie tout entière a bien changé de ton et de tonalité, mais encore parce que sa pensée même fut une pensée du commencement ou du recommencement.
Le ton de l’histoire sera donc « temps du commencement », comme le développe Françoise Proust en insistant – ce qu’Ernst Bloch, en particulier, avait déjà fait – sur la notion cruciale de possibilité : « […] ce qui commence, c’est le pur pouvoir de commencer qui s’expérimente à même son exercice, qui s’éprouve comme pouvoir [je dirai plutôt, après Deleuze : comme puissance], comme le pouvoir (Vermögen), comme l’expérience d’un possible (möglich), comme l’expérience de la liberté. » La force de commencer est la puissance d’oser – « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! » –, la puissance de penser, de résister à tout ce qui nous prive de liberté.
Françoise Proust évoque donc ce commencement à travers l’idée du « ton de l’histoire » en tant que possibilité ouverte au temps d’être toujours « maintenant », soit de se dresser comme présent maintenu, donc résistant. En ce sens, il apparaît comme un temps soulevé : « Pur signe de l’arrivée du temps, [le commencement] fracture le temps en son milieu, non pas pour en faire un nouveau lieu, mais pour, à chaque fois, en chaque lieu, ouvrir la possibilité de l’arrivée du temps. […] Passé, présent ou à venir, [il] est toujours maintenant. C’est, c’était, ce sera maintenant. C’est (c’était, ce sera) le temps ou jamais, c’est le temps de venir, d’arriver et de commencer. » Voilà qui semble, de façon frappante, correspondre au temps énoncé par Rosa Luxemburg : « J’étais, je suis, je serai… »
S’il y a un « sublime historique » aux yeux de Kant, celui-ci se résume