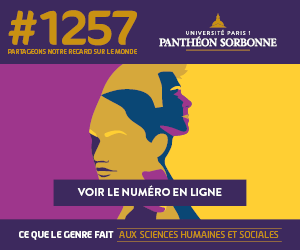Migration et pacte européen : à qui profite le statu quo ?
Avant le Conseil européen réuni les 10 et 11 décembre 2020 sous présidence allemande, le Président français avait déclaré vouloir mettre à l’agenda le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, et envoyé une note d’une dizaine de pages à ses homologues. Déjà lors d’un déplacement le 5 novembre au col du Perthus, il avait annoncé le doublement des effectifs chargés de surveiller des frontières françaises, cinq ans après que la France a rétabli les contrôles, selon une disposition de l’accord de Schengen de 1990. Le Président avait réitéré son ambition de « remettre à plat » cet accord comme il l’avait fait en mai 2019, avec une certaine nostalgie du club plus restreint qui en avait dessiné les contours trente ans plus tôt.
Si les conclusions du Conseil n’ont pas retenu l’idée d’une refonte de Schengen, elles font indirectement allusion à l’auteur de l’attentat de Nice venu de Tunisie en notant « qu’il importait de veiller à ce que toutes les personnes franchissant les frontières extérieures de l’UE fassent l’objet de vérifications dans les bases de données pertinentes » et de renforcer le mandat d’Europol. Le développement de bases de données et surtout leur « interopérabilité » est une priorité des institutions de l’UE déjà dotée d’une agence peu connue du grand public, l’EU LISA, chargée entre autres d’en gérer les systèmes informatiques intégrés (SIS, VIS, Eurodac).
Le Conseil a néanmoins discuté du contrôle aux frontières extérieures mais en insistant sur les pays d’origine et de transit au Sud de la Méditerranée dans une section assez longue qui insiste sur l’importance de la coopération pour « relever le défi de la mobilité et des migrations ». Mais surtout, les dirigeants veulent que l’UE soutienne « les garde-côtes libyens au moyen de formations et d’un suivi ainsi que par la fourniture d’équipements et de navires, conformément au droit international ».
En réalité, empêcher les personnes de quitter la Libye, avec l’aide de l’agence euro