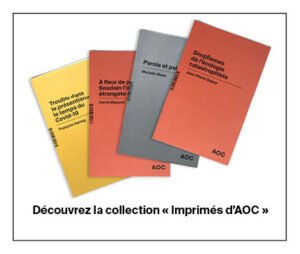Macron et la crise sanitaire : Léviathan mieux que Jupiter
Chacun a pu aisément observer que la crise due à l’épidémie de Covid-19 a mis à rude épreuve les principes de la démocratie libérale. En France, en particulier, le législateur a institué un nouveau régime d’état d’urgence, dérogatoire au droit commun, donnant aux autorités de l’État la compétence d’édicter, compte tenu des données scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour combattre une menace sanitaire inédite. Deux piliers essentiels de la démocratie libérale ont alors été mis en cause : la liberté d’aller et venir, qui a été considérablement entravée par les diverses mesures de confinement total ou partiel adoptées depuis le début de la crise, et le principe délibératif, qui structure, en temps ordinaire, le processus décisionnel de tous les régimes parlementaires.
Tous les aspects de la gestion de cette crise sont en effet pris en charge par le seul pouvoir exécutif, dès lors que l’état d’urgence sanitaire issu de la loi du 23 mars 2020 permet au gouvernement, au nom de la lutte contre l’épidémie, de restreindre nos libertés par ordonnances et contribue ainsi au renforcement du tropisme monarchique de la Ve République, qu’avait déjà repéré autrefois certains constitutionnalistes [1] . La banalisation du recours au Conseil de défense est une des illustrations les plus visibles, à la faveur de cette crise, d’une dérive présidentialiste du régime déjà sensiblement alimentée par la conception dite « jupitérienne » des institutions que cultive dans sa pratique du pouvoir l’actuel locataire du palais de l’Élysée depuis son entrée en fonction en 2017.
Une telle verticalité du pouvoir, à laquelle renvoie l’usage courant de la figure de Jupiter pour qualifier le style présidentiel d’Emmanuel Macron, semble donc rencontrer dans la crise sanitaire un contexte particulier qui lui donne une singulière vigueur. Mais ce contexte, qui voit la préoccupation sécuritaire du pouvoir nourrie par des impératifs de santé publique et la peur de la mort que susci