Grenelle de l’éducation – le clap de fin de Jean-Michel Blanquer ? (1/2)
Par son ambition affichée, le « Grenelle de l’éducation », lancé le 22 octobre 2020 par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, a mis à l’ordre du jour une question restée en suspens parmi ses mesures de « réforme » de l’École. Il est en effet précisé que son Grenelle « engage une évolution profonde du système éducatif et des métiers des personnels de l’Éducation nationale ». Une façon de dire que l’Ecole ne peut pas être transformée en profondeur sans que ne soient revues la définition et l’organisation des métiers de tous les personnels. Non seulement les cadres considérés désormais comme des « managers », mais aussi les enseignants et tous les autres.
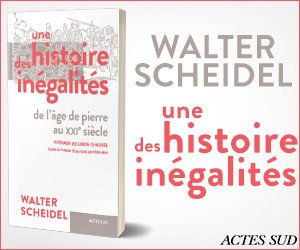
S’en tenant aux thèmes évoqués dans la communication ministérielle (la revalorisation financière des enseignants débutants, le développement du numérique pour assurer la « continuité pédagogique » par temps de Covid), les commentateurs ne semblent pas avoir pris la mesure de ce que le ministre entendait conduire avec ce Grenelle. Dans l’agenda initial, il était prévu qu’il tire les conclusions de la « consultation » le 3 février 2021. Comme ce rendez-vous a été reporté à une date non fixée, on peut en déduire que l’affaire est plus délicate et plus stratégique qu’il y paraît à première vue et que les intentions du ministre sont bel et bien d’engager « une évolution profonde » et non pas une simple « réflexion » comme l’indique par erreur le Conseil scientifique de l’Éducation nationale (CSEN).
C’est ce que confirme aussi l’annonce, largement passée inaperçue, figurant sur le site du ministère dans le calendrier du Grenelle, selon laquelle le processus doit déboucher au Parlement dès cette année, à la rentrée. Faut-il y voir l’intention d’une sortie en fanfare ou d’un chant du cygne pour Jean-Michel Blanquer juste avant l’élection présidentielle de 2022 ? Y a-t-il dans les tiroirs du ministère une nouvelle loi de refonte « profonde » des métiers de l’enseignem
