La fin des militants ? Leçons du laboratoire chilien
Le 15 et 16 mai 2021, le Chili a fait l’expérience de deux journées électorales exceptionnelles quant à leur déroulement et résultats. En deux jours et en pleine pandémie, ce pays de l’extrême-sud du globe a organisé quatre scrutins simultanés : les élections de l’Assemblée constituante (155 membres pour rédiger une nouvelle Constitution), les élections régionales (16 gouverneurs), les élections municipales et les élections des conseillers municipaux (345 maires et 2 252 conseillers) : au total, plus de 16 000 candidats.
Pour parvenir à la tenue de cette élection, le Chili a dû traverser une énorme mobilisation sociale aux mois d’octobre et novembre 2019, dont l’ampleur a ébranlé aussi bien l’ossature constitutionnelle héritée de la dictature du général Pinochet (1973-1990) que le modèle économique chilien qui, jusqu’alors, était loué par ses chantres comme une forme organisée et rationnelle de sortie du sous-développement.
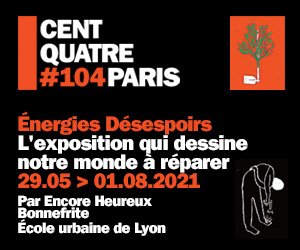
La pression sociale (« la rue ») a été telle que le gouvernement du président de droite Sebastian Piñera fut forcé d’annoncer le début d’un processus constituant, qui a été parachevé le 15 novembre 2019 par un accord politique très étendu entre les principaux partis politiques du Congrès (à l’exception du Parti communiste et de quelques petites formations d’une nouvelle gauche récemment parvenue à la représentation).
Un an après, le 25 octobre 2020, les Chiliens étaient appelés à participer à un référendum afin de se prononcer pour ou contre le remplacement de la Constitution « néolibérale » de 1980 : au terme d’un scrutin qui a vu la participation de 50,9 % des électeurs, les Chiliens ont largement rejeté la continuité de la Constitution (78,27 % contre 21,73 % des voix). Ce résultat ouvrait ainsi la voie à une élection d’une Assemblée constituante, dont les membres (les convencionales) sont mandatés pour rédiger une nouvelle charte fondamentale – élection qui a dû être reportée du mois d’avril au mois de mai à cause du confinement dû
