Le care et la constitution du public de la démocratie
J’ai cru un moment en 2020 que le care pouvait devenir une valeur publique partagée. Depuis la pandémie, une vague mauvaise conscience collective se fait jour ; les clients saluent et remercient les caissières à qui autrefois ils n’accordaient pas un regard, en réglant leurs achats tout en s’adressant via leur téléphone portable à une personne à distance, clairement bien plus importante. Les politiques vantent le travail des « soignants », médecins et infirmières, à qui depuis des années ils refusent avec mépris la moindre augmentation de moyens, plaçant l’hôpital public dans une situation de dénuement, telle que les premières semaines de la crise ses personnels n’avaient aucun moyen de protection contre l’épidémie comme le retraçait récemment la saison 2 de la belle série Hippocrate qui, dès sa saison 1, avait dénoncé le dénuement de l’hôpital public.
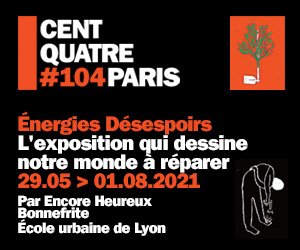
Cette prise de conscience, c’est celle du care, du rôle des femmes et autres « petites mains » dans la vie quotidienne, souvent revenue aux murs de la vie domestique. On a pu constater que c’est le travail du care qui assure la continuité de la vie, en retissant le fil du quotidien bouleversé par les confinements successifs.
Le souci d’autrui est devenu une valeur de l’expression publique. « Quoi qu’il en coûte » : on soignera tout le monde (au moins chez nous les occidentaux privilégiés). On soutiendra l’économie, les entreprises. Au grotesque ton martial du début de la pandémie (« nous sommes en guerre ») a succédé un souci du bien-être général et les remerciements trop faciles à celles et ceux qui portent la société. Ce discours moral public explicite est-il une prise de conscience ? Ou n’est-il pas une forme de moralisation par laquelle les autorités se placent encore en position de juger les comportements et de porter les valeurs ?
Grammaire du care
« Il faut défendre la société. » Mais celles et ceux qui la défendent, la portent, sont des invisibles qu’on tient pour la face immergée de la société, les
