Cités à la déroute
Onze ans après les violences et actes incendiaires perpétrés au sein d’une cité dite « sensible » de Grenoble, France Télévision diffusait le 19 avril dernier, au 20 heures, un court reportage titré « Retour dans le quartier de La Villeneuve à Grenoble ».
L’actualité est celle d’une détérioration progressive et, en apparence, irrémédiable des conditions de vie : disparition quasi-complète des commerces entraînant ipso facto une désertion des espaces communs, à commencer par la Grand’Place et ses allées, ainsi que ses « aires », parcs et jardins. L’intensification du trafic de stupéfiants, notamment à proximité des crèches du quartier, oblige d’y poster, aux différentes entrées, policiers et agents de sécurité à temps plein.
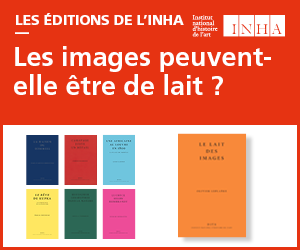
Après visionnage d’un tel document, le téléspectateur ne pouvait que conclure à l’échec, à tous niveaux, des grands ensembles, plus couramment appelés les « cités de banlieues » : des zones toujours pathogènes où sévit « la sarcellite [1] », « gangrénée » par la criminalité ; le creuset de la délinquance endémique d’une jeunesse oisive massée aux pieds des blocs de béton qu’un urbanisme, regardé comme fautif ou à tout le moins inconséquent, se serait suffi d’aligner au pourtour des villes.
Évidemment, là n’était pas le projet des architectes-urbanistes de l’Atelier d’urbanisme et d’architecture (AUA) – regroupés autour de Jacques Allégret – naguère chargés de la conception de La Villeneuve entre 1970 et 1983. En effet, ces derniers avaient pour ambition, pour dessein, de réaliser une Cité Nouvelle à très haute valeur sociale d’inspiration largement fouriériste, renouant alors avec certains des idéaux utopistes du XVIIIe siècle. Le phalanstère, concept élaboré par le philosophe Charles Fourier, a vu son incarnation la plus célèbre dans le familistère de Guise, érigé entre 1859 et 1884 par la volonté de l’industriel Jean-Baptiste André Gaudin pour ses ouvriers.
Pleinement « communautaire » (de vie comme de gouvernance), l’ensemble urbain
