Pour une sociologie du mépris de classe
Dans la réplique brutale d’un responsable politique pris au dépourvu devant la question gênante d’un journaliste, dans l’exigence hautaine d’un client mécontent d’un grand hôtel parisien ou dans le dédain d’un chirurgien de renom devant l’un de ses personnels soignants… le mépris de classe peut se rencontrer ou se surprendre sur des scènes sociales en apparence très variées.
Pour le sociologue, se proposer d’en rendre compte, de l’analyser ou de le penser suppose sans doute d’abord de se faire ethnographe, observateur attentif des interactions, et plus particulièrement de celles qui mettent en présence – directement ou indirectement – des acteurs sociaux issus de milieux ou de positions décalées voire opposées.
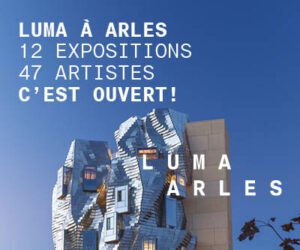
Mais on ne saurait se contenter de ce seul « relevé d’observations » ou de la seule thématisation d’une opposition entre des élites et des catégories défavorisées. Le sociologue n’est pas un moraliste et s’il s’agit de comprendre et d’expliquer les faits sociaux « comme des choses », il faut tout à la fois mettre au jour les mécaniques qui expliquent sa survenue et rendre compte des effets qu’il produit.
Commentant ou désignant ouvertement la sortie inattendue d’une personnalité publique, l’expression est, depuis quelque temps déjà, convoquée par certains discours politiques, ou certains débats médiatiques. Le mépris de classe y fonctionne un peu comme un anathème : le discours de celui à qui on l’applique est disqualifié sur un terrain souvent plus moral que politique : celui qui, par ses formules déplacées est ainsi visé par l’opprobre, s’est rendu coupable d’un manquement au devoir de respect dû à chacun, ou plus largement de trahison d’un certain idéal démocratique où tous étant égaux, nul ne devrait être méprisé.
Dans ce cadre, l’expression désigne en effet souvent des paroles ou des gestes traduisant une abusive dénégation de la réalité et de la valeur sociale de ceux qui sont méprisés. Elle permet donc pour l’essentiel de stigmatiser celui qu
