En finir avec les récits de la ville malade
Avec la crise sanitaire, la question de la santé revient sur la scène de l’urbanisme. Alors que des citadins épuisés par des mois de confinement déménagent en périphérie des métropoles, les élus des grandes villes multiplient les initiatives écologiques, sans doute pour les retenir. Des promoteurs, des bailleurs sociaux et des architectes réfléchissent à d’autres modes d’habitat.
On doit s’interroger sur l’éternel recommencement, voire le bégaiement, des discours proposant chaque fois de répondre à une « crise » supposée de la ville. Au cours de la longue histoire des villes, que de discours, d’articles, de rapports et d’enquêtes sur les quartiers insalubres, le mal des grands ensembles, les quartiers gentrifiés et les petites villes. Chaque fois, les récits de la ville qui va mal enjoignent d’organiser, de rationaliser, et avant tout « d’hygiéniser » les territoires et les comportements sociaux.
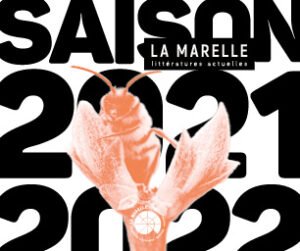
Ces récits mobilisent volontiers la réalité médicale, quand elles ne l’emploient pas comme une métaphore. Ils sont repérables, dans les textes politiques, dans les géographies littéraires, dans les rapports d’expertise et de sciences sociales. Ils illustrent depuis le XIXe siècle une sempiternelle répétition. Comme les îlots insalubres parisiens au début du XXe siècle, les campements, les bidonvilles et les taudis contemporains sollicitent nos regards et nos jugements. Comme en 1950, la pratique de la rénovation urbaine revient en 2000 suivant le mot d’ordre radical des politiques : démolir et reconstruire. À chaque modernité nouvelle, les sociétés urbaines sont prises par la folie de détruire puis retrouvent les accents d’une passion patrimoniale qui les conduisent à rechercher des espaces préservés.
Peut-on écrire la sociologie du récit de la ville malade obsédant l’histoire urbaine à la manière d’un ostinato ? Nous avons tenté d’y répondre répondre en présentant trois récits de la ville malade, issus d’enquêtes : les ilots insalubres au début du XXe siècle, la critique du progrès dans les années 1970, la peur de la perte de l’authenticité dans les années 2000.
« Au commencement était l’hygiénisme »
Dans l’esprit de nos contemporains, l’hygiénisme renvoie à l’obsession de la propreté et de l’ordre, à des espaces vides et nets, libérés de la confusion de la vie sociale. Mais ce courant de pensée, fondamental pour la pensée urbaine, a aussi contribué à réduire la mortalité humaine. Au début du XXe siècle, la découverte, dite scientifique, d’ilots insalubres à assainir fut un tournant fondamental de l’urbanisme : le « traitement » spatial. Le cheminement intellectuel conduisant à cette rencontre de la science et de l’action a emprunté autant à l’émergence de la démographie qu’à celle de l’imaginaire urbain à l’égard des espaces de la pauvreté.
De la notion de milieu nocif pour la santé publique à la spatialisation des maux sociaux, l’hygiénisme a introduit une méthodologie de l’enquête précurseur des outils des sciences sociales. S’il a permis la première mesure statistique et cartographique du surpeuplement des logements, et une réflexion sur l’habitabilité, ce que démontre l’ouvrage à l’appui de nombreuses archives, il fut aussi un outil de stigmatisation des quartiers pauvres et d’immigration qualifiés « d’îlots insalubres ». Le souci de la santé de la population « considérée en masse » fut un argument de l’urbanisme radical détruisant après-guerre des îlots entiers.
La territorialité était alors perçue comme dangereuse. Un récit performatif, s’appuyant sur le portrait de quartiers vivants et dangereux impliquait des populations à déplacer, des bâtiments à démolir, des taudis à éradiquer. Elle nécessitait une fine observation territoriale, dans la lignée de la perspective des monographies de Le Play. Elle confirmait l’existence de modes de vie et de situations territoriales dangereuses, non seulement pour la santé physique, comme les îlots insalubres et tuberculeux, mais pour la santé mentale.
Cette perspective a connu son apogée en 1940, en pleine mode régionaliste et anti-urbaine, lorsque des sociologues et des géographes invitèrent les futurs cadres du pays à retourner aux valeurs traditionnelles des petits pays ruraux. Elle a connu des retrouvailles romantiques dans les années 1970 avec la floraison des « Paris Villages », en lutte contre les « rénovations bulldozers ».
« Nostalgies sociologiques et renouvellement technocratique »
Les années 1970 ont sonné le gong de la fin de la Sarcellite, la légendaire maladie des grands ensembles qui conduisit à leur interdiction en 1973 (circulaire Guichard). Certes, des sociologues, des psycho sociologues et des médecins, bien inscrits dans le courant hygiéniste avant-guerre, participèrent à ce pugilat, qui dénonçait le gigantisme conduisant à l’alcoolisme, à la délinquance et à la dépression. Mais d’autres chercheurs, comme Henri Lefebvre, ont préféré développer une critique de la modernité, une réhabilitation du populaire et du quartier.
Pourtant, le « droit à la ville » fut dévoyé par la technocratie, mobilisant le romantisme nostalgique de l’urbanité pour redonner vigueur au mythe du quartier village et à ses vieilles pierres réhabilitées, supposées fidèles à leurs racines populaires. Or, la commercialité des rues piétonnes et des espaces publics contemporains ne fait que singer l’urbanité regrettée par les sociologues.
La politique de la ville, initiée à la fin des années 1970, relève le même constat de la captation des sciences sociales. La parenté entre les ilots insalubres et la sectorisation de la politique de la ville frappe l’esprit : une géographie prioritaire désignant des quartiers et à travers eux des populations pauvres. Le traitement spatial de l’exclusion dont se réclame la politique de la ville vise leur concentration, leur extraterritorialité, les zones de non droit, considérées comme un handicap pour la ville et l’ensemble des citadins.
Ce récit ne différencie guère les tenants de la politique de la ville de leurs lointains ancêtres hygiénistes. La crainte de la contagion venant de ces quartiers est persistante, que l’on craigne d’attraper la tuberculose ou d’être victime de l’échec scolaire ! Comme à l’époque hygiéniste il s’agit de traiter les populations « en masse ».
La politique de la ville était un imaginaire, accouché des nostalgies sociologiques des années de la modernisation de la France : le rêve d’une nouvelle démocratie urbaine, de l’appropriation collective de l’espace et de la fin de l’aliénation. Mais la rationalisation bureaucratique a pris le pas sur l’utopie, à coups de comparaison de moyennes, d’indicateurs de pauvreté ou, plus finement de raisonnements statistiques en termes d’avantages comparatifs.
La mobilisation des services publics, l’accessibilité à pied aux équipements, les résultats scolaires, les conditions de logements, les nouveaux conseils citoyens, l’activité des services déconcentrés des ministères… la quantophrénie des rapports officiels s’étale à longueur de pages en évitant soigneusement les sujets qui mériteraient aussi d’être étudiés dans ces quartiers (comme ailleurs) : le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, les violences à l’égard des femmes, etc. Il n’est guère question de ville et d’urbanité dans ces rapports ennuyeux.
Entre rationalisation et romantisation, les nostalgies sociologiques ont donc accompagné, voire permis le renouvellement des mythes technocratiques de la ville à guérir.
« Urbanités coupables et perte de l’authenticité »
De ces expériences qu’avons-nous tiré ? Un sentiment commun d’urbanités coupables unit Brooklyn et Detroit, le quartier gentrifié de New York et la ville industrielle, en déclin, du Nord-Est. Ici, la culpabilité de s’être enrichi hante les maisons où les pauvres habitaient. Là-bas, elle obsède les observateurs des paysages de ruines qui n’accueillent plus que des déshérités dans les terrains vagues des villes en déclin, laissant espérer un retour de la nature interstitielle – mais celle-ci pourrait aussi bien être cultivée, partagée et gérée avec intelligence collective – sur les vestiges de l’économie productiviste de l’industrie automobile.
Entre ces deux figures paroxystiques de villes, illustratives de l’urbanité actuelle, se lit le désarroi face à la brutalité économique. La mobilité des personnes et des biens, identifiée il y a un siècle comme le « pouls de l’agglomération », est aujourd’hui vécue sous la forme de déplacements subis, voire contraints. Elle fragilise celles et ceux qui en sont privés. L’obsession de la croissance continue de dévorer les paysages, dans et dehors des villes. L’extractivisme épuise les ressources et décime les écosystèmes. Le citadin, qui se reproche de mal consommer, se sent coupé de l’authenticité des quartiers où il aime vivre.
La ville d’aujourd’hui serait-elle coupable de grandir ? Voudrait-on l’arrêter de s’étendre et de construire ? Peut- elle retrouver ses racines, ses habitants historiques susceptibles de passer une existence entière dans un même quartier ? N’y-a-t-il pas un complexe de Peter Pan dans le récit que font certains citadins, habitant des quartiers gentrifiés et sensibles à l’environnement, de leurs propres évolutions ? Ne devrait-on pas leur donner crédit de dénoncer des villes où l’on ne peut plus habiter et des sites que la pollution rend chaque jour de moins en moins fréquentables ?
Les « gentrifieurs » et les « précaires énergétiques » sont deux figures de repoussoir de ces récits, l’un au nom de la préservation des territoires populaires, l’autre pour sauver les processus vivants qui rendent la planète habitable par les populations humaines et non humaines.
La culpabilisation apparait comme un élément essentiel du récit contemporain sur la ville malade mobilisé par les politiques urbaines, plutôt incitatives qu’autoritaires. Elle atteint les populations ségrégées suspectées de former des « ghettos », les couches moyennes obligées d’habiter les quartiers populaires, les habitants qui ne disposent pas d’un logement vertueux, les précaires suspectés d’être dépensiers en énergie, sans oublier les habitants du grand périurbain obligés de s’éloigner des centres villes et coupables de gaspiller de l’essence en frais de transport.
La recherche à tout prix de l’authenticité est le moteur de cette culpabilisation aussi bien présente dans les vieux quartiers gentrifiés, mais respectueux de « la diversité », que dans les éco quartiers hantés par le souci de l’harmonie avec « la nature ».
L’émergence des petites villes à l’agenda des politiques urbaines, va dans le même sens. L’image du village perdu consiste en un vieux clocher, quelques bâtiments ruraux regroupés et entourés de champs. Ils constituent la référence d’un urbanisme « à taille humaine », plus ouvert à la sociabilité et à l’échange. Que ce village soit menacé de déclin, que ses maisons se vident et se détériorent, que ses populations se précarisent, vieillissent et disparaissent au profit d’un mélange hétéroclite de situations urbaines, cela inquiète. Cette France dite des marges s’exprimerait par des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Les récits conduisent le gouvernement à développer des politiques de reconquête des cœurs de ville, s’opposant aux métropoles, trop choyées.
Ce retour d’intérêt pour le centre des villes moyennes et petites supposées en « crise » réactive l’image archétypale de la « France profonde » qui s’oppose depuis longtemps à l’urbanisation et à l’image de la construction de barres, de tours et de pavillons, ceinturés d’autoroutes. Le récit, qui se réfère implicitement à une idée proto nationaliste de « l’identité française », est démenti par l’analyse concrète des territoires périurbains et de leurs populations.
Mais l’imaginaire de la ville moyenne, du village, voire du vieux quartier, avec ses populations « autochtones » et son territoire à l’écart de l’économie, pèse lourdement, malgré l’autre réalité, incarnée par les Gilets jaunes, qui occupent, dès novembre 2018, des espaces symboliques comme les ronds-points des centres commerciaux. Leur dénonciation des difficultés économiques à vivre dans le grand périurbain nourrit le discours sur la crise notamment des centres-bourgs qui apparaissent comme de nouveaux îlots insalubres.
Les petites villes se sont constituées comme une entité spatiale et narrative. À l’hiver 2018-2019, un sentiment de dépossession de liens et de lieux a mobilisé des populations se réclamant des petites villes et du grand périurbain, résultant d’une urbanisation incontrôlée, développée par l’industrie de la construction, soutenue par l’État. Paris et les métropoles régionales avec leurs éternelles et ennuyeuses rues piétonnes, leurs commerces inaccessibles et interchangeables, leurs rues à quai de tramway et leurs lieux symboliques ont été pris d’assaut. Ces manifestations exprimaient-elles un droit à la ville, de retour intégratif à la centralité urbaine et politique selon l’expression d’Henri Lefebvre ?
De fait, elles ont nourri les représentations hostiles à la ville et à l’urbanité des métropoles et affirmé, comme les couches moyennes et supérieures urbaines des beaux quartiers, des valeurs d’’authenticité. Au nom de celles-ci, tout semble opposer les « urbains mondialisés », les « élites » et le « peuple », dûment mythifiés. Les drapeaux régionaux et nationaux se dressent dans les manifestations de rue au cœur même des décors factices de l’urbanité des métropoles. Des groupes d’extrême-droite tentent d’en tirer parti.
Alors que certains chercheurs opposent, à l’aide d’idéaux-types caricaturaux, les « campagnes » à la survalorisation des métropoles, supposées innovantes et dynamiques, d’autres prennent la défense du « peuple périphérique » et répètent le récit de « Paris et le désert français » (1947), d’une capitale prédatrice des richesses du monde rural. Le thème des identités territoriales, récurrent en France depuis au moins le XVIIIe siècle, refait surface.
La pandémie de Covid 19 ou la fin de l’hygiénisme
Le retour de l’hygiénisme a été dénoncé par de nombreux auteurs craignant une réémergence d’une magistrature médicale et morale : un État fort, imposant des normes sociales sous couvert de sauvegarde sanitaire. Mais l’injonction au lavage des mains et aux précautions quotidiennes ne suffit pas à qualifier la politique actuelle d’hygiéniste. Certes, après plus d’un siècle d’éclipse, les spécialistes de santé publique sont revenus au premier plan de l’information, en l’occurrence sur les plateaux de télévision. Pourtant, au contraire de leurs ancêtres hygiénistes (Octave Du Mesnil, Louis René Villermé, Jacques Bertillon…), ils ignorent tout des groupes et des individus assignés à résidence.
Les sciences sociales sont absentes des discussions. Beaucoup ne veulent rien savoir des logements surpeuplés, des immeubles collectifs sans espaces communs, des sans-domicile fixe, des personnes âgées isolées, des jeunes adultes bloqués par la crise du logement, des colocations forcées par le marché et des cohabitations de « télétravailleurs » au bord de l’explosion.
Figure fondatrice de l’hygiénisme, le médecin Louis René Villermé qui dressait le portait des conditions de vie des populations laborieuses pour expliquer la diffusion du choléra, aurait été bien surpris de l’obsession du corps malade sans égard pour l’hygiène mentale des milliers de ménages, entassés dans leurs appartements. De même, contre toute raison sanitaire, les parcs publics et les jardins ouvriers, crées jadis au nom même de l’hygiène, furent fermés lors du premier confinement.
Aurait-on plus de chances à retrouver de l’hygiénisme dans les rapports entre le corps médical et le politique ? Certes, les institutions se sont entourées d’experts sanitaires. Mais les premières semaines du confinement ont donné lieu à de graves confusions. Dans les médias, avec la bénédiction de la direction de la Santé publique, la publication d’une carte de France parsemée de points rouges selon le nombre brut de décès relevait de l’absurde. Aucun rapport n’était fait avec la mortalité en contexte non épidémique, le nombre d’habitants des villes et des départements, voire les densités. Était-on revenu dans la bonne ville d’Oran décrite par Camus où l’on décomptait soigneusement le nombre de décès sur des pages quadrillées ? Avait-on oublié les générations d’hygiénistes qui, tel Jacques Bertillon, ont participé à la création de la statistique des populations ?
L’émotion gouvernait la foule apeurée qui se barricadait à domicile, une petite minorité s’interdisant pendant des semaines toute sortie à l’extérieur. La stratégie de confinement a radicalement tourné le dos aux méthodes du XXe siècle fondées sur l’investissement public dans les hôpitaux, les dispensaires et autres structures de soin et de prévention. Elle a rappelé les méthodes, abandonnées depuis 1861, de quarantaine, lazaret et autres restrictions à la circulation. Étions-nous revenus en 1832, lorsque le choléra se répandait à Paris et suscitait le besoin de construire des barrières contre l’ennemi ?
Aujourd’hui, comme au temps de la tuberculose, l’ennemi, à nouveau intérieur, peut aussi bien venir de toute la planète que du voisin de palier. Aussi, lorsqu’à l’issue de longues semaines d’isolement, les pouvoirs publics ont progressivement autorisé le droit à l’espace public, les marchés, les bars, les cinémas et les piscines ont peu à peu ouvert leurs portes, une politique de l’espacement s’est faite jour.
Le traçage individuel accompagné de tests dessine un paradigme émergent dans lequel protection de masse et prise en compte des particularités individuelles vont de pair. Faute d’investissement préventif, un autre régime de santé publique, fondé sur le principe de la responsabilité du risque des individus, s’applique. Les gouvernements, ayant mobilisé des stratégies de confinement sévères, ont évolué vers un libéralisme qui se borne à recommander aux plus fragiles de se protéger particulièrement, sans se soucier de leurs difficultés individuelles. Ainsi, le principe de la solidarité face à la dissémination du virus ne vaut plus que pour les annonces publiques.
Néanmoins, si certaines populations ont pu et peuvent pour se protéger limiter leurs nombres de relations de face à face et faire respecter leurs « distances sociales », conformément aux recommandations gouvernementales, d’autres, qui n’ont pas cette capacité, se trouvent, de fait, ségrégées. Le passeport vaccinal ne fera qu’augmenter la distance entre ceux qui pourront voyager, grâce au télétravail et à la régulation des contacts physiques au strict nécessaire, et les autres entassés, pour vivre et travailler, dans des modes de transport infectés.
Ces éléments, qui montrent une transformation radicale de l’espace public, sont plus intéressants que la dénonciation aveugle d’un hygiénisme qui n’existe plus. Les hygiénistes ont, dès le début du XIXe siècle, dénoncé les mécanismes ségrégatifs dans la ville, agglomérant la misère des populations à qui étaient offertes les pires conditions de vie. Ils ont appuyé une politique d’équipement des villes, d’assainissement, ainsi que la construction de services publics de santé.
En proposant une santé publique « à la carte », fondée sur le traçage et la limitation des mobilités individuelles, les pouvoirs publics font reposer la responsabilité des pandémies sur les personnes plutôt que sur le déficit d’équipement dont ils ont la charge. Les réformes sociales voulues par les hygiénistes sont bien loin. Chacun devient responsable et acteur de sa propre sécurité, de sa santé et de ceux qui l’entourent. À ce titre, la désignation des territoires et des populations à risque (les « clusters ») qui connaît une nouvelle vigueur, comme il est usuel en période d’épidémie, montre que les récits de la ville malade n’ont finalement guère changé.
Sortir du récit de la ville malade
Les récits de la ville malade répondent à des grammaires. Les îlots insalubres, les quartiers de la politique de la ville et les centres-bourgs sont des objets d’étude et d’action publique repérés comme des terrains d’investigation pour les sciences sociales urbaines et « traités » par les urbanistes. Un monde de spécialistes légitimes tend à s’établir, dès lors que ces lieux apparaissent publiquement comme des « problèmes ».
Des acteurs et des experts de la ville, dotés d’une méthodologie invariable – même à l’époque des big data – délimitent un territoire, définissent des critères, segmentent des populations et calculent des « impacts ». Comme l’ont montré en leur temps les hygiénistes, pionniers de la rationalisation institutionnelle de l’intervention urbaine, il s’agit de « traiter » un territoire donné.
La notion de territoire malade fait partie de l’héritage et de l’actualité du raisonnement urbanistique. Des espaces deviennent l’objet de processus décrits par un récit négatif, chargé d’émotions. Comme celle du territoire sain, la recherche de l’authenticité est toujours marquée du sceau de la culpabilité. Culpabilité du chercheur-gentrifieur si proche du peuple qu’il l’étouffe de sa propre révolte contre un processus auquel il participe lui-même. Culpabilité et impuissance du citadin pollueur, encouragé à multiplier les micro-gestes écologiques, affirmant qu’il les exécute, même contre toute réalité. Posture équivoque des sciences sociales qui ne sont pas simplement les expertes de l’État ou leur opposition institutionnelle mais qui fabriquent des représentations, construisent des valeurs, et participent à la fois à la romantisation du monde urbain, et à sa normalisation.
Les responsables des villes ne devraient-ils pas abandonner le rêve de la ville saine et lissée qui échoue le plus souvent à une ville-décor totalitaire et ségréguée ? D’autres conceptions de la santé publique ne devraient-elles pas permettre de penser la ville autrement ?
NDLR : Yankel Fijalkow vient de faire paraître Récits de la ville malade. Essai de sociologie urbaine aux Éditions Créaphis.
