Tout ce que vous avez voulu savoir sur Bruno Latour sans jamais oser le demander au SARS-CoV-2 – un moment latourien (1/4)
La nouvelle est tombée il y a à peine deux ou trois ans ; elle semble d’ailleurs avoir surpris les personnes qui se croyaient le mieux informées : un certain Bruno Latour était « le philosophe français le plus célèbre au monde » (dixit le New York Times), « l’intellectuel français le plus influent à l’étranger » (dixit Le Monde), et même une star à l’égal de Greta Thunberg (dixit Yann Barthès).
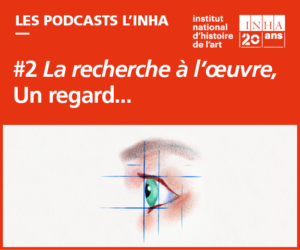
Le grand public découvrait un auteur qui non seulement battait des records au palmarès bibliométrique des noms les plus cités au monde [1], mais qui de surcroît avait fondé des disciplines entières (la sociologie des sciences et des techniques), inspiré des travaux dans des champs extrêmement variés (de l’anthropologie au management et du marketing à la théologie, toutes également renouvelées par une orientation originale associée à Latour : la « théorie de l’acteur-réseau »), travaillé avec les meilleurs artistes de son temps pour des expositions ou des pièces de théâtre, inspiré aussi bien les négociateurs de la COP-21 que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, bref une œuvre-monde. Cette œuvre était passée relativement inaperçue, du moins dans son pays d’origine, la France, où la conviction s’était établie que l’âge d’or des années soixante et soixante-dix n’avait laissé derrière lui que des orphelins prodigues, désormais vieillissants.
C’est bien à l’histoire que Latour aura dû cette faveur tardive. Il n’y aura fallu rien de moins qu’un événement cosmique : le réchauffement climatique. Car le fait est qu’au cours des années 2010 un basculement s’est opéré dans l’opinion publique au sujet de la mutation écologique globale.
Certes le problème n’est pas apparu durant la dernière décennie ; mais il n’est devenu une préoccupation de masse que très récemment. Le climatoscepticisme a cessé d’être une position par défaut ; désormais, au contraire, l’inquiétude pour l’avenir de notre planète est devenue l’attitude non-marquée (pour parler comme les linguistes), celle qui va de soi.
Cette situation nouvelle a périmé un certain nombre de discours théoriques hérités du XXe siècle, qui n’ont presque rien à dire sur ces sujets et paraissent ainsi ne donner que peu de prise sur notre présent. Inversement, le travail de Latour s’est imposé précisément parce qu’il donne des outils ajustés à ces enjeux. C’est pourquoi Yann Barthès pouvait dire en souriant : il y a Greta Thunberg et il y a Bruno Latour. La conjonction de la jeune égérie de la colère climatique et du sage patriarche des sciences sociales définit effectivement quelque chose : notre temps.
Nous sommes dans un moment latourien. Il faut prendre cette expression littéralement : ce n’est pas nous qui sommes devenus latouriens ; c’est notre temps. Plus exactement, le nom de Latour peut servir à désigner ce qui fait la spécificité de notre présent, sa différence d’avec le passé, ce qui le contracte, aussi, dans une certaine unité, ce qui donc nous rend contemporains de nous-mêmes en nous sommant d’être à la hauteur de cette brèche ouverte sur l’inconnu qu’est le présent. Il arrive qu’on lise des livres non pour s’évader, mais pour se rattacher à sa propre situation, parce que celle-ci nous rattrape et que nous ne pouvons plus ignorer que nous nous y sommes pris. Les livres de Latour sont de ce genre.
Le réchauffement climatique n’est pourtant pas le problème de départ de Latour. Son œuvre, qui a maintenant presque un demi-siècle, se proposait plus généralement de réformer les outils analytiques des sciences humaines pour mieux appréhender notre réalité sociale et historique. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que la mutation écologique globale est devenue la préoccupation principale et presque exclusive de son auteur.
Il est d’autant plus remarquable de constater que ses concepts se montrent pertinents pour appréhender notre temps, même quand on ne se limite pas aux textes récents qui portent spécifiquement sur la mutation écologique globale. Tout se passe comme si celle-ci avait eu une fonction apocalyptique au sens étymologique du terme : elle a révélé quelque chose qui était là depuis longtemps, quelque chose de notre réalité que nous ne voulions pas voir, mais que Latour décrivait obstinément pour nous depuis un demi-siècle.
Si ce soupçon, dans l’opinion publique, d’une pertinence singulière du discours latourien pour notre temps circulait déjà avant l’explosion de la pandémie de Covid-19, celle-ci a incontestablement enfoncé le clou. Là encore, on semble assister, toutes proportions gardées, à un phénomène de massification. Les vérités latouriennes semblent être entrées désormais, durement, dans la chair de chacun.
Ces vérités, ce sont bien sûr les mêmes que celles que le bouleversement climatique oblige désormais à prendre en considération. Mais on en fait l’épreuve au plus proche, au lieu d’en concevoir l’hypothèse au plus loin. Tel est d’ailleurs le sens du dernier livre de Bruno Latour, Où suis-je ?, qui part de l’expérience corporelle du confinement pour redéployer, à partir d’elle, une vision du monde nourrie de l’ensemble de ses travaux précédents et de ses recherches en cours, dans l’horizon de la mutation écologique globale.
Je voudrais dans la série des textes qui suivent montrer comment la crise sanitaire a mis en évidence à quel point la structure de notre présent gagne à être abordée avec les outils mis au point par Bruno Latour, et cela pas seulement parce que la pandémie entretient avec la mutation écologique une relation métonymique, au titre de manifestation parmi d’autres ou de signe annonciateur de celle-ci, mais aussi parce qu’elle jette une lumière crue à la fois sur la situation moderne et sur ce que j’oserais appeler la nature des choses.
Il me semble qu’on peut identifier quatre grands gestes théoriques de Latour dont la pertinence s’est fait sentir de manière particulièrement forte à l’occasion de cette crise sanitaire : remettre les sciences au cœur du débat publique, dépasser l’opposition nature / culture, faire atterrir la Modernité, localiser tout ce qui est global. Quatre dimensions apparaissent ainsi : épistémologique, ontologique, eschatologique et enfin cosmologique.
Ce texte, bien sûr, est un hommage à une personne que j’admire, mais il est surtout une invitation à lire. Il est aussi une manière pour moi de fêter une entreprise journalistique qui n’a cessé de parier sur la capacité des idées à éclairer notre présent. Durant ses trois premières années d’existence, AOC a accueilli largement certaines des thèses présentées ici et contribue à nourrir une conviction sans laquelle ni l’écriture ni la lecture d’une œuvre comme celle de Bruno Latour n’aurait de sens : il n’y a point d’actualité sans idées.
Le premier des gestes latouriens à s’avérer singulièrement pertinent pour appréhender la pandémie est d’avoir remis les sciences au cœur du débat public. Latour n’a cessé de soutenir qu’il importait d’en avoir une vision moins fantasmée si on voulait avoir une relation mieux ajustée à notre monde. La crise sanitaire a montré l’urgence d’une telle rectification.
On ne peut pas dire que les questions épistémologiques aient particulièrement occupé les grands discours politiques lors des cinquante dernières années. Cela est un trait assez singulier de la période récente. Car pendant longtemps l’idée de progrès scientifique et technique a fondé l’idéologie de la Modernité, avec son horizon de progrès politique et moral – c’est même cela qu’on appelle les Lumières. Le marxisme lui-même supposait une certaine idée de science – puisqu’il se voulait « socialisme scientifique » par opposition au « socialisme utopique » – et cette exigence a suscité une orgie de propositions épistémologiques enflammées (l’œuvre d’Althusser parmi d’autres en témoigne). Puis, avec la crise de l’idée de progrès après les deux guerres civiles européennes mondialisées (on se souvient du mot de Valéry : « nos civilisations sont mortelles »), l’usage traumatisant de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, les premiers diagnostics solides de la catastrophe écologique globale dans les années 1970, le mythe moderniste a perdu son crédit, mais silencieusement.
L’importance des sciences dans nos vies a cessé de se trouver au cœur de la réflexion savante et populaire sans que nul ne s’en avise vraiment. Mieux valait ne plus parler de la signification des sciences pour la vie humaine puisqu’on ne savait plus vraiment comment les faire rentrer dans notre mythe d’autojustification. Les sciences sont devenues un domaine d’activité parmi d’autres, dans lequel on peut s’engager, ou pas, et si on le fait ça sera plutôt par passion, car on risque de ne pas y gagner grand-chose (particulièrement si on se trouve en France) ; les grandes ambitions se dirigeraient plutôt vers la finance, la politique, voire l’ingénierie, notamment informatique, qui a, relativement au fait scientifique, une relation qui n’est pas tout à fait la même que celle des autres technologies (car le dialogue entre science fondamentale et application y est plus obscur : réussir à simuler un comportement avec des algorithmes ni ne suppose ni ne permet nécessairement de le comprendre).
À quoi bon dès lors avoir une idée plus claire de ce qui se fait dans les laboratoires ? Ça n’est ni plus intéressant, ni moins intéressant, que d’aller voir ce qui se fabrique dans les musées, le monde des salons de coiffure ou les communautés Amish. Pour la plupart des grands problèmes qui ont occupé le débat public lors des cinquante dernières années, les sciences étaient presque indifférentes – sauf bien sûr pour les questions qu’on a appelées « écologiques » mais qui, précisément, restaient difficiles à mettre au cœur des débats publics. La question du réchauffement climatique a réussi finalement à briser cette relative marginalisation, mais cela s’est fait de manière très lente et malgré tout assez timide.
La pandémie nous a réveillé brutalement. On s’est passionné comme jamais pour des questions scientifiques, et aussi épistémologiques : fallait-il chercher à pratiquer des tests en double aveugle pour vérifier l’efficacité d’un traitement, ou bien fallait-il avant tout tenter de soigner, quoi qu’il arrive ? Quelle était l’importance des intérêts financiers dans les avis de tels ou tels scientifiques ? La parole politique pouvait-elle s’appuyer sur l’expertise scientifique pour décider des libertés fondamentales ? Etc.
Certes, l’élection de Trump et la thématique de la post-vérité avaient déjà obligé le très grand public à se souvenir que la connaissance est une question politique. Mais il n’y était pas nécessairement question de sciences : il n’y a pas de science qui vienne valider ou invalider l’assertion selon laquelle des millions de personnes assistèrent à la prise de fonction de Trump ; c’est une question journalistique. Ce qu’il y eut de nouveau avec la pandémie, c’est qu’il s’est bien agi des sciences proprement dites.
On s’est beaucoup moqué de la floraison de virologues sur les réseaux sociaux, les plateaux de télévision et les déjeuners dominicaux. Mais pas plus qu’il n’y a lieu de se plaindre qu’il y ait 66 millions de procureurs en France, il n’y a lieu de faire la grimace devant cette passion publique pour des recherches scientifiques. Dans les deux cas, cela montre seulement que la démocratie est vivante, c’est-à-dire que les gens se mêlent enfin de ce qui, précisément, les concerne ! Comme on aimerait qu’il y ait aujourd’hui 66 millions de climatologues, de spécialistes des pesticides ou d’endocrinologues…
L’opinion publique effarée a découvert pendant cette pandémie que les sciences étaient un champ de bataille.
Car on peut voir alors les dommages que produit une mauvaise théorie des sciences, c’est-à-dire une image faussée de ce que sont concrètement les pratiques scientifiques, image produite par l’idéologie scientifique qui a structuré la modernité politique – et que précisément l’œuvre de Latour tout entière a tenté de corriger. Car Latour, il faut le rappeler, est d’abord un anthropologue ou sociologue des sciences et des techniques. Il est un des fondateurs de cette discipline qu’on appelle dans le monde anglophone les STS (Science and Technology Studies). Et une de ses conclusions les plus solides est qu’on ne saurait distinguer les sciences des autres activités humaines, et notamment de la politique, en soutenant que les premières produisent des vérités indiscutables alors que les autres sont tissées de croyances douteuses.
Il a, avec d’autres, mis l’accent sur le caractère premier de la controverse dans la production des vérités scientifiques ; il a montré, par une série d’enquêtes de terrain, de recherches historiques et de généralisations spéculatives, que les énoncés scientifiques n’obéissent que rarement à une logique binaire (vrai/faux), mais fonctionnent par leur plus ou moins grande capacité à mobiliser et attacher ensemble plus ou moins fermement un nombre plus ou moins grand d’alliés [2].
Or nous avons vu combien certains décideurs politiques de par le monde, et notamment Emmanuel Macron en France, ont eu tendance à se réclamer de la science pour faire taire les controverses : « la Science l’a dit, alors c’est vrai ». Et on a vu que cette stratégie a eu pour effet de faire perdre de leur autorité et aux scientifiques et aux politiques. Car la vérité mal gardée sur les sciences n’a pas tardé à devenir publique : plutôt que de produire des verdicts définitifs, elles ouvrent des problèmes nouveaux, qui plus est nouveaux non seulement dans leurs contenus (on se pose des questions qu’on ne se posait pas avant) mais aussi dans leurs modalités (on se les pose autrement que dans d’autres secteurs où la passion inquisitive des êtres humains s’exerce : autrement dit, la science diffère des autres pratiques humaines non par le fait de trouver des solutions, mais par le fait de poser des problèmes autrement).
Les sciences ne produisent pas des faits indiscutables, mais des controverses qui finissent par se stabiliser, parfois à grand peine. Si on considère la controverse comme étant substantiellement incompatible avec l’activité scientifique, le constat d’une seule de ces controverses suffira à faire douter de l’existence ou de la spécificité de la démarche scientifique comme telle, en même temps que l’instrumentalisation de cette supposée infaillibilité des sciences par le pouvoir politique le fera passer pour un imposteur qui, ne pouvant plus se prétendre de droit divin, se voudrait de droit scientifique.
C’est ce qui n’a pas manqué d’arriver : les gens, voyant leur vie si radicalement modifiée en conséquence de théories sur le comportement, les effets, les modes de diffusion de cette entité inobservable à l’œil nu qu’on appelle un « virus », ont eu bien sûr envie de se pencher sur les sciences en train de se faire, au lieu de laisser les chercheuses et les chercheurs calmement parcourir le processus toujours incertain de résolution des controverses. En franchissant les portes qui donnent sur la salle des machines où les énoncés scientifiques se produisent, ils se sont trouvés en plein milieu des controverses.
C’est ainsi qu’on s’est étonné de trouver des scientifiques tantôt pour défendre une position sur l’efficacité des masques non chirurgicaux (ou en tissu), tantôt pour en défendre une autre, pour faire valoir tantôt une explication sur l’origine du virus (via le pangolin), tantôt une autre (une fuite d’un laboratoire), pour signer tantôt une étude qui évalue à un degré élevé l’efficacité de telle mesure (confinement, couvre-feu, etc.), tantôt une autre qui la réfute, pour se féliciter tantôt d’une étude qui invalide drastiquement l’efficacité d’un traitement (l’hydroxychloroquine), tantôt d’autres qui montrent que les protocoles dans cette étude ne sont pas respectés (comme ce fut le cas pour The Lancet), tantôt une étude qui montre l’efficacité de tel vaccin, tantôt une autre qui au contraire conclut à son manque d’efficacité (comme ce fut le cas pour le vaccin d’AstraZeneca), etc. L’opinion publique effarée a découvert pendant cette pandémie que les sciences étaient un champ de bataille. Et elle en a parfois déduit qu’on ne pouvait donc pas leur faire confiance [3]. À tort.
À tort, car si la culture scolaire avait diffusé de la science une image moins fausse, nous aurions compris qu’on peut fonder l’autorité que nous attribuons aux sciences non pas sur le fait qu’elles échappent à la bataille, mais sur le fait qu’elles bataillent autrement et sur autre chose que les autres pratiques humaines. Latour n’a cessé de répéter que son travail, loin d’avoir comme intention de diminuer cette autorité, cherchait au contraire à lui donner un fondement solide. On voit à quel point cet épisode de la pandémie lui donne raison.
Il est urgent de reconstruire une autre culture publique des sciences et celle-ci gagnerait à s’inspirer des travaux de Latour. Car il n’a cessé de montrer que loin de reposer sur l’absence de conflictualité, la confiance qu’on peut attribuer aux sciences tient au contraire à l’intensité de la conflictualité qui y règne. C’est elle qui conduit les scientifiques à chercher à s’attacher des alliés toujours plus nombreux de manière toujours plus étroite et au prix de procédés toujours plus ingénieux.
Une entreprise scientifique consiste à essayer d’attacher à un énoncé le maximum d’alliés humains et non-humains, de telle sorte que se dissocier de celui-ci revienne à perdre beaucoup de choses. Si les sciences diffèrent des autres champs de bataille humains, c’est par la précision et l’ampleur de ces alliances et non par leur irénisme.
Ainsi fait-on converger vers un seul graphique un très grand nombre de cas (pourtant très variés) de personnes entrant à l’hôpital, en mobilisant des acteurs très variés, appartenant à des institutions très nombreuses, elles-mêmes au cœur de beaucoup de liens (ainsi l’INSEE, les hôpitaux, etc.), au point que pour contester ces graphiques il faut contester un très grand nombre d’acteurs.
De telles données ne constituent pas des certitudes (de fait les erreurs y sont innombrables), mais elles permettent de monter en puissance dans la controverse et c’est sur cette base que nous leur accordons notre confiance : toute contestation devra mobiliser au moins autant de ressources. À l’inverse d’ailleurs, ceux qui refusent toute confiance à ce réseau s’isolent, au point de devoir souvent reculer : on se souvient de Michel Onfray décidant de suivre l’avis de son médecin et de ne pas prendre de l’hydroxychloroquine, le lien avec Raoult s’avérant moins fort que les liens qui étaient tissés autour de son médecin.
On voit que les raisons pour lesquelles les « ignorants » ont confiance dans les sciences ne sont pas de nature différente de celles qui permettent aux « savants » d’avoir confiance dans tel ou tel énoncé scientifique : c’est à chaque fois une question de rapports de force entre des attachements très hétérogènes. Une description réaliste de la manière dont se produit la confiance dans les sciences, loin d’en diminuer la crédibilité, l’établit sur les seules bases légitimes : leur capacité à l’emporter dans une controverse. Les controverses cessent ainsi d’être des objections liminaires au fait scientifique comme tel et deviennent de passionnantes manifestations de sa production toujours précaire, toujours conflictuelle, toujours intense.
Mais l’idée des faits indiscutables n’est pas la seule erreur au sujet des sciences que la lecture de Latour aurait permis d’éviter dans le contexte de la pandémie. Relevons-en rapidement quelques autres.
Il ne suffit pas de comprendre qu’un énoncé scientifique ne constitue pas en soi une vérité, mais plutôt une conclusion obtenue à partir de certaines méthodes qui peuvent être qualifiées de scientifiques dans la mesure où elles contribuent à une controverse. Il faut encore comprendre qu’elle n’a aucune raison de déterminer de manière complète et univoque une décision politique. Pour la France, cela signifie une chose simple : ce n’est pas parce que le Conseil scientifique dit quelque chose, que l’action politique doit le suivre. Il reste une responsabilité proprement politique, qui donne lieu à des décisions qui elles aussi sont plus ou moins « vraies » à leurs manières, plus ou moins ajustées, plus ou moins capables de faire tenir ensemble des exigences contradictoires.
Latour n’a cessé d’insister sur ce point : les sciences contribuent à configurer notre réalité sociale et ne se contentent pas de décrire la nature.
Il n’y a pas d’un côté l’ordre des sciences, de l’autre le chaos de la politique. On a plutôt deux activités normées, mais donnant lieu à des critères différents. Et de même qu’il y a des mauvais scientifiques et des bons scientifiques, de même il y a des mauvais politiques et des bons politiques, des énoncés politiques qui tombent juste et d’autres qui tombent à faux.
Cela ne veut pas dire qu’il faut aller du scientisme politique à une sorte de décisionnisme autoritaire (comme l’a fait Emmanuel Macron) ; cela veut dire qu’il faut au contraire donner tout leur poids à chacune des valeurs ou des formes de vérité qui s’imposent sur tel ou tel problème. Ce qui a manqué et manque encore dans cette situation c’est un lieu où les différentes composantes intéressées à la question (scientifique, économique, culturelle, religieuse, politique, etc.) puissent être représentées et faire valoir leur poids, une sorte de Sénat des valeurs [4].
Ce point fait écho à ce que Latour a présenté dans son dernier grand système de philosophie empirique, intitulé l’Enquête sur les modes d’existence, où il soutient que les sciences ne constituent qu’un régime de vérité parmi d’autres, qui voisine avec d’autres, dont les arts, le marketing, la religion, bien d’autres encore… et la politique ! Excepter l’activité scientifique de toutes les autres en lui réservant l’exclusivité de la notion de vérité, et même de l’accès à la réalité, c’est risquer de faire perdre à toutes en même temps leur autorité et même leur poids de réalité. Il suffit d’un peu de réflexion pour confirmer que, si toutes nos décisions devaient être « scientifiquement fondées », nous ne pourrions tout simplement pas vivre !
Une troisième erreur à rectifier à propos des sciences, si on veut comprendre ce qui nous arrive, consiste à croire que les sciences seraient séparées de la politique comme si elles se contentaient de décrire le monde, alors la politique le fabrique. Latour n’a cessé d’insister sur ce point : les sciences contribuent à configurer notre réalité sociale et ne se contentent pas de décrire la nature. Si la théorie des virus n’existait pas, ou si elle était différente, il n’y aurait pas de confinement, pas de crise économique, pas de « distanciation », pas de masque, pas de test, pas de vaccin – bref aucune des grandes questions politiques qui préemptent l’actualité depuis un an et probablement encore pour plusieurs mois.
On ne comprendra donc rien aux sciences si on ne comprend pas qu’elles ne sont pas seulement un outil pour représenter le monde tel qu’il est, mais aussi une force de reconfiguration de ce monde. Le débat sur le constructivisme et le réalisme qui agite beaucoup les esprits est ici tranché par la réalité elle-même…
Quatrième erreur : croire que les sciences sont « autonomes », au sens de séparées des autres domaines d’intérêt humain, qu’ils soient idéologiques, politiques, mais aussi économiques, artistiques, éthiques, religieux. En vérité, elles ne cessent d’être investies par ces intérêts, au point qu’il n’y a pas de sens à distinguer entre des intérêts purement scientifiques et des intérêts d’une autre nature. Il serait formidable de pouvoir tracer une ligne de démarcation nette entre science et non-science.
Malheureusement, dès qu’on se trouve sur le front de la connaissance en train de s’inventer, la « science en action » comme l’appelle Latour, cette ligne est aussi mouvante que la recherche elle-même – elle est d’ailleurs un des enjeux de cette recherche ! C’est bien ce qu’on a vu dans les débats autour des positions de Didier Raoult : parlait-il en scientifique ou en « gourou populiste » ? Et ses détracteurs, obéissaient-ils à des préoccupations de pure rigueur intellectuelle, ou bien avaient-ils eux aussi leur prestige à conserver, leurs alliés politiques et économiques à satisfaire, leurs préjugés à défendre ?
Déclarer le premier intéressé et les seconds désintéressés ne peut avoir que des conséquences catastrophiques. Car dès qu’on se rend compte qu’ils ne le sont pas, ils perdent ce qui au contraire devrait leur donner toute leur force : leur capacité à mobiliser un plus grand nombre d’acteurs plus puissants. Après tout, que des laboratoires qui veulent faire de l’argent, des personnalités politiques qui veulent se faire réélire, des médecins qui veulent avoir la satisfaction de voir leurs patients guérir, parient sur un énoncé plutôt que sur son contraire est plutôt le signe de ce que le premier a la raison de son côté…
Le grand public a été forcé de constater qu’il n’y avait aucune « pureté » de la science et que les scientifiques étaient des êtres humains comme les autres.
Certes, l’histoire peut ne pas confirmer cette présomption, mais il faut en ce cas la laisser faire ; et son verdict, de toutes manières, ne viendra pas de ce que les sciences étaient autonomes par rapport à ces intérêts prétendument hétérogènes, mais au contraire de ce que ces derniers n’y ont pas trouvé leur compte et se sont ralliés à la thèse adverse. On ne gagne rien à rejeter les intérêts du côté de la Non-Science pour réserver à la Science le désintéressement. On doit au contraire intéresser plus d’acteurs aux sciences qui nous importent !
Le point important est qu’on ne saurait trancher ce genre d’incertitude a priori en invoquant « la méthode scientifique ». Si le partage de la science et de la non-science (ou de la fausse science) est facile à faire une fois qu’une controverse scientifique a été stabilisée (c’est le cas par exemple pour la question de l’origine anthropique du réchauffement climatique : il ne s’agit pas d’une controverse scientifique, mais bien d’une fausse controverse scientifique maintenue en état de vie artificielle par des préoccupations exclusivement idéologiques), il est impossible de le tracer quand on se trouve au cœur d’une controverse active.
Du temps de Galilée, il aurait été impossible de lui donner raison contre les penseurs scolastiques aristotéliciens en arguant que lui seul suivait une méthode proprement scientifique, puisqu’il s’agissait précisément de définir cette méthode ! Et on sait désormais qu’il n’existe rien de tel que « la Méthode Scientifique », sinon celle qui dit qu’il faut réinventer pour chaque famille de problèmes une méthode proprement scientifique (qui ne sera pas la même pour la chimie organique que pour l’astronomie gravitationnelle, pas la même pour la linguistique que pour la géologie, pas la même pour la modélisation informatique des épidémies et pour l’analyse des effets du virus sur les tissus neuronaux, autrement dit pour la biostatistique et la neurologie, etc. [5] ). On comprend dès lors que l’enjeu de la démarcation entre science et non-science est toujours au cœur de toute controverse scientifique d’importance.
Au demeurant, le cas de l’affaire Raoult montrait aussi que la question se pose de savoir si la notion de « raisonnable » correspond à la notion de « scientifique » : il est parfois raisonnable de ne pas chercher des réponses scientifiques à des questions. C’est affaire d’urgence, d’opportunité, de moyens, de positions statutaires, etc. La fonction de deus ex machina, de garant en dernier recours, neutre et impartial, que notre imagination moderniste a tendance à donner aux sciences, au lieu de les servir, les dessert systématiquement. Les sciences sont dans la bataille, non seulement parce qu’elles sont tissées de controverses mais parce que ces controverses ne sont jamais séparées d’autres controverses portées par toutes sortes d’intérêts. C’est au cœur de ces batailles qu’elles gagnent leur crédit.
Enfin, cinquième erreur, dans le même ordre d’idée, le grand public a été forcé de constater qu’il n’y avait aucune « pureté » de la science et que les scientifiques étaient des êtres humains comme les autres : ils avaient des préjugés, ils étaient mesquins, enclins parfois à la tricherie, à la facilité, à la précipitation. La science n’est donc pas « autonome » en ce sens non plus. L’épisode calamiteux de l’étude publiée dans la très prestigieuse revue médicale The Lancet contre l’hydroxychloroquine a illustré ce point, non pas tant par elle-même que par l’enthousiasme avec lequel elle a été accueillie parfois sans même être lue par un certain nombre de personnalités scientifiques et politiques – avec comme conséquence d’accréditer la théorie d’un complot dirigé contre la personne de Didier Raoult [6].
Bref il me semble que si pandémie a montré quelque chose, c’est l’urgence qu’il y a à cesser de prendre les sciences pour une sorte d’exception miraculeuse au milieu des pratiques humaines (et non-humaines). C’est par la manière singulière dont elles s’inscrivent dans ces pratiques que les sciences peuvent inspirer notre confiance. Mieux : c’est par la force avec laquelle de fait elles nous inspirent confiance qu’elles gagnent le droit de ne pas voir notre confiance leur être retirée dès qu’on constate à quel point elles sont fragiles, incertaines, mouvantes, finies, car c’est pour la même raison qu’elles sont aussi inventives, passionnantes et puissantes. Telle est une des grandes leçons latouriennes que nous n’avons pas encore assez méditée.
Mais le propos de Latour sur les sciences n’est pas le seul à avoir montré sa pertinence singulière à l’occasion de la pandémie. Un autre de ses arguments a trouvé une illustration particulièrement spectaculaire : le dépassement de l’opposition nature/société. Les deux gestes, au demeurant, sont liés, car dès lors qu’on a refusé de placer les sciences dans une position d’exceptionnalité radicale du fait de l’accès privilégié qu’elle nous donnerait à cette indifférente Nature en attente d’être décrite telle qu’elle est, dès lors qu’on les a replongées dans la bataille, dans les batailles et qu’on a fait de celles-ci le seul plan d’existence véritable où même les « vérités » peuvent s’établir, on a aussi renoncé à séparer comme deux domaines étanches la Nature d’un côté, indifférente au conflit, et la Culture de l’autre, lieu de la variation et du dissensus.
On sort alors de l’épistémologie pour entrer, avec Latour, dans l’ontologie. Le virus nous apprend quelque chose non plus sur la manière dont nous pouvons ou non prétendre connaître le monde, mais sur la manière même dont il est.
Cet article a été publié pour la première fois le 21 avril 2021 dans le quotidien AOC.
