Le risque dans les imaginaires médiatiques
En 1966, le territoire industriel rhodanien voit l’explosion de la raffinerie de Feyzin faire 18 morts, 98 blessés et des dégâts matériels qui touchent 1 475 habitations, jusqu’à Vienne, à 25 kilomètres au sud de Lyon. L’empreinte historique de cette catastrophe du 4 janvier 1966 établit, comme beaucoup de catastrophes industrielles, un lien très fort entre territoire, industrie et risque ; elle devient immédiatement une borne temporelle gravée dans l’opinion publique et dans les médias.
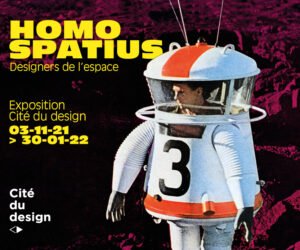
Pourtant, dans les années 1960-70, le « risque » n’existe pas en tant que catégorie dans les discours médiatiques ; le terme n’apparaît ainsi dans aucun des articles de presse parus entre 1966 et 1983, qui ne parlent pas de « risque », mais de « danger »[1]. La différence est importante puisque « le danger suppose l’existence d’une cause directe, en l’occurrence, une volonté adverse »[2] tandis que le risque est un danger « sans faute », uniquement soumis aux aléas (nécessairement incontrôlables) de ce qui pourrait advenir.
L’émergence tardive de la notion de risque
Dans les années 1980, la représentation du risque commence à apparaître avec, notamment, une publication (en décembre 1983) du magazine Ça m’intéresse qui imagine, dans un scénario-fiction, une catastrophe industrielle survenue dans le couloir de la chimie. Ce numéro est intéressant à double titre : il est le premier à proposer une représentation visuelle du couloir de la chimie au sud de Lyon et il est également le premier à utiliser le terme « risque ».
La fiction a été imaginée « avec la collaboration d’experts des problèmes de sécurité connaissant parfaitement la région et les risques qui la menacent » ; elle est construite à partir d’évènements passés – « les exemples de catastrophes passées le prouvent » – et le scénario, plausible, apparaît comme « un exemple de ce qui pourrait arriver » ou de ce qui « peut parfaitement se produire à Lyon. Ou ailleurs. » Le magazine mêle donc l’efficacité de la fiction e
