Covid-19 : la santé publique comme laboratoire du contrôle social
En participant au dispositif du contrôle social, la santé publique a délaissé sa prétention à la promotion de la santé[1] visant l’autonomie des acteurs, pour mieux maîtriser les conduites. L’octroi de capabilités a fait place à une instrumentalisation du choix social qui, en se normalisant au gré des décisions publiques, guide l’agent de manière diffuse, insidieuse et sans contradiction. Ce tournant laisse penser que l’autonomisation des acteurs de la santé et la défense des droits n’ont plus leur place dans l’application des normes sanitaires. Il faut au contraire réguler, inhiber et désinhiber les comportements en appareillant les individus de laissez-passer.
Qu’elle est la raison de ce changement de perspective ? Est-ce véritablement la population qui s’est écartée de la raison, en perdant confiance dans la science et les institutions ? Ou bien serait-ce plutôt les institutions qui ont perdu confiance dans l’autonomie de leurs administrés ? Alors que la complainte de la défiance s’amenuise et que plus de 50 millions de français sont vaccinés, le gouvernement réaffirme encore une fois sa visée comportementale aspirant à l’adaptation toujours plus astreinte des individus au milieu sociotechnique.
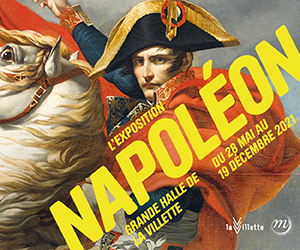
Cette conscience dirigiste de l’État est sans doute le signe d’une inquiétude concernant la population, ou pour le moins, celui d’une conviction dans le bien-fondé de sa mise sous tutelle. La défiance, quasi-continue depuis les gilets jaunes jusqu’aux anti-vaccins, aura sans doute conduit le gouvernement à la certitude que les politiques publiques doivent parvenir à maîtriser la conduite en instrumentalisant la raison et la science. À tel point qu’embarquées dans ce dispositif, les valeurs de la santé publique se sont vidées de leur sens.
Sommes-nous encore capables de trouver un équilibre entre le respect des droits de la personne et la protection de la santé collective ? Dans le contexte actuel, cela semble difficile à concevoir. En réduisant « l’acteur de la
