La « grande famille » des victimes des attentats du 13 novembre 2015
La Cour d’assises spécialement composée pour ce procès juge en ce moment vingt auteurs présumés des actes terroristes liés aux attentats commis à Paris le 13 novembre 2015. Durant cinq semaines (du 28 septembre au 29 octobre), plus de 300 parties civiles – sur les 2 400 constituées début novembre – ont témoigné devant elle en tant que victimes ou témoins directs de ces actes. D’autres le feront au printemps, en raison de leurs demandes plus tardives pour venir témoigner à ce procès. Cette participation est inédite : par le nombre de parties civiles mais aussi par leur statut, puisqu’elles sont venues dans l’enceinte judiciaire à la fois pour témoigner des faits et, de manière prévue et annoncée, pour produire un récit collectif de leurs souffrances.
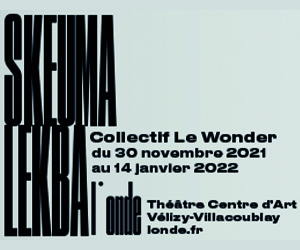
Les médias ont rendu compte de leurs dépositions sous l’angle des histoires singulières d’hommes et de femmes confrontés au surgissement d’une violence exceptionnelle. Les mots de certains d’entre eux, jugés les plus marquants, ont été reproduits parfois in extenso. Leur vécu avant, pendant, et surtout après l’attentat, a été évoqué. Leurs émotions et celles du public ont été décrites. Il existe une manière un peu différente de dire ce qui se passe au cours de ce procès : celle des sciences sociales, qui voient d’abord du social et du collectif, même dans l’émotion la plus singulière, et qui savent que tout n’est pas exceptionnel dans l’expérience de la violence politique et de ses suites.
Une équipe de chercheurs en sciences sociales observe la totalité des audiences, pour comprendre comment la justice française s’efforce de faire une place plus grande aux victimes, ce que cette présence massive fait aux pratiques judiciaires, et comment les victimes s’investissent ou non dans le procès. Nous comparons ce procès à d’autres traitant de violences politiques – celui des attentats de janvier 2015 à Paris, celui des attentats de Nice, bientôt, mais aussi des procès plus lointains, comme ceux menés en France contre
