Des faux débats au cœur de la campagne présidentielle
L’élection présidentielle de 2022 survient dans un moment particulier de notre histoire contemporaine. Des repères qui semblaient immuables s’effritent ; les innovations et les circulations s’accélèrent ; les crises, sociales comme écologiques, prennent une intensité inédite.
Dans une démocratie mature, les principales échéances électorales devraient être une occasion et un levier majeurs de mise en débat de ces mutations. Las, le début de la campagne présidentielle a été préempté par des idées reçues et des analyses caricaturales, en rupture avec l’idée que le « pays des Lumières » se fait de lui-même. Le diagnostic est partagé par l’ensemble de la presse européenne[1] : nos voisins dessinent le portrait d’une France qui n’a plus confiance en elle-même et où il est devenu impossible de (se) parler sereinement.
Les Français aspirent pourtant à des débats sérieux sur les nouveaux enjeux et les grandes options stratégiques qui pourraient permettre de redéfinir un avenir commun.
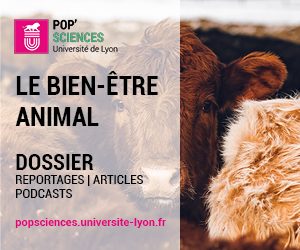
Un débat public « brutalisé » et rabougri
Or, le débat public est en permanence « brutalisé ». Sur les chaînes d’informations et les réseaux sociaux et, de plus en plus souvent, jusqu’au cœur même de la sphère privée[2], la discussion contradictoire est remplacée par l’invective, la controverse par la polémique, l’argumentation par le clash[3]. Plus que jamais auparavant, « nous étouffons parmi des gens qui pensent avoir absolument raison » (Albert Camus).
Cette atrophie de la pensée critique a laissé le champ libre aux grilles de lecture simplistes et outrancières. « France périphérique », « archipel français », « insécurité culturelle », « grand remplacement » : depuis une dizaine d’années, et alors même que la situation n’a jamais été aussi complexe, le champ politique est envahi de pseudo-concepts forgés sur la base d’essais vite écrits, agrémentés de quelques statistiques chocs mais dénués de toute rigueur méthodologique. Au gré de leurs stratégies électorales, les différents can
