Les médias sociaux feront-ils la présidentielle 2022 ?
« On parle sans cesse de consulter l’opinion publique ; c’est une intention fort louable, dont le résultat doit être fort utile au gouvernement et à la nation. Mais qu’est-ce que l’opinion publique ? Est-ce celle de ma coterie ? Est-ce celle du café du coin ? Est-ce en écoutant aux portes, en décachetant les lettres, qu’on apprendra ce que c’est ? Non. Quel est donc le moyen de savoir ce qu’elle veut, ce qu’elle craint ? De le savoir en tout temps, en toute circonstance, pour toute chose, pour ce qu’on fait, pour ce qu’on veut faire ? C’est d’établir un système d’informations combinées qui la prenne là où elle est, et la donne périodiquement telle qu’elle est. »
P.-L. Roederer, responsable de la Direction de l’esprit public. Lettre au Premier consul (1802). Cité par Jaume (1989), L’esprit jacobin et la démocratie
L’ancienneté de la citation ci-dessus atteste de la longue histoire des dispositifs de mesure de l’opinion, et des questions politiques que ces derniers soulèvent. Alors que la préoccupation pour l’opinion publique se fait pressante en ce début de XIXe siècle, le responsable de la Direction de l’esprit public, section du ministère de l’Intérieur spécialement destinée à sa mesure, met – à raison – l’accent sur les « systèmes d’information » par lesquels des matériaux épars, disséminés au sein d’une société, peuvent devenir, sous certaines conditions, « l’opinion publique » majuscule qui intéresse le gouvernement.
De l’enquête de police au sondage, en passant par le micro-trottoir, chaque dispositif inventé au fil du temps pour résoudre ce problème porte en lui une vision bien spécifique de ce qu’est l’acte d’opiner, des opinions qui comptent et de la manière dont celles-ci peuvent être agrégées. Aujourd’hui, la massification de l’expression sur les médias sociaux pose à nouveau cette question ancienne.
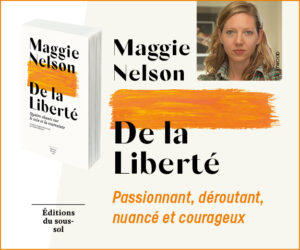
En facilitant la diffusion, l’agrégation et la mise en visibilité des opinions de tout un chacun dans l’espace public, les plateformes comme Twitter
