Retour sur le procès « hors norme » des attentats de janvier 2015
Aucun procès ne ressemble à un autre. Mais, lorsqu’il s’agit de procès pour terrorisme de masse et si l’on se donne la peine de regarder de près, on peut aisément remarquer quelques puissants invariants. Prenons l’exemple des attentats de janvier et de novembre 2015. Dans les deux cas les accusés sont jugés par des cours d’assises spécialement composées ; les procès sont qualifiés de « procès hors norme ». Rien que pour le procès du 13 novembre 2015 : 330 avocats dont environ 300 représentent les parties civiles et 1 765 personnes parties civiles d’une vingtaine de nationalités, un million de pages de dossier d’instruction qui compte 542 tomes, soit 53 mètres linéaires (l’équivalent d’un tiers de la hauteur du tribunal judiciaire de Paris).
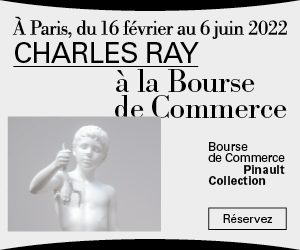
Dans les deux cas, pour des raisons de sécurité, le déploiement de la police et de la gendarmerie est impressionnant et les contrôles effectués pour accéder au palais de justice (Paris et Porte Clichy) sont extrêmement scrupuleux ; une salle d’audience principale et d’autres salles équipées de vidéotransmission sont mises à la disposition du public (accrédité ou non) et le procès est filmé ; des centaines de journalistes (français et étrangers) présents les jours d’audiences jugées les plus intéressantes ou les plus passionnantes ; la durée des procès : 3 mois pour le procès de janvier 2015, environ 6 mois pour le second, etc.
Arrêtons-là cette rapide présentation de quelques similitudes entre les deux procès. Celui des attentats de janvier 2015 est terminé (septembre-novembre 2020), l’autre, est en cours (septembre-mai 2022). Sur ce dernier, je m’abstiendrai de tout commentaire car il est loin d’être achevé et je ne pourrais pas mieux dire que celles et ceux qui ont chroniqué jusqu’alors chaque audience.
En revanche, je souhaiterais revenir sur le procès qui a eu lieu au tribunal judiciaire de la Porte de Clichy et en tirer, avec le recul, quelques enseignements sociologiques qui, à n’en point douter, se retrouveront,
