En finir avec le mythe des « deux Ukraines »
Le 24 février au matin, Vladimir Poutine a annoncé le début d’une « opération spéciale » visant à « démilitariser et dénazifier l’Ukraine », dans le but de « protéger le peuple sujet de l’agression et du génocide perpétrés par le régime de Kiev depuis huit ans ». Si l’opposition à l’extension de l’OTAN vers l’Est est un facteur important, c’est bien la « libération » du peuple ukrainien d’un pouvoir brutal et illégitime, argument central du discours politico-médiatique russe depuis la révolution de Maïdan[1], qui est mise en avant.
Après deux semaines d’intenses combats, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de cette guerre sur le plan militaire. Néanmoins, il semble que l’offensive russe se heurte à une résistance, non seulement de l’armée ukrainienne – bien équipée par ses alliés – mais aussi de la population. Même si elles ne disent pas l’ampleur de ce phénomène, de nombreuses images d’Ukrainiens insultant des soldats russes, tentant d’arrêter des colonnes de chars ou faisant la queue aux bureaux de recrutement militaire pour recevoir des armes ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias.
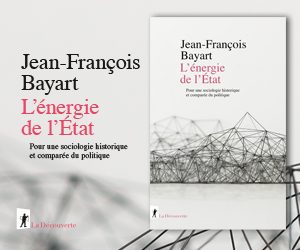
Les autorités russes avaient-elles anticipé cette réaction ? On peut raisonnablement penser qu’elles s’attendaient à moins d’opposition, surtout dans les régions orientales, comme à Kharkiv, deuxième ville du pays, où l’armée russe ne parvient pas à établir son contrôle. Les populations russes et russophones de l’Est du pays sont en effet fréquemment dépeintes, non seulement à Moscou mais aussi par bon nombre de médias occidentaux, comme attachées à la Russie et peu enclines à se battre pour la défense de la souveraineté de leur État.
Or, cette analyse se base sur une vision englobante et fixiste des identités politiques en Ukraine, et notamment de celles des Ukrainiens résidant dans les régions orientales et méridionales du pays.
Une observation fine des dynamiques internes à l’Ukraine depuis l’indépendance montre à l’inverse que cette fraction de la population – illustrée de manière idéaltypique par le président Volodymyr Zelensky, issu d’une famille juive russophone de Kryvyï Rih, grande ville industrielle du Centre-Est – a progressivement basculé dans une position ferme de défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, à partir de 2014. Bien plus que les « révolutions » successives qui ont émaillée la vie politique ukrainienne, ce sont les actions de Vladimir Poutine qui lui ont aliéné une grande partie de l’ « Ukraine de l’Est ».
Des divisions régionales surestimées
L’Ukraine indépendante est marquée par une grande diversité, héritée de l’histoire particulière de ses différents territoires. Alors que les régions orientales de Donetsk et Kharkiv ont été très précocement intégrées à l’Empire russe, la région de Kiev fut sous le contrôle de l’État polono-lituanien, avant de connaître un État cosaque indépendant au XVIIe siècle ; la Galicie, correspondant aux régions occidentales de Lviv, Ternopil et Ivano-Frankivsk, n’a jamais fait partie de l’Empire russe, passant de l’Autriche-Hongrie à la Pologne, avant d’être intégrée tardivement à l’Ukraine soviétique (1945).
Cette géohistoire complexe a produit des différences régionales notables en termes de structures économiques et sociales[2]. Les régions orientales, plus industrielles, ont gardé davantage de liens avec les pays de l’ex-URSS. La part des russophones et des personnes auto-identifiées comme « russes » y est supérieure à la moyenne nationale[3], et de nombreuses familles possèdent des membres en Russie.
La Galicie est une région bien plus rurale, marquée par l’importance de la pratique religieuse, de la langue ukrainienne et des mobilités de travail vers la Pologne. Les différences régionales se traduisent en termes de positionnement politique : le vote pour les candidats nationaux-démocrates et pro-européens est plus répandu à l’Ouest, tandis que les grandes villes de l’Est se sont davantage prononcées en faveur des élites postsoviétiques et du maintien des liens avec la Russie[4]. Le clivage concerne enfin le rapport au passé et à l’identité nationale : alors qu’en Galicie, l’époque soviétique est largement perçue comme une période de domination étrangère, les monuments à Lénine sont préservés dans de nombreuses villes de l’Est, dans les années 1990 et 2000.
Ces différences ont été instrumentalisées et renforcées dans des stratégies propres aux acteurs du champ politique ukrainien, au début des années 2000 : Viktor Iouchtchenko, leader du bloc national-libéral, et Viktor Ianoukovytch, chef du Parti des Régions, s’accusent mutuellement d’être des extrémistes, ne représentant que la Galicie ou que le Donbass[5], contribuant à consolider l’image de deux Ukraines irréconciliables. À partir du milieu des années 2000, la Russie joue également un rôle dans le renforcement de ces divisions, en présentant les régions de l’Est et du Sud de l’Ukraine comme appartenant à un « monde russe », basé sur une unité culturelle, linguistique et spirituelle[6].
L’issue de la révolution de Maïdan – fuite du président Ianoukovytch et vote par l’Assemblée de la suppression de la loi sur les langues régionales de 2012[7] – suscite des mouvements de rejet dans certaines localités du Sud et de l’Est de l’Ukraine. Ceux-ci aboutissent, en Crimée, à un vote du Parlement régional ouvrant la porte à l’annexion par la Russie. Cependant, dans les régions orientales et méridionales, présentées par Moscou comme une « Novorossiya » souhaitant un rattachement à la mère-patrie, l’agitation séparatiste ne prend pas[8]. Seule une partie des régions de Donetsk et Louhansk est prise. Kharkiv, Odessa, Dnipro et les autres grandes villes ne sont pas tombées, par manque de soutien au séparatisme de la part de la population et des élites politiques et économiques locales.
Les séparatistes et les Russes ont en effet surestimé les clivages régionaux en Ukraine, sur trois plans.
D’une part, le discours sur les « deux Ukraines » réifie un « Ouest » et un « Est », en leur attribuant les caractéristiques de villes emblématiques de ces divisions (Lviv, Donetsk). Or, en descendant à l’échelle régionale, on constate que Dnipro ou Zaporijia sont très différentes de Donetsk quant à leur histoire et leurs structures socio-économiques. À un niveau encore plus fin, le Donbass lui-même n’est pas homogène : le Nord de l’oblast de Louhansk, autour de Starobilsk, est bien plus rural et ukrainophone que le reste de la région.
Ensuite, d’autres facteurs complexifient les différences régionales. L’âge est peut-être le plus emblématique : toutes choses égales par ailleurs, les jeunes générations, nées et éduquées en Ukraine indépendante ont davantage d’aspirations européennes que leurs aînés.
Enfin, et c’est l’élément décisif, attachement à la Russie ne signifie pas volonté de remise en cause de l’unité nationale. Entre 2005 et 2014, la majorité des Ukrainiens du Sud et de l’Est se sont opposés à la politique des nationaux-libéraux, ont continué à se référer à bon nombre de mythes soviétiques, à entretenir une grande défiance vis-à-vis de l’UE et de l’OTAN, voire à s’auto-identifier comme « russes ». Pour autant, aucun mouvement séparatiste d’ampleur ne s’est développé dans ces régions.
Crimée et Donbass : ciments d’une nouvelle majorité pro-ukrainienne
Le basculement décisif de ces populations russophones de l’Est et du Sud de l’Ukraine dans le camp pro-ukrainien n’est pas fondamentalement lié à la révolution de Maïdan. Si l’événement déclencheur de celle-ci est le refus du président Ianoukovytch de signer l’accord d’association avec l’Union européenne, le 21 novembre 2013, ce sont les vagues de répressions successives qui font du « Maïdan » un mouvement de masse et dirigé vers des questions de politique intérieure : rétablissement de l’État de droit, fin de la corruption et, au fur et à mesure des violences, destitution du président[9].
L’enjeu du détachement de l’Ukraine de la sphère d’influence de la Russie est secondaire pour beaucoup de manifestants. Les manifestations de soutien au Maïdan organisées par la diaspora ukrainienne à Paris en offrent une bonne illustration. Alors que les membres historiques de la diaspora, descendants d’immigrés galiciens des années 1930 et 1940, étaient prompts à adopter une attitude de défiance voire d’hostilité vis-à-vis de la Russie, un grand nombre de jeunes Ukrainiens originaires de Kiev et des villes de l’Est souhaitait recentrer la mobilisation sur les questions de politique intérieure et bannir les slogans hostiles à la Russie et aux Russes[10].
Ce sont les événements postérieurs au Maïdan qui entraînent une large reconfiguration des positionnements politiques, et particulièrement de ceux des Ukrainiens de l’Est et du Sud. Le basculement d’une grande partie de ces derniers vers des positions pro-ukrainiennes se fait en plusieurs temps, de mars 2014 à février 2015.
L’annexion de la Crimée est d’abord un choc pour de nombreux Ukrainiens : la Russie, vue par beaucoup comme un pays ami, s’est emparée d’une partie du territoire national et menace l’Ukraine continentale. Cet événement entraîne une première vague d’engagement dans les bataillons de volontaires visant à défendre l’intégrité territoriale[11].
Le deuxième temps est celui de l’agitation séparatiste dans le Sud-Est de l’Ukraine. Des manifestations « anti-Maïdan », demandant l’autonomie voire le rattachement à la Russie, aboutissant dans certains cas à la prise de bâtiments administratifs. Alors que bon nombre de résidents de ces grandes villes orientales et méridionales se posaient peu la question de leur appartenance nationale, au vu des liens étroits qu’ils entretenaient avec la Russie, ils sont à présents poussés à se positionner pour ou contre le séparatisme.
Certains, touchés par les violences dont ont été victimes certains militants « anti-Maïdan » – comme à Odessa le 2 mai 2014[12] – radicalisent leurs positions pro-russes. Mais, hors de certaines localités du Donbass, la majorité des habitants se range autour de positions pro-ukrainiennes. À côté des mouvements ultranationalistes comme Azov ou Praviy Sektor, des mouvements d’autodéfense pro-ukrainiens se mettent en place à Kharkiv, Dnipro ou Zaporijia pour s’opposer aux manifestants pro-russes et défendre les points stratégiques. Ceux-ci sont souvent le fait d’individus entretenant un rapport distancié à la politique, voire une identification nationale floue, et qui étaient parfois sceptiques vis-à-vis de l’Euromaïdan.
Le dernier temps du basculement des Ukrainiens de l’Est vient avec l’intensification de la guerre du Donbass, à l’été 2014, et les premières évidences d’une intervention directe de la Russie, notamment lors de la très meurtrière[13] bataille d’Ilovaïsk (24-30 août)[14].
Les batailles de l’aéroport de Donetsk et de Debaltseve clivent de manière définitive la population. Une majorité d’Ukrainiens de l’Est (hors Donbass et Crimée) rejoint le reste du pays autour de positions pro-ukrainiennes, identifiant clairement la Russie comme partie directe ou indirecte au conflit. Une minorité se réfugie dans une position pro-russe claire, niant toute possibilité de réintégration du Donbass à l’Ukraine. La constitution d’une vaste majorité pro-ukrainienne, regroupant Ukrainiens de toutes régions, est visible dans l’émergence d’un grand mouvement d’engagement bénévole visant à équiper l’armée ukrainienne, prendre soin des militaires blessés et de leurs familles[15].
De profondes reconfigurations identitaires en huit ans de guerre
Les interventions directes et indirectes de la Russie en Ukraine au cours de l’année 2014 ont eu un impact majeur sur les identités politiques. Elles ont poussé un bon nombre d’Ukrainiens de l’Est à prendre rapidement et clairement position contre le séparatisme et à revendiquer leur appartenance à une nation ukrainienne au sens civique du terme, fondée sur la loyauté envers l’État et la non-remise en cause de l’intégrité territoriale. Mais la prolongation de l’occupation de la Crimée et de la guerre du Donbass a engendré une reconfiguration plus profonde des identifications nationales. Celle-ci se déploie à un rythme plus lent et touche plus inégalement les individus, mais elle n’a cessé de se renforcer au fil des huit années de guerre.
Il s’agit de l’adoption progressive par une fraction des Ukrainiens russophones de Kiev, de l’Est et du Sud d’une conception ethno-nationale de l’identité ukrainienne, traditionnellement cantonnée aux régions occidentales ou aux élites nationales-libérales.
Cette identité est basée sur un ensemble d’éléments, au premier rang desquels se trouve l’usage de la langue ukrainienne. Au cours de mes recherches, tant en Ukraine que dans l’immigration, j’ai rencontré de nombreux russophones qui étaient « passés » à l’ukrainien, dans la majorité de leurs interactions en dehors de la sphère intime et dans leur communication publique, sur les réseaux sociaux par exemple. Soutenu par une politique nationale et par les intellectuels, le mouvement d’ « ukrainisation » rencontre certes des résistances, mais gagne aussi un nombre conséquent de soutiens, notamment parmi les jeunes ayant grandi dans des familles russophones[16].
Ces reconfigurations identitaires touchent également au passé et aux symboles nationaux. Des références jusque-là cantonnées aux mouvements nationalistes ou aux régions occidentales, et perçues avec beaucoup de méfiance à l’Est, ont acquis une popularité notable dans l’ensemble du pays depuis le début de la guerre du Donbass. La figure de Stepan Bandera, tout comme les slogans et symboles[17] de l’Organisation des nationalistes ukrainiens[18], jusque-là facteurs de division, sont devenus des forces de rassemblement pour une grande partie des Ukrainiens[19].
Il faut toutefois garder à l’esprit que ces reconfigurations ethno-nationales suivent avec du retard les reconfigurations de l’identité civique ukrainienne. Par rapport à la masse des Ukrainiens russophones ayant exprimé sa fidélité à l’État ukrainien, le nombre de ceux ayant adopté ces référentiels ethno-nationaux est plus faible. Par exemple, l’attachement à la fête du 9 mai – commémorant la victoire soviétique dans la « Grande guerre patriotique » – est encore vivace, même chez ceux qui rejettent entièrement l’annexion de la Crimée et le séparatisme du Donbass.
Si l’action de la Russie depuis 2014 en est le catalyseur, cette identité ethno-nationale se diffuse sous l’effet de deux forces. D’une part, l’action de l’État : les gouvernements post-Maïdan ont mené des politiques d’ukrainisation et de décommunisation bien supérieures à celles de Viktor Iouchtchenko en son temps[20]. D’autre part, la socialisation par les pairs : celles et ceux qui ont participé de près ou de loin au conflit du Donbass (combattants, mais aussi bénévoles dans l’aide à l’armée ou aux civils) ont eu tendance à développer des positionnements patriotiques plus radicaux, qui ont infusé dans leur entourage. Le prestige acquis sur le champ de bataille ou dans le travail bénévole a donné aux « volontaires » une grande autorité morale au sein de la société ukrainienne.
Ces entrepreneurs politiques, qu’ils soient institutionnels ou non, ont construit l’idée que l’héritage russo-soviétique colonise le quotidien des Ukrainiens (pratique de la langue russe, appétence pour la littérature ou le cinéma russe, célébrations de fêtes soviétiques…) et que seule la diffusion de cette identité ethno-nationale permettra d’aboutir à la libération de l’Ukraine de l’influence de son voisin.
L’Ukraine définitivement perdue pour la Russie ?
Depuis 2014, la diffusion d’une identité civique, basée sur la loyauté envers l’État ukrainien, et d’une identité ethno-nationale ukrainienne, fondée sur la rupture totale avec le « monde russe », a donc fait perdre à la Russie de Poutine le peu de soutien qui pouvait lui rester en Ukraine, hors de la Crimée et du Donbass séparatiste.
À l’aune de cette analyse, l’invasion russe visant à « libérer » le « peuple frère » apparaît extrêmement aventureuse. L’armée russe, qui ne s’attendait pas à une telle résistance, est probablement touchée dans son moral ; les oppositions à la guerre de la part des Russes sont pour l’instant contrôlées, et ne menacent pas le pouvoir, mais jusqu’à quand ? Et en cas de victoire militaire, comment la Russie imposera-t-elle un régime fantoche à une population ukrainienne qui lui est largement hostile ? Pour les Ukrainiens, il est extrêmement délicat de prédire de quoi sera fait l’avenir. Mais il est probable que cette guerre cimente définitivement l’identité ethno-nationale en construction depuis huit ans.
