Faire famille, faire société – sur Madres paralelas de Pedro Almodovar
Qu’est-ce que faire famille ? Quelles configurations de relations, de filiations et de parenté sont autorisées à faire famille et légitimées comme telles dans nos sociétés européennes contemporaines ? Et en quoi les configurations conformes au faire famille conventionnel devraient-elles épouser les orientations politiques en matière de vivre-ensemble, de cohésion sociale, a fortiori dans une nation divisée par la mémoire encore fraîche de la guerre civile ?
Telles sont les questions posées par le dernier film perturbant de Pedro Almodovar, Madres paralelas articulé autour de la rencontre à la maternité de deux parturientes, mères célibataires, Janis et Anna. On ne connaît au départ que l’histoire de Janis : elle est tombée enceinte d’une liaison passagère avec Arturo, un anthropologue marié, membre d’une commission gouvernementale dédiée à l’exhumation des fosses communes de la guerre civile espagnole. Elle-même milite activement pour qu’une exhumation soit réalisée dans son village natal en Castilla-La-Mancha.
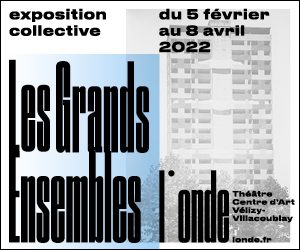
Plus tard, alors que l’enfant a quelques mois, Janis se rend compte que leurs bébés ont été échangés et qu’elle élève donc un enfant qui biologiquement n’est pas le sien. À la faveur du hasard qui fait se recroiser les jeunes mères, elles se rapprochent et Janis apprenant qu’Anna a perdu son enfant, lui propose de s’installer chez elle pour l’aider au quotidien et garder sa fille. Leur relation est tantôt maternelle (Janis jouant le rôle de mère de substitution pour Anna), tantôt sentimentale et sexuelle puisqu’elles deviennent amantes, tandis qu’Arturo opère au même moment un retour dans la vie de Janis. Cette dernière finit par avouer à Anna la vérité sur leurs filiations respectives. Anna, choquée, quitte immédiatement le foyer, emportant sa fille biologique avec elle.
Après une ellipse qui nous conduit au village natal de Janis, on apprend qu’Anna est de nouveau enceinte d’Arturo mais cette fois en couple avec lui. Ensemble, accompagnés par Anna et sa fille, ils organisent l’exhumation des restes humains des résistants du village. Le film se clôt sur le tableau des familles réunies : celles séparées par la guerre et les disparitions, et celles séparées par les ratés – plus ou moins ordinaires – de la vie : échange involontaire de bébés, manque de synchronicité entre deux partenaires amoureux conduisant à une naissance non assumée par le géniteur
Si Almodovar nous avait habitué.e.s au trouble que suscitent les modes hétérodoxes de faire famille et les relations affectives fluides et non-binaires qu’il dépeint constamment dans ses films, ce qui est perturbant dans Madres paralelas, c’est cette injonction à « rentrer dans l’ordre » au niveau de la sphère intime et microsociale, c’est-à-dire à se soumettre au primat du lien du sang et ce en écho à une politique mémorielle appelée à être mise en œuvre au niveau national, dans la sphère collective.
Par-delà la célébration des « magnifiques portraits de femme » ou d’ « odes à la maternité »
Il est frappant que la critique ait surtout – et comme toujours – loué la beauté de ces portraits de femmes devenus la marque de fabrique d’Almodovar, sans manquer d’indiquer également qu’il s’agissait là du film le plus politique du réalisateur espagnol qui, pour la première fois ici, aborde le passé de son pays et ses conséquences actuelles sur le faire-société[1]. Peu de critiques ont en revanche souligné l’intrication entre la sphère intime et collective[2]. Surtout, je n’ai lu que peu de critiques questionnant les enjeux sociaux et politiques des situations affectives spécifiques vécues par ces personnages féminins, par-delà la beauté de leur traitement esthétique à l’écran, le caractère attachant des personnages et la remarquable interprétation des actrices.
Qui sont donc ces femmes portraiturées dans Madres paralelas et que nous disent-elles de la relation à la maternité, au féminin et au féminisme ainsi qu’au faire famille, des femmes européennes à notre époque contemporaine?
Janis, interprétée par Penelope Cruz, est une quarantenaire célibataire, indépendante, qui peut s’enorgueillir d’une carrière installée de photographe et d’un statut socio-professionnel confortable. Elle est aussi une femme qui par ailleurs se bat pour le devoir de mémoire, pour une justice restaurative qui prendrait acte dans l’exhumation des fosses communes et la restitution des restes des aïeux disparus, fauchés par le pouvoir de Franco lors de la guerre civile. Une femme engagée dans le devenir sociopolitique de son pays et actrice de sa maternité survenue sur le tard, quand elle ne l’attendait plus, et qu’elle entreprend d’assumer seule. Janis est donc un personnage plutôt consensuel de notre modernité contemporaine, du moins en accord avec les sensibilités féministes actuelles.
Plus jeune d’une vingtaine d’années, Anna est un personnage plus classique de fille-mère, tombée enceinte suite à un viol et ballottée entre ses parents qui se la renvoient comme un fardeau encombrant. Lors de son accouchement, elle vit avec sa mère qui l’a toujours considérée comme un frein à sa carrière de comédienne de théâtre. De ce fait, elle trouvera en Janis une épaule maternelle protectrice en même temps qu’une amante désirable. Anna est donc un personnage de jeune adulte doublement blessée par la négligence de ses parents et par le deuil de son enfant, celui qu’elle a élevé dès sa naissance (et qui se trouve donc être l’enfant biologique de Janis).
Habitant pleinement son rôle de mère élevant son enfant sans père, puis fuyant sa famille qui ne la protège pas, Anna est un personnage qui cherche avant tout à trouver sa place. La maternité, le couple et le foyer qu’elle forme temporairement avec Janis et sa fille (au double sens de l’adjectif possessif), ainsi que l’indépendance financière recherchée, sont autant de voies pour parvenir à asseoir une version assumée d’elle-même.
Mais au-delà de la réussite évidente de ces incarnations féminines à l’écran, il me semble que se limiter à louer le portrait de femmes combattives et fortes, aimantées par l’amour maternel, au mépris des convenances et des rôles traditionnellement dévolus à la femme, empêche de percevoir combien les personnages se soumettent en réalité à l’ordre social.
Janis, en dépit des apparences et de la situation inaugurale qui est la sienne (mère célibataire quarantenaire s’apprêtant à assumer seule la charge d’un enfant non reconnu par son géniteur), est en fait celle qui va le plus « rentrer dans le rang ».
En restituant son enfant à sa mère biologique, Anna, et en rompant leur relation amoureuse du même geste, Janis opère un virage vers une normativité sociale qui s’accomplira entièrement par la suite : lors de sa grossesse vécue cette fois avec le père, dans le cadre donc d’un couple hétérosexuel légitime (entre temps, Arturo a quitté sa femme). Elle clôt aussi par là-même le cycle familial de femmes élevant leur enfant seule (puisque c’était aussi le cas de sa mère et de sa grand-mère), quand elle assumait au début fermement sa volonté de s’inscrire dans la continuité de cette lignée de femmes.
Pour caractériser le processus intérieur menant à ce dénouement, Almodovar parle du « dilemme moral » de Janis qu’il dépeint comme une femme déchirée entre sa volonté de dire la vérité à Anna au risque d’un chambardement inévitable de son existence, et la tentation de garder le secret pour maintenir le statu quo ainsi qu’une forme de confort. En effet, son enfant biologique à elle, élevé par Anna, étant décédé, c’est mue par un idéal de justice que Janis se résout à restituer son enfant biologique à Anna.
On sait le réalisateur profondément travaillé par la morale interrogée et mise à mal par le maintien du secret, par la dissimulation, y compris à des fins protectrices au nom desquelles agissent volontiers ses personnages. C’est par exemple tout l’enjeu de l’avant-dernier film du réalisateur, Julieta (2016) ainsi que de Todo sobre mi madre (1999) mais on retrouve ce motif dans bien d’autres de ses films, que l’on pense à Habla con ella (2002), La mala reputation (2004). Toutefois, ici en réalité, Janis apparaît davantage rongée par le doute quant à sa descendance puis saisie d’effroi lors de la prise de conscience vertigineuse que sa fille n’est pas son enfant biologique, que par le dilemme moral de le dire ou pas à Anna.
Loin d’un dilemme moral, il me semble que ce que révèle avant tout cette situation improbable fidèle aux intrications relationnelles minées dont Almodovar a le secret, c’est le non-questionnement, à aucun moment du film et par aucun des personnages, du primat du biologique dans la détermination de la parenté – ici de la maternité – autorisée et légitime. C’est moins au nom de la vérité (et donc de la morale) que Janis révèle l’histoire à Anna et la laisse lui retirer l’enfant, qu’au nom d’une loi apparaissant comme absolue et incontestable.
Le lien de parenté biologique est présenté comme indiscutablement souverain et dicte par conséquent les réactions respectives des personnages qui s’y inclinent, chacune depuis sa position. Anna, bouleversée et en colère, va, en un éclair, se draper de la toute-puissance maternelle qu’autorise automatiquement la révélation des liens du sang et exercer, sans que cela n’engendre de protestation chez une Janis prostrée de douleur, son instinct de propriété sur l’enfant qu’elle a uniquement porté et qui donc lui reviendrait de fait. Que cet instinct de propriété qui dérive de la loi de l’engendrement biologique/naturel (et la justifie) ne fasse pas un seul instant l’objet d’un questionnement, à minima d’une hésitation, vient interroger la nature même du lien de parenté.
Si Amandine Gay, réalisatrice et militante afro-féministe, dans son récent essai autobiographique sur l’adoption et le racisme, Une poupée en chocolat, rappelle que la conception de l’enfant comme propriété est consubstantiel de la conception de la famille en Occident et que « le statut particulier d’être “à soi” vient du fait que l’on a biologiquement engendré l’enfant »[3], il est néanmoins légitime de se demander comment un tel instinct peut être compatible avec la fondation de familles sur un modèle alternatif. En effet, ces familles sont de plus en plus nombreuses aujourd’hui en Europe à ne plus se construire à partir de cet unique modèle de l’engendrement naturel hétérosexuel dans le cadre d’un couple institué. La parenté repose alors sur des liens qui ne sont plus (plus exclusivement voire plus du tout) des liens du sang, que la filiation soit adoptive, ou biologique mais issue de la PMA.
En France, cette question des mutations contemporaines du faire famille, toujours brûlante, a été ravivée ces derniers mois par le vote presqu’à l’arraché de la loi PMA pour toutes[4], laquelle légifère sur la possibilité d’une parenté, certes issue d’un engendrement, mais qui est néanmoins parfois et souvent rendu possible par le don de gamètes. Ces situations (et leur banalisation progressive) devraient logiquement rendre caduques l’instinct de propriété comme la notion d’authenticité d’une filiation (le doute porté sur les « vrais » parents, ou les « vrais » enfants »).
Comme l’écrit Amandine Gay : « À l’heure de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples de lesbiennes en France, après des décennies de progression du nombre de familles monoparentales, recomposées ou LGBT (lesbiennes, gay, bies, trans), la persistance de la question des vrais parents ne s’explique que par l’absence d’une prise de conscience de la nécessité de déconstruire le mythe des “liens du sang” » (A. Gay, p. 56).
Déconstruire le mythe des liens du sang
C’est également le propos du sociologue Sébastien Roux dans son récent ouvrage Sang d’encre. Enquête sur la fin de l’adoption internationale (Paris, Vendémiaire, coll. Chroniques, 2022) qui analyse les facteurs historiques et politiques responsables d’une forme dominante (car érigée au rang de norme indiscutée) de moralisation de l’adoption internationale laquelle concourt in fine à sa fin. En valorisant prioritairement le maintien de l’enfant orphelin à proximité de sa famille de naissance et de son milieu d’origine, ou, lorsqu’il est adopté dans un pays lointain, le maintien souvent aussi artificiel qu’administratif et politique des liens le rattachant à son pays de naissance, l’éthopolitique contemporaine en matière d’adoption penche en fait – symboliquement a minima – du côté du sang et des origines.
Il y voit une manière de calquer le modèle classique de l’engendrement naturel, sans doute pour tâcher de pallier à ce qui est vécu comme un manquement nécessairement traumatisant : « Partout s’exprime la croyance que les familles sont préférables, plus solides ou plus bénéfiques aux enfants si elles s’adossent à la norme qui fait des géniteurs les parents “dans la mesure du possible” » conclut-il (p. 249).
Or, regrette-t-il, « c’était pourtant la force de l’adoption que d’affirmer la valeur d’autres alternatives et, surtout, de revendiquer pour elles une équivalence de traitement ; en dehors du gène, en dehors du sang, en dehors de l’utérus, en dehors du couple aussi, parfois » (p. 250).
La situation dépeinte par Almodovar aurait pu donner lieu à l’instauration officielle d’un lien adoptif : Janis serait alors demeurée la mère de Cecilia qu’elle a toujours été. Or, non seulement ce n’est pas la voie empruntée, mais le plus troublant est que cette soumission des personnages aux liens du sang est explicitement présentée en miroir de l’entreprise mémorielle endossée par le gouvernement sous l’impulsion de Janis et Arturo.
Le tableau final illustre parfaitement ce parallèle en donnant à voir les personnages principaux dans leurs nouvelles configurations familiales, dressés, graves et dignes, au pied des fosses communes découvertes dans le village de Janis. S’affiche alors à l’écran une citation du dramaturge uruguayen Eduardo Galeano qui clôt le film et en définit son sens de manière quasi-programmatique : « Il n’y a pas d’histoire silencieuse. Qu’on la brûle, qu’on la brise, qu’on raconte n’importe quoi dessus, l’histoire humaine refuse de se taire. »
Briser le silence pour mettre à nu la vérité, telle est la devise d’Almodovar en toutes choses. Qu’il s’agisse de la sphère intime ou de la sphère collective, il importe plus que tout de révéler les erreurs pour restaurer la justice (ou ce qui est perçu comme tel). Tout se passe donc comme si l’histoire intime de ces deux filiations non-conformes et non-conformistes ne pouvait être envisagée qu’à l’aune de la nécessité – au niveau sociétal – de retrouver les ossements pour renouer les familles déchirées par les pertes traumatisantes.
En dressant un parallèle non seulement entre ces deux femmes aux trajectoires de maternité en miroir, puis mêlées, mais aussi entre l’histoire intime de deux femmes et l’histoire de la société espagnole, Almodovar choisit en fait de lire la première au prisme de la seconde: ces filiations non-conformes devront, au terme du film, être résolues (renouées dans le dénouement) en rentrant dans un ordre social qu’est celui, présenté comme absolu et primordial, des lignées familiales nées de l’engendrement.
S’exprime ici une vision de la famille figée dans une construction idéologique que Lauren Berland qualifie de « fantasme de continuité de la famille », lequel « relie le passé historique à l’avenir par des chaînes de parenté établies dans des relations continues et harmonieuses » (Lauren Berlant, Desire/Love, Puctum Books, 2012, p. 44, citée par Eva Illouz dans La Fin de l’amour. Enquête sur un désarroi contemporain, p. 328).
Dans son essai sur les modèles alternatifs de faire-famille, Modern Families. Parents and Children in New Family Forms (Cambridge University Press, 2015), la psychologue britannique Susan Golombock pointe, elle aussi, la récurrence dans les médias de la crainte d’une rupture du lien entre passé et avenir qui serait causée par les mères solo par choix. Ainsi, seule la famille nucléaire née de l’engendrement naturel dans un couple hétérosexuel serait à même de garantir et préserver le contrat moral qu’une société passe avec elle-même entre son présent, son passé et son futur[5].
Dans une société encore traumatisée par les disparitions et le régime du secret (et du mensonge) de la dictature de Franco, Almodovar semble considérer que cet idéal absolu d’une chaine de continuité entre hier et demain est primordial, voire vital, pour le faire famille comme pour le faire société. Que les régimes de filiation doivent, par exigence de transparence et de justice, se conformer à la loi souveraine de l’engendrement naturel en respectant, autant que possible, les liens du sang. Et ce, au mépris de familles (re)composées autrement, depuis des millénaires, ces parents qui accueillent, adoptent, élèvent des enfants dont le patrimoine génétique est extérieur au leur. Mais c’est manifestement, pour Almodovar, à cette condition de soumission à un ordre traditionnel et familial défini par le biologique que le tissu social, déchiré par les traumas de la dictature, peut être réparé.
Ce dénouement que l’on pourrait qualifier d’étrangement conservateur (du moins par contraste avec les relations affectives et les configurations familiales présentées dans ses autres films) laisse songeuse. Ses mères parallèles auraient aussi pu être des mères aux trajectoires parallèles à la voie conventionnelle, c’est à dire des trajectoires résolument autres ne rejoignant jamais la trajectoire dominante normée. Or, plutôt que des lignes parallèles, ce sont des lignes convergentes que dessine Almodovar en exaltant la force du lignage. Marcher sur des chemins de traverse, resterait donc, même pour un réalisateur connu pour son avant-gardisme (emblème de la movida) une voie risquée et une entreprise irresponsable d’un point de vue politique ?
