L’édifice sacré de nos libertés peut-il résister à la crise écologique ?
Parfois obscurcie par certains effets du temps, la question de « l’impossible épuisement du sens[1] » de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC) demeure vive et actuelle. Élaborée dans l’incertain sillage des Lumières anglo-écossaises et de textes anglais majeurs comme l’Habeas Corpus de 1679 (« Que tu aies un corps… » : vaste programme…) et le Bill of Rights de 1689, cette Déclaration enregistrait et annonçait une mutation, une « rupture moderne ».
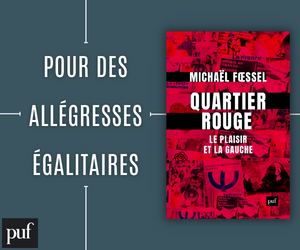
Près de 250 ans plus tard, elle est encore une fondation de l’édifice de nos droits et libertés. Arrimée au « bloc de constitutionnalité » par le Conseil constitutionnel à l’occasion de la décision « Liberté d’association » le 16 juillet 1971, elle sert de référence commode pour asseoir le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et, dans une certaine mesure, celle d’aller et de venir[2]. Tout a été écrit sur ce monument, mais quelques mots restent possibles à l’heure où l’exercice de droits et libertés dont la liste s’est copieusement enrichie depuis nous confronte aux inquiétudes grandissantes que charrient les questions sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles.
La matrice des grands textes politico-juridiques du temps avait évidemment quelque chose à voir avec la libération du nouveau « Sujet », trop longtemps enchaîné ou contraint du fait de l’arbitraire notamment engendré par l’absolutisme monarchique et par certaines conséquences inhérentes au phénomène religieux. Il est assez question, dans la Déclaration de 1789, d’un héritage de ce qu’être libre et « propriétaire de soi » (en un certain sens, peut-être, de la property lockienne) suppose et implique : liberté de conscience (on connaît l’importance de la consciousness dans les débats d’alors), liberté d’expression, garanties physiques contre des arrestations injustifiées, etc. La sûreté et la résistance à l’oppression y ont aussi leur place.
Pourtant, si les démocraties représentatives « pré-fossiles », en plein essor à la charnière de l’époque contemporaine et de la Révolution industrielle, prirent alors en charge certains intérêts (ce qu’atteste notamment la place des débats sur la propriété foncière autour de 1789), l’espace foisonnant des libertés économiques telles qu’elles se sont déployées depuis n’était pas encore au cœur des réflexions ou alors bien loin des termes actuels. En France en effet, la grande proclamation de 1789 est énoncée « en amont » des complexes phénomènes d’émancipation matérielle et de croissance qui, surtout à partir du XIXe siècle, contribueront largement à la nouvelle donne à laquelle s’abreuve aujourd’hui la « crise » écologique.
Il est troublant de constater que si la liberté d’entreprendre, et dans une mesure différente celles du commerce et de l’industrie, ont été ancrées par le juge constitutionnel français dans le texte de la DDHC (régulièrement depuis la décision du 16 janvier 1982 sur les nationalisations), elles le furent sur le fondement de son article 4, selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui[3] ». Cet ancrage « négatif », qui dans sa formulation textuelle n’a jamais changé, ne définit positivement rien. Il est en quelque sorte conçu comme un « vide à remplir », seulement délimité à la marge. Curieusement, ce « point aveugle » et cet « espace mou » renvoient bien plus clairement désormais à ce qu’une nouvelle typologie des droits et libertés devrait nous inciter à voir.
Si le sujet de l’écologie politique est, pour le juriste, traversé par les champs social et éthique, une première analyse, sous-tendue par les apports convergents de sciences hétérogènes à l’ère anthropocène, consisterait à identifier celles de nos libertés dont les modalités d’exercice contribuent au problème du point de vue de ce qu’on nomme parfois, dans une toute autre approche chère au droit administratif, « l’ordre matériel et extérieur ». Dans une très large mesure, les libertés fondatrices comme la liberté de conscience, d’expression, de réunion échapperaient alors à l’inventaire, tandis qu’une attention particulière devrait être portée aux libertés dont la substance et la finalité n’ont été saisies par le Droit qu’à travers la bordure ou par défaut. Seraient alors concernés, à l’extrême pointe d’exigences idéales, parmi nos droits, ceux dont la mise en œuvre a ou pourrait avoir, selon leurs modalités d’exercice, des effets physiques : à savoir le droit de propriété, les libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie et, dans une certaine mesure, la liberté d’aller et de venir.
L’esquisse d’une nouvelle typologie réorganisant notre conception des droits n’est plus seulement une élucubration[4]. Récemment, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, dans un arrêt du 29 avril 2021, mentionna, lors d’une condamnation partielle de l’État fédéral pour inaction climatique, « le poids relatif de l’exercice d’une liberté non neutre sur le plan climatique » (§ 120) et le fait que certains comportements « devront bientôt être sensiblement repensés » (§ 254). Un peu avant d’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg n’avait pas hésité pas à affirmer que « des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux, comme le droit de propriété, ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à la protection de l’environnement, en particulier lorsque l’État a légiféré en la matière[5] ».
Une attaque frontale de nos droits et libertés classiques, si profondément « intégrés » dans la culture occidentale, pourrait inquiéter. Cette sinistre démarche serait évidemment inappropriée aux yeux des amoureux des libertés (nous sommes nombreux) si les conditions générales de leur exercice n’avaient pas profondément muté depuis la Déclaration et si les fonctions essentielles du droit dont la DDHC semblait être porteuse avaient été respectées.
Or, dans les temps qui l’ont suivie et jusqu’à nos jours, plusieurs phénomènes au demeurant grandissants se sont conjugués : démographiquement, nous serons bientôt dix fois plus nombreux sur terre qu’au moment de la Révolution. Techniquement, alors que les orateurs de la Révolution française venaient à la tribune en calèche, les possibilités d’exercice des droits et libertés ici concernés ont été bouleversées par diverses évolutions, parmi lesquelles une certaine conception de la propriété privée, le capitalisme et les innovations technologiques ont joué et jouent plus encore un rôle majeur. Ces données complexes interagissent au demeurant étroitement avec de profondes mutations sociétales autour de la notion d’individu et de la « réalisation de soi ». Une vague intuition laisse entrevoir que cet ensemble, en dernière analyse justifié par des « habilitations juridiques implicites », ne pouvait qu’emporter des conséquences écologiques manifestes.
Parallèlement, justement, et comme en réaction aux effets non pensés et pourtant induits par cette première génération de droits, les systèmes juridiques libéraux se sont enrichis de nouvelles « couches géologiques » parmi lesquelles les droits sociaux (XIXe et XXe siècles) et les droits environnementaux (comme le droit à un environnement sain, largement constitutionnalisé dans le monde depuis 1970). Ils sont venus nourrir « l’humus originel », et rendent assez bien compte de ces réajustements juridiques des libertés les trois piliers désormais classiques du développement durable (économique, social, environnemental).
On notera également que le droit dominant, sans jamais en tirer toutes les conséquences, articule depuis fort longtemps[6], en une improbable alchimie d’ailleurs incomplètement théorisée, liberté et égalité. Ce couplage, à l’heure où un monde toujours plus fini et inégalitaire nous incite lourdement à repenser la notion même d’« égal accès », était aussi accompagné, au passage, d’une certaine promesse d’un bonheur partagé (le Préambule de la Déclaration de 1789 soulignait déjà les conditions d’un « maintien de la Constitution » et du « bonheur de tous »). Encore n’évoque-t-on ici qu’un petit nombre d’éléments ayant contribué à modifier profondément le paysage, chaque génération nouvelle de droits réagissant à l’existant. Les déclinaisons sociales et écologiques de la « solidarité » et la « dignité de la personne humaine » ajouteraient si besoin au panorama ici esquissé.
Certains aménagements classiques ont été mis en place, notamment par le droit lui-même, comme l’intérêt général, l’utilité publique, divers « arbitrages » et autres « conciliations libérales » ou « atteintes proportionnées » aux droits, pour faire tenir debout[7] ensemble des annonces porteuses de contradictions de plus en plus criantes. On ne percevait pas vraiment, au XIXe siècle (au-delà des effets de l’industrie sur la toux des riverains…) les difficultés à venir pour assurer simultanément la « prospérité du manufacturier », bientôt les droits sociaux et environnementaux, tout en réalisant « en même temps » l’engagement d’un bonheur universel, la dignité de tous et l’égal accès au(x) droit(s) dans un monde de plus en plus à la peine pour contenir notre expansion.
Le problème allait bientôt devenir d’autant plus massif qu’on a pris conscience du fait que les antagonismes ou les contradictions ne traversent pas seulement les relations entre le Nord et le Sud, les groupes sociaux différemment appréhendés qu’on se remettrait presque aujourd’hui à appeler « classes ». L’empilement, l’entassement même de ces proclamations juridiques discursives caractérise en effet l’individu lui-même ou chacun d’entre nous : l’entrepreneur de soi-même et dans le monde est également celui qui aspire à vivre dans un environnement de qualité, constat édifiant quand on sait qu’à maints égards, les conditions environnementales interagissent inéluctablement avec les droits et libertés.
Qui peut bien être le « Sujet » des droits de l’Homme ?
Bien souvent, ceux à qui on montre la lune regardent le doigt. L’énumération en liste ouverte des droits et libertés dans le contexte extrajuridique dynamique que l’on vient d’évoquer ferait presque oublier l’importance, aujourd’hui ressuscitée, d’une réflexion théorique sur le porteur, le lieu « réceptacle » de tous ces droits. La distorsion entre les signifiants, les « mots » du droit et les représentations sous-jacentes n’est pas nouvelle : on pouvait proclamer l’égalité et l’universalité au XVIIIe siècle et pourtant retrancher sans grand émoi du bénéfice des droits la moitié ou plus de l’humanité en la personne des femmes et de certains groupes humains. La question du détenteur des droits est aujourd’hui ravivée de mille manières.
D’une part, de nombreuses voix doctrinales, mobilisant un matériau épars, empruntent à l’écologie scientifique ou politique, à l’éthologie et à la biologie, à la philosophie autant qu’à l’anthropologie ou à l’ethnologie. Elles s’emploient à repenser « l’être détenteur des droits ». En première intention, une approche anthropocentrique renouvelée rejette la conception « individualiste » des droits de l’Homme au nom d’un universalisme concret et ancré (donc relativiste) mettant en avant, outre l’importance des (biens) Communs, nos dépendances et interdépendances, les solidarités objectives existant entre les humains et avec leur milieu de vie. Les droits et libertés y sont ainsi appréhendés à la lumière d’une nouvelle façon de « détenir » ou d’« être en situation de droit(s) ».
Le « Sujet de droit » est alors traversé d’interactions innombrables, rappelant vaguement les réseaux mycorhiziens et les relations symbiotiques ou rhizomatiques rencontrés dans le milieu naturel. De cet ancrage du porteur humain de droits, rejetant l’individu-sujet éthéré et abstrait au profit de l’être humain relié, rendent indirectement compte les deux premiers considérants du Préambule de la Charte française de l’environnement qui a complété notre édifice constitutionnel à la faveur d’une révision en 2005 : « Les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité » ; « L’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».
Il y a plus : d’autres mouvances, parfois entremêlées avec les premières, voisinant avec des considérations éthiques, s’inspirant de l’ancien autant qu’innovant pour le futur, suggèrent d’étendre une certaine façon de penser le « Sujet de droit(s) » en décentrant le regard. De manière à faire du vivant non-humain et même des conditions du vivant un nouveau et incertain « lieu d’attribution ». On peut ainsi reconnaître, dans des situations hétérogènes, les droits d’un fleuve, d’une forêt, d’une montagne, la « sensibilité animale », etc. C’est ce que commencent à faire certains États et quelques juridictions dans des contextes souvent bien précis où s’entrecroisent souvent des perspectives anthropocentriques et écocentriques.
Il est certainement souhaitable d’essayer de « penser comme une montagne » (Aldo Leopold), d’« être un chêne » (Laurent Tillon), d’« habiter en oiseau » (Vinciane Despret) et d’imaginer qu’à certains égards, les « Lumières », pour se rallumer et se parachever, doivent tendre vers des inclusions et dépassements multiples[8]. Le problème est celui de la signification que nous pouvons donner aujourd’hui à ces mouvements passionnants et variés.
Sont-ils le signe avant-coureur d’une redécouverte de rameaux desséchés d’un ancien humanisme inachevé qui se serait perdu en route ? Un peu comme sous la Révolution française sur ce point, ce qu’annonce progressivement et par tâtonnements le droit serait-il alors l’antichambre de ce qui adviendra ? Et si oui, quelque inventives que puissent être les normes, pétries d’artefacts et de fictions, quelles implications tirer, comment et jusqu’où, de ces tentatives d’inclusions « néo-holistiques » ?
L’interprétation qu’on peut en faire pourrait aussi nous raconter bien autre chose. S’agirait-il alors d’un renversement pré-nostalgique des « animaux-machines » faisant de la sensibilité animale et du vivant le refuge, l’ultime repli identitaire, par anticipation, d’une humanité qui se machinise, se robotise et se réifie en direction du non-vivant ? Faut-il y voir comme le « baroud d’honneur » d’une civilisation agonisante, profondément déformée et travaillée par un tsunami désormais continu de représentations de nous-mêmes télescopant frontalement ces propositions inclusives pourtant parfois sincèrement vécues ? À savoir, l’individu souverain, indéfiniment satisfait, arrimant le monde à lui, dans une perspective atomisée, profondément « facile » et virtuel. Des monades séparées les unes des autres et coupées de la nature d’une manière croissante, par leurs façons d’habiter, de travailler, de produire et consommer, communiquer et échanger. L’issue probable d’un tel choc des représentations du monde et de l’humanité est incertaine ; mais les rapports de force sont pour l’heure inégaux, tandis que s’impose désormais un combat dans le cadre duquel il convient de réinterroger le droit et ses fonctions.
Complexité des écosystèmes juridiques
Les tensions deviennent d’autant plus vives qu’il est en effet désormais apparent que le droit fonctionne (toujours plus) à la manière d’un écosystème. Le constat semble évident dès qu’on s’intéresse à ses implications matérielles dans un milieu fermé, clos, mais parallèlement hautement dynamique en raison de la globalisation et de la multiplication des productions et relations d’échanges de biens physiques qui se déploient dans le creux du droit. Il faudrait des livres pour rendre compte de ces phénomènes complexes, qui font interagir et se confronter les droits et libertés entre individus, groupes, nations, États, entreprises, et parfois au sein même de chaque entité abstraite comme de tout agent physique.
Cette complexité nous est d’autant moins accessible qu’elle est en réalité systémique, la pratique de certains droits pouvant entraîner des conséquences invasives, des effets rebonds, des rétroactions, sur et avec les autres droits ou les libertés d’autrui ainsi qu’avec l’environnement lui-même (climat, biodiversité et ressources naturelles en tête) dans des espaces-temps à géométrie variable, infiniment enchevêtrés. Notre perplexité est à son comble lorsqu’on comprend que ces éléments s’inscrivent à leur tour dans des échelles et circuits globaux, dans une économie tout à la fois segmentée, « filiarisée » et cependant mondialisée, mobilisant des technologies desquelles l’humain paraît de plus en plus souvent retranché.
Outre, alors, le risque d’une « réaliénation » que les courants techno-critiques ont régulièrement pointée[9], on note que les voyants environnementaux sont clairement « au rouge », avec la menace climatique d’une élévation des températures à bien plus de 1,5°[10], d’une érosion susceptible de glisser vers l’effondrement de la biodiversité[11], y compris en France[12], et la raréfaction spectaculaire des « ressources naturelles[13] » qu’illustre l’inquiétante évolution du jour du dépassement, ce moment où nous consommons davantage que ce que le « capital naturel » peut régénérer[14].
Ces phénomènes s’accélèrent aujourd’hui et emportent avec eux une « vulnérabilisation » des communautés humaines et des droits humains, qui à son tour… L’anthropisation du monde qui découle de la pratique de certaines libertés, par une partie seulement de la population d’ailleurs, fait qu’au tourniquet ou au loto des droits, selon votre naissance, « chacun attend son tour, chacun attend le châtiment de l’autre[15] ». Mais comme pour les « ressources virtuelles » en économie, les atteintes aux droits fondamentaux que certaines pratiques occasionnent à travers leurs conséquences environnementales semblent inexistantes ou infinitésimales, tant, souvent, les causalités sont diffuses, éparpillées et les conséquences trop lointaines dans l’espace ou le temps.
Ces effets escamotés sont rendus plus inaccessibles encore du fait que nous ne réfléchissons plus (ou mal, ou pas encore assez), individuellement et collectivement, à tout ce qu’implique ce qu’on estime être « notre droit ». Curieux « sujets de droit », finalement, autarciques souverains aliénés[16], que ceux qui déconnectent et découplent si aisément les suppositions et les conséquences de leurs actes alors que l’organisation économique et sociale presque autant que l’environnement les rend dépendants de tout. On comprend d’autant mieux un certain déni qu’à y regarder de près, de telles réflexions peuvent conduire à penser que toute appropriation privative, toute allée et venue et toute entreprise passent nécessairement par certains Communs et traversent les droits d’autrui. Au point qu’en contexte écologique tendu, les modalités d’exercice de nos droits économiques font en réalité imploser (si l’on prend la peine de conduire une analyse « physique » intégrale) le cadre libéral classique séparant le dedans et le dehors, le privé et le public, le singulier et le collectif, etc.
Fenêtres ouvertes sur les fonctions anthropologiques du droit
Un sentiment confus pourrait finir par naître, selon lequel la liberté des agents économiques (que nous sommes tous à des degrés variables) échappe bien souvent, dans le contexte globalisé et mondialisé actuel, aux fonctions structurantes et, pour le dire simplement, « anthropologiques » du droit. Qu’en tant que phénomène social, le jus ait vocation à régir les relations au sein du groupe auquel il s’adresse, à assurer une certaine forme de paix et de justice entre les êtres humains, une (certes toujours délicate) répartition des biens entre ses membres (le suum cuique tribuere parfois attribué à Cicéron est connu de tous) ne surprendra personne. La thématique d’une « cité juste » emporte avec elle la possibilité d’une vie prospère, épanouie, abondante dans la paix, à l’abri de la guerre, tandis que l’hybris et la démesure provoquent sa ruine[17].
Quant à la faculté du droit à énoncer des interdits, n’est-elle pas celle venant le plus immédiatement à l’esprit ? Des philosophes grecs jusqu’aux plus contemporains, seraient-ils si nombreux à avoir célébré la liberté illimitée du Sujet, sans conditions ni devoirs ou finalité, ou les répartitions grossièrement injustes des ressources ? Combien au contraire ont tenté de coupler pouvoir ou puissance, autonomie et indépendance avec limites, justice et responsabilité[18] ? Les fonctions premières du droit tel qu’il découle de l’Institution d’une société politique ne sont-elles pas évaporées lorsque la pratique des libertés qu’elle consacre ou reconnaît, passés les salutaires bienfaits individuels et collectifs dont leur exercice est porteur, contribue par addition et convergence à rendre certains, tous et peut-être finalement chacun plus vulnérables et à menacer en réalité toujours davantage l’exercice des droits d’autrui, de ceux d’après ou d’à côté et même les nôtres ?
Pourtant, le droit en tant que discours est bien à l’origine d’un cadre. Les grands textes juridiques libéraux étaient tous finalement porteurs de ces fonctions, de ces « limites fondatrices », même lorsque leurs auteurs n’imaginaient que confusément l’avenir. Évoquons quelques dispositions formellement significatives. L’article 4 de la DDHC interdit, nous l’avons dit, de nuire à autrui et pose aux droits de chacun des bornes assurant aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits mais aussi, doit-on supposer pour actualiser cet article encore valable aujourd’hui, d’autres droits qui seraient nés ultérieurement.
L’article 5 du même texte envisage l’interdiction d’actions « nuisibles à la Société » car, en réalité, la plupart des conventions instituant un corps politique proposent toujours autre chose qu’une simple juxtaposition d’individus en mouvement, tirant les conséquences logiques de ce que signifie « faire société ».
La Déclaration elle-même, d’ailleurs, insiste sur le fait qu’elle devait être constamment présente à l’esprit des membres du corps social, pour leur rappeler « sans cesse leurs droits et leurs devoirs ». On retrouve cette dialectique ou cette tension entre la liberté et le double cadre horizontal (autrui) et vertical (la Société) dans d’autres grands textes. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950 rend bien compte de cette structure classique. Elle associe à la plupart des droits consacrés des limites assumées d’une double nature. Son article 8, notamment relatif à la vie privée, justifie sans sourciller les ingérences qui, « dans une société démocratique », sont nécessaires pour la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la protection de la santé ou de la morale, celle des droits et libertés d’autrui (nous soulignons). On devine ici la multiplicité des modélisations possibles à partir des différentes relations horizontales (entre « mêmes ») et verticales (« la Société ») que peuvent nouer l’ensemble des droits et libertés et les questions écologiques ambiantes.
La relativisation intrinsèque plurielle, c’est-à-dire propre à chaque époque[19], des droits et libertés dès l’origine, s’est évidemment doublée des apports de considérations contemporaines parmi lesquelles la traduction juridique, la « prise en charge discursive » par le droit des questions écologiques au sens large devrait avoir vocation à jouer aujourd’hui un rôle déterminant. Le Préambule de la constitution « sociale » de 1946, lui aussi toujours en vigueur, proclama à sa manière son attachement à l’acquis de 1789 en l’approfondissant en raison des conditions qui rendaient les nouveaux droits « particulièrement nécessaires à notre temps » (considérant 2). Quant à l’adossement, en 2005, de la Charte de l’environnement à la Constitution, il s’est traduit par la reformulation de son Préambule actuellement en vigueur, à travers une synthèse qui reconnaît désormais l’égale valeur constitutionnelle des droits et libertés de 1789 et 1946 et des droits et devoirs contenus dans la Charte.
Aussi le carcan théorique qu’illustre le « bornage fondateur » de nos droits et libertés pourrait-il être aujourd’hui « rempli », « fourni en sens » par les nouveaux étagements juridiques nés des problèmes environnementaux, dont les « limites planétaires » constituent une délicate illustration aujourd’hui. Et ce d’autant plus aisément et logiquement qu’un environnement préservé est une condition a priori indispensable à l’exercice de l’ensemble des droits et libertés[20]. Les libertés économiques, à la lumière d’une lecture actualisée, pourraient être alors profondément corrigées par les droits sociaux, sous l’indispensable autant qu’incertain primat d’une fonction écologique d’ensemble.
Repolitiser un « droit-caution »
Une fois les classiques et souvent peu efficaces conciliations mises en œuvre, tant l’environnement en sort généralement perdant, peuvent en effet jaillir quelques interrogations. La faiblesse de la portée juridique réelle des dispositions suivantes du Préambule de notre Charte constitutionnelle de l’environnement est à trop d’égards édifiante, alors même qu’une valeur constitutionnelle leur a été reconnue par le Conseil constitutionnel[21] et qu’elles pourraient profondément réorienter l’exercice des libertés économiques, du fait du découplage suggéré et implicitement revendiqué entre besoins, épanouissement, progrès individuel et social et économie. Il est ainsi affirmé que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation et de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles » (considérant 5).
Parallèlement, l’assimilation de la recherche de la préservation de l’environnement à un « intérêt fondamental de la Nation » est reconnue (considérant 6), tandis que la satisfaction des besoins du présent est théoriquement limitée par ceux des générations futures et des peuples d’à côté (considérant 7), conformément, d’ailleurs, aux objectifs bien souvent oubliés du développement durable. À quoi assiste-t-on en effet ? Non seulement ces dispositions sont globalement plongées, sur le terrain contentieux, dans un assez profond sommeil[22], mais elles ne semblent surtout orienter que très marginalement les politiques publiques.
En lieu et place d’une hiérarchisation indispensable (certes difficile à imposer tant que les conditions ne sont pas réunies), on préfère toujours la transition éternellement retardée, un peu à la manière du « dernier verre » évoqué par Gilles Deleuze[23]. Si bien que pour quelques interdits techniques présents dans le Code de l’environnement ou quelques rares projets de grande ampleur stoppés (comme Notre-Dame-des-Landes ou Europa City), le prix à payer est… le reste, à savoir le substrat même de problèmes indéfiniment recommencés. Comme si, faute d’un saisissement politique à travers des choix assumés et justifiés pour l’heure hors de portée, le droit ne parvenait pas à inclure dans son champ d’intervention les causes profondes de ce à quoi il prétend réagir.
Pour l’heure, nous constatons, les bras croisés, un désajustement irréductible, un découplage grandissant entre les conditions matérielles, économiques et sociales de production du désordre écologique lato sensu et la manière dont le droit l’aborde, s’en empare et le traite. On voudrait nous rassurer par d’incontestables et heureuses avancées ponctuelles, souvent locales (plus qu’internationales), quand elles ne sont pas incomplètes ou irréalistes. Mais faute de parvenir à une intégration systémique, le droit est fondamentalement incantatoire quand il s’occupe d’environnement parce qu’il ne place fondamentalement pas sa réponse au juste endroit. On nous rétorquera, à juste titre d’ailleurs, que les conditions d’un traitement juridique des problèmes relèvent d’agencements différents, en raison de la variété des contraintes, selon qu’il s’agit de prévenir la pollution d’un sol sur un territoire déterminé ou de s’occuper des océans ou du climat.
Pour ceux qui s’y intéressent, on accordera alors que le droit de l’environnement est à ce jour un ensemble de rustines ponctuellement efficaces dans un océan de solutions qui, très essentiellement, négligent ou déplacent les problèmes ou ralentissent leur survenance au lieu de les résoudre. La croissance verte et son lot de technologies au service d’une ingénierie globale (agro-, bio-, géo-…) permettant le management du monde semblent être la réponse aujourd’hui dominante, en face de laquelle les alternatives repensant l’économie et le droit à l’aune d’autres paradigmes, notamment éthiques et sociaux, peinent à se faire entendre et même à exister. En cela, l’évaporation de l’arrière-plan anthropologique du droit, du fait d’une emprise « techno-économiciste » de l’agir dans le monde, est aujourd’hui source de difficultés majeures.
Retour au cadre
L’emprunt à la DDHC comme « moment » de l’institution juridique d’une communauté politique regroupant des sujets de droit « modernes » devrait nous parler. De révolution en redirection, il nous faut en effet, la mélodie est connue, refonder juridiquement le contrat social et réinventer l’indispensable médiateur, le Tiers (le droit y contribue et même parfois l’incarne) avec pour horizon l’écologie et les conditions d’un séjour harmonieux sur la Terre.
Sortir de l’état de nature en dépassant les tensions entre nature et culture est un impératif. Mais qu’il s’agisse des rapports entre les États dans le cadre des relations (plus que du droit…) internationales, d’une croyance dans la capacité du marché à réguler par de nouvelles gouvernances ce qu’on dérégule par ailleurs, ou même du comportement (lisez : de la pratique de leurs droits) d’agents dont Elon Musk et Jeff Bezos sont aujourd’hui des incarnations contemporaines abouties, c’est toujours et encore à une forme d’état de nature sans véritable « autonomie hétéronome » que nous avons à faire.
On les croit acteurs alors qu’ils (et nous) font signe. Par l’effet d’une structure « en miroir », Monsieur Bezos, en surplomb de la Terre et comme en apesanteur, part à la conquête de l’espace et promeut un tourisme spatial évidemment inégalitaire et inaccessible au plus grand nombre (dans le cadre de son entreprise Blue Origin). Tandis que sur Terre, Amazon nous éloigne toujours plus de l’ancrage attendu d’un « commerce » pas nécessairement doux d’ailleurs, mais, dans la tradition libérale, facteur de paix et reposant sur des relations humaines et physiques, des négociations et des régulations entre personnes réunies en un même lieu[24].
Le modèle de commerce virtualisé, sans visage, repose sur le fantasme d’une disponibilité absolue, totale, permanente, quasi-instantanée d’un monde-ressource, de ce qui facilitera, fluidifiera même la satisfaction de tout désir sans plus avoir à se déplacer. Et l’ubérisation des circuits d’acheminement permettra, une bonne fois pour toutes, l’assujettissement du monde et de l’humain aux caprices de l’individu-roi. Ce droit de tirage illimité, évidemment non universalisable et nécessitant au demeurant nombre d’esclaves, semble être la nouvelle promesse. Quant à Monsieur Musk, que certaines tares de notre humaine condition semblent déranger, outre les problèmes posés par les effets induits de la méga constellation Starlink, son implication majeure dans la transition énergétique, avec les automobiles électriques Tesla, est symptomatique d’une intelligence qui, confondant visiblement la transition des moyens (l’énergie) et celle des fins (l’avenir et les conditions du vivant), s’arrête confortablement « à la prise de courant » pour ne plus avoir à penser l’essentiel.
Ces deux individus, aujourd’hui les plus riches d’une planète qu’ils souhaitent simultanément dominer et fuir, siphonnent joyeusement les Communs, concentrant une force de frappe et un potentiel d’inflexion des représentations de l’être humain et de ses droits et libertés hors-norme et sans doute inédit. Assez peu préoccupés par l’idée d’un séjour équitable et harmonieux sur la Terre, leur position rappelle celle d’individus exclusivement animés par le jus omnium in omnia et l’amor sceleratus habendi, désormais en apesanteur et sans friction ni frottement. De telles « entités », on les retrouve parfois, en philosophie politique, errant dans un état de nature antépolitique dépourvu de lois positives. Leur manière de « persévérer dans l’être » se caractérise alors par une capacité à concentrer les pouvoirs (Musk et Bezos sont maîtres en cette matière), à se faire juges et parties de leur propre condition[25], oubliant ainsi l’absolue nécessité du « Tiers » qui interdit et par-là fonde, en psychanalyse comme en politique, un nouvel imaginaire collectif où l’altérité du monde et… d’autrui auraient toute leur place[26].
Tout converge aujourd’hui pour nous obliger à réfléchir autrement aux exigences d’un récit commun dans une « sphère » déterminée par des lois physico-chimiques et les règles complexes d’un monde vivant qui seront toujours plus difficiles à modifier que les normes juridiques. Pourtant, si la question est bien celle d’instituer l’écologie par et dans le droit, l’espace constitutionnel traditionnel, étatique, ne doit pas être interprété au-delà ce qu’il est. À savoir un moment et un lieu historiques de réaction à parfaire et dépasser, même si énoncer des valeurs (écologiques) communes et garantir les (donc limiter des) droits en séparant les (nouveaux) pouvoirs, au sens de l’article 16 de la Déclaration de 1789[27], n’est pas déraisonnable.
La question demeure entière de savoir quelles organisations institutionnelles, dans un cadre démocratique entièrement renouvelé (où l’« inter-diction » donnerait du sens aux limites consenties) peuvent être en mesure d’absorber le choc, de manière à ce que nos droits et libertés réinventés puissent se concrétiser dans un monde écologiquement et humainement viable et équilibré. Mais on comprend aussi pourquoi, sans préjuger des échelles auxquelles efficacement « instituer l’écologie dans le droit » (assise locale, persistance étatique, utopies régionale ou internationale), il est fondamental, pour en finir avec les malentendus de l’émancipation, de revenir à une certaine origine, c’est-à-dire à ce pourquoi fut pensée théoriquement la « séparation d’avec soi », médiation politique première, inaugurale. Elle le fut inconsciemment à partir de la crainte des effets d’une anomie lorsque, fuyant d’anciennes emprises, on se mit à penser l’Homme à partir de ce qu’autorisait à faire avec Descartes et Hobbes la méthode résolutive-compositive. Or, c’est bien dans cet état de nature anté- ou post-politique que semblent nous replonger tout à la fois certains reflux de la puissance étatique, l’émergence de nouvelles figures économiques (entrepreneuriales et subjectives) et la toute-puissance et la promesse illusoire d’un sujet sans entraves : le néolibéralisme. Tandis que la sûreté et la garantie des droits, objectif central des sociétés politiques, reculent en même temps que de nombreuses formes de séparations des pouvoirs qu’il conviendrait de restaurer.
Ou bien… ou bien…
Sous le titre d’un livre austère et beau publié par Søren Kierkegaard en 1843, parfois sous la traduction L’alternative, le philosophe nous invite à nous interroger sur deux modes de vie. Il présente le choix entre un style de vie régi par le désir individuel et sa satisfaction immédiate et sans bornes et une manière d’être inspirée par une conscience de la responsabilité invitant à se réaliser dans un « au-delà de soi ».
Politiquement, c’est-à-dire individuellement mais avant tout collectivement, nous sommes précisément confrontés à des options radicales aujourd’hui, à des échelles et sous des formes qu’il nous faut établir. Le défi est évidemment colossal. Mais on pourrait encore décider, c’est une autre possibilité, un brin cynique diront certains, de gommer de nos édifices normatifs tous les objectifs, les principes et les droits qui auraient dû nous conduire à domestiquer réellement l’économie capitalistique et sa course folle et à maîtriser ce qui mène à la dégradation du monde et au recul de ce qui nous rend humains ici. Un tel effacement nous éviterait peut-être la désagréable impression que le droit sert de caution dans un jeu de dupes et que les juristes sont, une fois encore, « les gardiens de l’hypocrisie collective[28] ».
