Extrêmes et socialisme
Rarement, sous la Cinquième République, l’élection d’un Président n’aura apporté un démenti aussi cinglant à ce qu’était sa volonté affichée. En 2017, fraichement élu, Emmanuel Macron nous promettait de « marcher ensemble » vers une société confiante et pacifiée : celle qui l’a réélu apparaît, plus que jamais, en proie au mal-être, à la violence latente et à une haine dont témoigne la banalisation en son sein d’un anti-macronisme tripal.
De même, le jeune Président, à l’époque, s’était solennellement engagé à ce qu’il n’y ait « plus aucune raison de voter pour les extrêmes » à la fin de son mandat : cinq ans plus tard, les votes extrêmes représentent plus d’un suffrage sur deux parmi ceux qui se sont exprimés lors du premier tour de l’élection présidentielle.
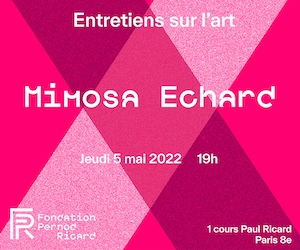
La cause de cet échec du macronisme à honorer ses ambitions doit être recherchée, d’abord, dans son déficit de socialisme, qui s’est traduit par une sous-estimation systématique des difficultés rencontrées par les services publics et conséquemment par leurs usagers, et par des manquements graves à la défense de l’État social – la situation, notamment à l’hôpital, à la justice et dans l’enseignement, et sur certains territoires plus encore que sur d’autres, n’ayant cessé de se dégrader. Seule, dans ce registre, la politique du « quoi qu’il en coûte » adoptée pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire aura été à la hauteur.
Cette politique, au demeurant, a prouvé que contrairement à certaines analyses, l’échec du macronisme à honorer ses ambitions ne saurait être imputé au caractère particulièrement défavorable des circonstances que le Président a dû affronter au cours de son mandat : en effet, c’est seulement la survenue d’une crise majeure – celle du Covid-19 – qui lui a donné l’impulsion de suspendre pour un temps son credo libéral et ainsi, de réaliser ce qui demeurera la meilleure action de son quinquennat : avoir épargné au pays un désastre économique et social.
Mais l’éche
