Le pass Culture à l’épreuve de la prescription
Avec le développement, puis la généralisation depuis une quinzaine d’années de l’éducation artistique et culturelle (EAC), le jeune public est devenu une cible privilégiée des politiques culturelles. Cet adressage aux plus jeunes et la volonté d’agir en priorité sur leurs pratiques culturelles expliquent sans doute la mise en avant de ce qui apparaît comme un des dispositifs majeurs du dernier quinquennat dans le domaine culturel : le pass Culture.
Le levier d’action central du dispositif consiste dans la mise à disposition d’un crédit permettant aux jeunes de moins de 18 ans d’accéder à des offres culturelles, espérant ce faisant favoriser chez elles et eux « l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des territoires ». Le recours à la gratuité de l’offre culturelle, financée par l’argent public, n’est pourtant pas une nouveauté et fait au contraire partie des moyens d’action les plus courants des politiques culturelles.
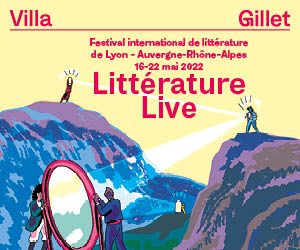
De nombreux débats ont d’ailleurs déjà eu lieu sur l’efficacité très relative de ce moyen d’action pour atteindre les objectifs visés – le plus souvent, il s’agissait de favoriser l’accès à des biens culturels jugés légitimes (les musées, notamment), dans une logique de démocratisation culturelle. À la différence de ces politiques tarifaires ciblant des offres spécifiques, le pass Culture entend rendre gratuites, et donc promouvoir, des consommations culturelles beaucoup plus diverses tant en matière de domaines culturels que de degrés de légitimité, pour « amener la culture » aux jeunes, intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles.
On peut mettre en rapport cette volonté politique avec ce que l’on sait sociologiquement des manières dont « la culture vient aux enfants ». Dans le cadre d’une recherche collective portant sur différents biens culturels de niveaux de légitimité variés (de la série télévisée à succès à l’édition jeunesse en passant par les musé
