Le service numérique et sa cuisine
Au milieu du XIXe siècle, Baudelaire écrivit que « l’industrie photographique », bénéficiaire d’un « universel engouement », était en passe de « supplanter et corrompre » l’art. Il vaudrait mieux, pensait-il, qu’elle « rentre dans son véritable devoir, qui est d’être la servante des sciences et des arts, mais la très-humble servante, comme l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé ni suppléé la littérature ». S’il était « permis » à la photographie, ajoutait-il, « de suppléer l’art dans quelques-unes de ses fonctions [et] (…) d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à nous ! »
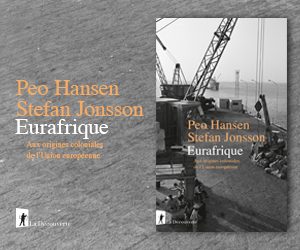
Quelle étrange proposition ! Si elle devait être vraie, alors nous qui sommes comme jamais ne furent nos ancêtres dans un monde de reproductibilité et qui, partant, utilisons sans cesse, et non sans goût pour cela, des dispositifs aptes à servir toute la culture du monde, nous devrions être certains d’avoir sauvé nos âmes. À vrai dire, le propos de Baudelaire, aussi bien intentionné et respectable fût-il, procédait d’une ambiguïté qui appartient toujours à notre temps. Cette ambiguïté concerne la notion même de service. Ou, pour reprendre avant de la discuter la formule du poète et critique, « l’humilité » requise de la « servante ».
En fait, une métaphore travaille sourdement mais puissamment nos pensées dans ce genre de sujet. C’est celle du maître servi par une double domesticité, l’une préparant la cuisine dans l’office ad hoc, l’autre servant la tablée. Les philosophes savent depuis Hegel quoi penser de cette maîtrise. Elle commande moins qu’elle ne croit, et peut être jouée ou retournée : le maître ou, pour être plus précis, celui qui peut être un temps supposé tel, n’est pas réellement dominant. Je traduis : la disposition effective du monde n’appartient pas à ceux qui sont servis. Soit, dit dans le vocabulaire et les circonstances d’aujourd’hui : est fausse l’idée qu
