L’Afrique au diapason de Vladimir Poutine ?
Hormis la déclaration initiale de l’ambassadeur du Kenya aux Nations unies, rappelant les bienfaits de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine qui avait entériné l’irréversibilité des frontières héritées de la colonisation, la plupart des États africains se sont réfugiés dans une position de non alignement ou de neutralité face à la guerre russo-ukrainienne, quand ils n’ont pas laissé poindre une certaine indulgence, voire sympathie, à l’égard de l’agresseur. Pis encore, les opinions publiques du continent africain leur ont emboîté le pas, pour autant que l’on puisse le savoir à travers les articles de presse et les réseaux sociaux.
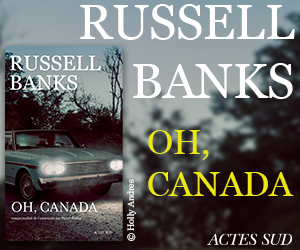
Les raisons de ce décalage entre les perceptions du conflit au sud du Sahara et celles qui prévalent en Europe ont vite été identifiées : indignation devant le « deux poids deux mesures » dont se seraient rendus coupables les Occidentaux supposés s’être montrés indifférents aux réfugiés d’Afrique et d’Asie et beaucoup plus généreux à l’égard des Ukrainiens (quitte à sous-estimer l’ampleur de la solidarité qu’ont déployée certains secteurs des sociétés européennes à l’égard des Syriens, des Afghans ou des migrants subsahariens, voire la chancelière allemande Angela Merkel) ; exaspération face à l’indéfectible soutien aux régimes autoritaires en place, nonobstant le prêchi-prêcha en faveur de la démocratie et de la « bonne gouvernance », et à la récurrence des interventions militaires ; sourde colère à l’encontre de la politique criminelle de prohibition de l’immigration mise en œuvre par l’Union européenne et le Royaume-Uni ; méconnaissance de la mémoire historique européenne et nord-américaine des Première et Seconde guerres mondiales ; présence, au sein des élites africaines, de générations de diplômés formés en Union soviétique, puis dans les Républiques post-soviétiques, et qui n’en gardent pas forcément un mauvais souvenir ; existence de liens anciens de coopération ou de luttes militantes anti-impérialistes remont
