L’échec constitutionnel chilien : genèse, lectures et leçons
Le travail de la Convention chilienne a soulevé des espoirs bien au-delà du Chili. De nombreux spécialistes en droit constitutionnel se sont penchés sur le berceau de ce nouveau processus qui naissait sous de bons augures. Tout d’abord, la violente explosion sociale de 2019, qui a duré cinq mois, jusqu’à l’arrivée du Covid-19, a été canalisée dans un processus constituant où toutes les forces politiques étaient représentées, ce qui n’est pas habituel en Amérique Latine.
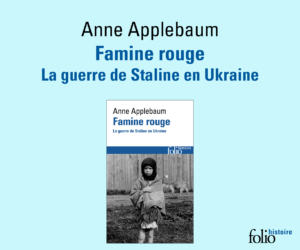
La parité hommes-femmes, ainsi que des sièges réservés aux peuples autochtones représentaient des innovations fortes. Une autre nouveauté a vu le jour, mais plus controversée : l’existence de listes d’indépendants, proposées par tous les partis politiques en 2020. Elle ne répondait pas à une demande des mouvements sociaux, mais exprimait plutôt la réaction des partis face à l’hostilité de l’opinion à leur endroit. Bien que néfaste du point de vue de la représentation politique, cette idée néo-corporatiste a été soutenue par divers mouvements sociaux et a permis à certains d’entre eux d’inscrire des listes de candidats avec un succès électoral certain (Joignant, 2021).
Le texte proposé par la Convention est considéré par de nombreux spécialistes comme une avancée sur le droit international dans au moins trois domaines : les droits des peuples autochtones, les droits des femmes et les droits associés à la protection de l’environnement. En effet, en plus du fait que le texte établissait de nouveaux droits sociaux, comme le droit au logement et une orientation marquée vers un système de sécurité sociale[1], les femmes allaient bénéficier du droit à l’IVG, supposé être constitutionnalisé, ainsi que de l’établissement de la parité au sein de l’État. Les peuples autochtones verraient reconnaître des droits d’autonomie et l’état d’urgence climatique serait décrété. Pourquoi la population chilienne a-t-elle rejeté le texte, alors qu’il semble apporter des réponses à ses doléances ? Revenons d’abord sur l’enchaînement politique et social des événements depuis 2019.
Du soulèvement social à la confusion politique
Le 18 octobre 2019 est reconnu comme la date de “mise en événement” (Boltanski et Esquerre, 2022) d’un ensemble d’expressions de mécontentement qui, pendant des mois, nourriront l’actualité chilienne. De manière inattendue, l’annonce de l’augmentation du prix du ticket de métro a mis le feu aux poudres : “No fueron 30 pesos, fueron 30 años” (“ce ne sont pas 30 pesos, mais 30 ans”), un parallèle hardi avec ce que furent les trente dernières années de vie politique, sociale et économique au Chili depuis la transition vers la démocratie en 1990, après 17 ans de dictature du général Pinochet (1973-1990). Le 18 octobre 2019, les lycéens occupent le métro et bloquent le passage des trains. Ils sont réprimés par les forces de l’ordre et les stations ferment à l’heure de pointe. Les habitants de la capitale sont obligés de rentrer à pied ou dans des bus bondés. Des émeutes éclatent, des stations de métro et des bâtiments sont incendiés et pillés. Le gouvernement perd le contrôle de la situation suite au caractère disruptif des manifestations (Somma, 2021), la violence s’étend dans les principales villes du pays[2].
Le ras-le-bol face à la précarité des conditions de vie est porteur d’une critique sociale radicale, aussi bien des limites de la transition vers la démocratie telle qu’elle a été conduite jusque-là, que des politiques des gouvernements de centre-gauche comme de centre-droit qui ont gouverné le pays pendant ces « trente glorieuses ». La gauche de la gauche (le Front Large ou Frente Amplio, nom calqué sur l’original uruguayen) leur reproche de ne pas avoir modifié les bases du modèle économique mis en place sous la dictature, en particulier la privatisation des services sociaux. En effet, le pays a connu une croissance économique sans précédent, mais les inégalités sociales n’ont décliné que très lentement, alors que l’élite concentre toujours les richesses. Le taux de pauvreté a baissé de manière spectaculaire, de 40% en 1990 à 11,6% en 2022. Cependant, la mobilité sociale est faible et les personnes qui en bénéficient restent vulnérables face aux aléas économiques comme la perte d’emploi, la maladie ou la sortie de la vie active. L’éducation supérieure se généralise, mais au prix d’une privatisation extrême et d’un fort endettement. Les indices de santé de la population s’améliorent, mais les familles paient les soins au prix fort, du fait de contrats individuels au détriment du principe de sécurité sociale et de solidarité. Ceux qui n’ont pas accès aux assurances privées doivent attendre que le système public les prenne en charge. Le régime privé des retraites est aussi sur la sellette, car la logique du rendement financier des contributions individuelles des fonds de pension se solde par des retraites en moyenne sous le taux de pauvreté.
C’est l’ambiguïté de ce bilan (Velasco, 2022 ; González et Le Foulon, 2020) avec ses avancées et ses limites qu’il faut prendre en compte pour expliquer le soulèvement du mois d’octobre 2019, mais aussi le résultat du referendum du 4 septembre 2022. Le ras-le-bol de 2019, comme beaucoup de mouvements sociaux similaires depuis le début des années 2000, ne propose pas de solutions claires ni de nouvelles idées notamment sur les questions sociales et identitaires, qui permettraient de redéfinir un pacte social d’ampleur. La surinterprétation des résultats électoraux par les partis politiques, en général dans le sens de leur agenda, brouille en partie les pistes. Par exemple, les partis de gauche contestataire (notamment le Parti communiste et une nouvelle gauche rassemblée dans le Front Large) y voient un élan refondateur du “peuple” qui “enterrera le néolibéralisme”. Mais quel peuple ? L’extrême-droite, notamment le nouveau parti Republicanos, largement influencé par Donald Trump et Jair Bolsonaro, voit dans l’explosion sociale l’installation de l’anomie dans le pays. Elle dénonce de manière acerbe l’avancée des droits identitaires de gauche (genre, ethnie, LGTBQ+) et le bafouement des droits de ce même peuple par une élite refondatrice de gauche philo communiste. L’un des problèmes de fond est que la plupart des partis ont perdu le lien avec leurs bases sociales et proposent des lectures à courte échéance qui favorisent leurs intérêts électoraux plutôt que la réponse aux demandes sociales de fond. Certes, on retrouve cette déconnexion à peu près partout, aussi bien dans les pays du nord que dans le sud, mais au Chili, la brèche est plus inquiétante, compte tenu du dissensus concernant la Constitution elle-même.
Pourquoi le Chili a-t-il cependant paru un nouveau laboratoire démocratique et participatif pendant les cinq mois de l’explosion sociale, et en quoi cela annonçait-il un processus constituant innovant ? L’ampleur des manifestations et la créativité des formes de contestation (les “répertoires” selon Tilly, 2006) étaient exceptionnelles et ont attiré l’intérêt des spécialistes de l’action collective (Joignant et Somma, sous presse). On note une forte présence des étudiants, des féministes et des femmes en général, des travailleurs et des retraités (lien : Observatoire des Conflits du Centre COES), mais aussi de formes d’organisation locale, les cabildos, espaces locaux délibératifs qui permettent de rédiger des cahiers de doléances et de poser les bases participatives des principes qui devraient dorénavant organiser la société. En outre, du point de vue institutionnel, après trois semaines d’émeutes, dans la nuit du 15 novembre 2019, la majorité des partis politiques a signé sous la pression de la rue un accord de sortie de crise : la mise en place d’un référendum pour canaliser le conflit en demandant aux Chiliens s’ils veulent un changement de Constitution. Cet accord a décomprimé la situation. Un référendum dit “d’entrée” avec vote volontaire a donc eu lieu le 25 octobre 2020, en pleine pandémie de COVID 19. Le résultat est catégorique : 78% des Chiliens approuvent alors le changement de Constitution au moyen d’une convention constituante composée de citoyens élus. Mais ceci, avec un taux de participation de 50,9% des électeurs (Morales Quiroga, 2021). Les résultats sont donc favorables aux yeux des tenants du changement, mais une moitié silencieuse de la population n’a pas participé à cet exercice démocratique.
Le balancier électoral, entre la Convention et les élections présidentielles
Huit mois plus tard, le 15 et 16 mai 2021, alors que la crise économique sévit et que la pandémie n’est pas encore jugulée, 155 conventionnels sont élus par vote volontaire, avec une abstention toujours en hausse, qui s’établit cette fois à 57%. La Convention ne remplace pas les pouvoirs en place, raison pour laquelle elle n’est pas nommée “assemblée constituante”[3] : les autres pouvoirs de l’État continuent en parallèle leur rôle traditionnel.
La composition de cette Convention est surprenante (Joignant, 2021). A la suite d’une décision institutionnelle adoptée par les députés et sénateurs, des candidats indépendants sont autorisés à se présenter sur des listes avec d’autres candidats indépendants. Il s’agit d’une anomalie électorale qui a permis l’élection d’individus et de groupes sur la base de motifs identitaires ou de la défense d’une cause particulière, en dehors de (et contre) la logique des partis, mal évalués depuis une vingtaine d’années. Il émerge de ce scrutin une assemblée largement orientée à gauche. La droite affronte une déroute colossale car elle obtient seulement 22% des voix, un chiffre très bas par rapport à son score habituel, qui est de l’ordre de 38%-40% aux élections législatives et locales depuis 1990. Mais cette dernière se ressaisit rapidement lors des élections présidentielles et législatives du 21 novembre 2021. Non seulement la droite retrouve son appui habituel, mais elle parvient à équilibrer le Congrès. En outre, son leader d’extrême-droite José Antonio Kast, qui l’a remporté sur le candidat indépendant de la droite traditionnelle issu des primaires, Sebastián Sichel, passe en tête du premier tour avec près de 28 % des voix. Il devance le candidat des diverses gauches Gabriel Boric, qui ne recueille que 25,8% des voix, alors que la participation est toujours en berne. Une autre mauvaise nouvelle est le score de 13,6% d’un candidat populiste, Franco Parisi, succès fondé sur un parti instrumental qui capitalise sur le mécontentement[4], phénomène qui n’est pas étranger aux résultats du référendum du 4 septembre 2022. Lors du deuxième tour, en décembre 2021, Gabriel Boric remporte finalement l’élection présidentielle, en particulier grâce aux votes des femmes, des jeunes et des quartiers populaires, mais aussi du soutien qui lui ont apporté les forces du centre-gauche, notamment le Parti socialiste, ce qui fait de ce second tour un cas unique : c’est en effet le premier cas où un candidat présidentiel d’une nouvelle gauche reçoit le soutien d’un parti socialiste.
Il s’agit aussi d’une situation très contradictoire : le Chili se révolte, soutient le changement institutionnel, puis semble se rétracter quelques mois plus tard avec l’avancée de la pandémie et de la crise économique, se retourne vers des candidats populistes et radicaux sur fond de forte abstention. Le pays aborde donc le plébiscite du 4 septembre 2022 dans un contexte bouillonnant, après un an de délibération de la Convention. Du fait de l’importance de l’enjeu, cette fois-ci le vote est obligatoire et les Chiliens se rendent massivement aux urnes.
Les résultats du référendum du 4 septembre 2022
Le résultat du plébiscite suscite de l’étonnement : avec 86% de participation électorale, 62% des Chiliens rejettent la proposition constitutionnelle. Toutes les régions du Chili votent majoritairement contre le nouveau texte malgré la prouesse de la Convention d’avoir travaillé à toute vapeur, avoir rempli son contrat d’émettre un texte en un an et de ne pas chercher à changer les règles du jeu en cours de route, ce qui est louable au vu d’autres expériences constituantes latinoaméricaines. Il est encore tôt pour connaître l’ensemble des facteurs et leur poids respectif dans l’explication des résultats, mais les quelques enquêtes menées dans les mois ou les jours précédant l’élection, ainsi qu’après le plébiscite permettent de mettre en lumière certains éléments.
Tout d’abord, les résultats sont sans appel. Lors du référendum du 4 septembre 2022, la participation électorale est proche de celle de l’élection présidentielle de 1989, la première après la dictature, à ceci près qu’en 1989 l’inscription sur les listes électorales était volontaire, avec vote obligatoire. La différence est cruciale : depuis 2012, l’inscription sur les listes électorales est automatique et le vote volontaire, un cas rare, ce qui s’est traduit par une très forte augmentation de l’abstention. Si avec le vote volontaire et l’inscription automatique le taux de participation était à peine de 50%, la combinaison de l’inscription automatique et du vote obligatoire est extrêmement vertueuse en termes de participation. Du fait de l’enjeu institutionnel et politique qu’implique un changement de Constitution, les forces politiques s’étaient mise d’accord pour que le référendum de ratification se fasse avec vote obligatoire. Le résultat a été catégorique, sa légitimité indiscutable.
Les territoires qui ont le plus voté contre le texte sont : les territoires ruraux, les moins connectés à internet, les plus religieux, habités majoritairement par les peuples autochtones, en particulier mapuche dans le sud, et les secteurs les plus pauvres. Cela montre une tendance de fond (Fernández et Guzmán, 2022). Le vote contre est aussi massif dans les secteurs les plus aisés. Il l’est aussi dans la plupart des communes de classe moyenne, ce qui est une autre surprise de ce scrutin. Ce n’est que dans une municipalité de classe moyenne relativement aisée de la capitale, Ñuñoa, que le vote pour le texte l’emporte de justesse. Loin d’être anecdotique, le vote des classes moyennes est révélateur des enjeux et des préférences de la population : la nouvelle gauche incarnée par le président Gabriel Boric, au pouvoir depuis mars 2022, semblait avoir fait un bastion électoral de ces communes gentrifiées, très éduquées, accoutumées aux discours cosmopolites et favorables aux enjeux identitaires de gauche (Joignant et Barozet, 2022). Or, le vote de rejet du texte a trouvé un large écho aussi bien dans les agglomérations populaires ou riches dans l’ensemble du pays que dans ce segment culturellement favorisé.
Les premières explications du résultat
Une fois le choc du résultat du 4 septembre passé, des interprétations ont été présentées à chaud par les acteurs politiques, et les membres de la Convention eux-mêmes. Dans un premier temps, dans la lignée des analyses qui ont suivi l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis en 2016 ou le référendum sur le Brexit la même année, on a reproché aux fake news d’avoir créé une distorsion de la réception du texte auprès de l’opinion publique, avec l’argument que « les gens sont bêtes ». Le rôle délétère des fake news sur la démocratie n’étant pas encore bien connu, le débat violent dans les réseaux sociaux (Scherman et Rivera, 2021 ; Luna, Toro et Valenzuela, 2022), les attaques ad hominem et l’exacerbation des peurs ne peuvent évidemment pas faire l’économie d’une réflexion sur la manipulation de l’information. Mais en même temps, l’ampleur du résultat en faveur du rejet n’est pas dû fondamentalement à cette explication.
Y-a-t-il toujours un retour de bâton après des révoltes populaires ? On peut chercher des explications dans d’autres moments de l’histoire, et dans d’autres pays, par exemple en France à la suite de mai 68 : c’est l’hypothèse bien connue de restauration conservatrice. Le Chili reviendrait-il donc à droite après un brusque coup de timon vers la gauche en 2019 et 2020 ? Tout porte à croire que l’esprit de rupture des des émeutes de 2019 n’a pas trouvé d’écho électoral lors de ce referendum de clôture du processus constituant. Ce qui s’est passé depuis octobre 2019 a largement été sur-interprété, depuis la volonté du « peuple vertueux » de 2019 jusqu’au « peuple ignorant » ou « trompé » qui a rejeté la proposition de texte constitutionnel. Ces interprétations font d’ailleurs l’économie du fait qu’une partie du vote est pragmatique, en particulier au sein des classes moyennes fragilisées. Le soutien de cette partie de la population aux gouvernements se fonde plus sur la stabilité ou l’amélioration du niveau de vie offerte aux familles que sur des propositions idéologiques (Barozet et Espinoza, 2016).
Au-delà de ces premiers arguments « à chaud », d’autres sont à prendre en compte, mais il n’existe pas d’explication simple des résultats du référendum du 4 septembre 2022. Plusieurs causes s’entremêlent, sur plusieurs plans, en particulier économiques et politiques. Tout d’abord, sur le plan économique le Chili est en crise depuis longtemps et ceci a fortement pesé dans le vote contre le texte, qui n’offrait pas de réponse sur ces questions immédiates, même si cela n’était pas son rôle. Cette crise économique est doublée d’une explosion de la violence avec armes lourdes, phénomène que le Chili n’avait pas connu jusqu’alors, contrairement à certains de ses voisins latinoaméricains ou caribéens. L’insécurité s’est répandue, alimentée par une double crise migratoire dans l’ensemble du pays et de sécurité dans la zone mapuche, le plus important peuple autochtone du Chili. Finalement, la crise climatique est aussi présente. Cette crise multiforme, qui requiert sans aucun doute des innovations institutionnelles et de politiques publiques, a mis au jour des incertitudes multiples au sein de la population et une forte peur face au changement. Le nouveau texte proposait bien certaines solutions de long terme, mais les solutions proposées ont paru trop éloignées des préoccupations de la vie quotidienne.
Les problèmes de la Convention
En ce qui concerne le travail de la Convention, l’ordre choisi n’a pas non plus aidé la population à intérioriser le processus. Occupée d’abord et logiquement par l’élaboration de son règlement, la Convention a commencé à travailler tard sur les droits fondamentaux, ayant peu de temps pour les faire connaître auprès de la population. Cette dernière, plutôt favorable à la Convention avant son installation le 4 juillet 2021, commence à perdre à la fois confiance et intérêt vers le mois d’avril 2022, les premiers sondages montrant à cette date une tendance fortement ascendante des opinions négatives. La Convention perd donc le soutien de la population quatre mois avant la fin de ses travaux, le 4 juillet 2022.
Concrètement, les débats sur les droits fondamentaux, qui renvoient à un horizon plus lointain, ont commencé à perdre leur importance face aux besoins immédiats de la population, exacerbés par la crise et sans possibilité d’expression auprès des membres de la Convention, qui ont dû rogner sur les semaines de travail et les séjours sur le terrain dans les circonscriptions pour finir le texte dans les délais, alors qu’ils faisaient déjà face à des journées de travail exténuantes. Dans ce contexte, interpréter ce que veut un « peuple » auquel tous les membres de la Convention font appel, mais qui est extrêmement fragmenté et changeant, devient un exercice difficile, surtout pour les collectifs qui représentent des bases étroites.
Du point de vue de la recherche de solutions participatives ou les innovations constituantes mises en place par la Convention, ces dernières n’ont pas convaincu ou n’ont pas réussi à faire remonter les inquiétudes de l’opinion publique. Tout d’abord la présence d’indépendants au sein de la Convention a rapidement montré ses limites, en raison du manque de discipline entre ses membres, ainsi que l’affichage personnel dans les médias ou les réseaux sociaux. Trois faits sont à retenir dans ce domaine. Tout d’abord les errances d’une des listes emblématiques d’indépendants, la « Liste du Peuple », en particulier le fait qu’un de ses candidats phare se soit fait passer pour malade du cancer alors qu’il ne l’était pas. La découverte de ce mensonge a retiré dès le départ non seulement à ce groupe politique mais à l’ensemble de la Convention son aura de supériorité morale. Ensuite, l’inscription à l’élection à la présidence de la République d’un candidat de cette mouvance avec de fausses signatures a plombé les ambitions des représentant du « peuple ». Finalement la dissolution des groupes de conventionnels indépendants du fait de conflits internes a mis un coup d’arrêt à cette forme non conventionnelle de représentation politique. Au-delà des indépendants, les partis de gauche n’ont pas non plus su lire ce qu’attendait la population.
Il existe aussi d’autres points critiques concernant le texte de nouvelle Constitution. Le document est long, détaillé et la campagne de communication de la Convention fut courte et limitée. D’autre part, certains points du texte ont été au centre de la polémique durant toute la durée des débats, comme le droit d’expropriation de la part de l’État, ainsi que le statut de la propriété privée des biens et des revenus. Le point le plus controversé reste cependant les droits des peuples autochtones. L’élection de représentants des peuples autochtones sur des listes séparées, avec 17 sièges, avait déjà été un point d’achoppement avant l’élection de la Convention, du fait que ces sièges représentent plus du point de vue démographique que la population autochtone (12,8% selon le recensement de 2017).
Toutefois, c’est le principe de pluri-nationalité qui sera l’un des points les plus polémiques et sans doute l’un des moins bien expliqués auprès de la population. La pluri-nationalité est un concept juridique qui reconnaît l’existence de plusieurs nations au sein d’un État et leur donne une certaine autonomie. L’interculturalité, qui se réfère aux mécanismes qui permettent de gérer les différences entre nations et cultures dans tous les domaines, en revanche, a fait nettement moins de vagues dans les débats. Bien que d’autres pays aient adopté la pluri-nationalité, comme les États-Unis, la Nouvelle Zélande, la Bolivie ou l’Équateur, des critiques ont émergé, en particulier autour du risque de rupture de l’unité nationale face au pluralisme juridique. Ce point est l’un des principaux facteurs qui explique le vote du 4 septembre (Bargsted, 2022). Dans les zones rurales et dans le sud du pays, pour les petits exploitants agricoles, la peur de la perte de leurs terres à des fins de restitution aux peuples autochtones a certainement joué un rôle.
Quel avenir pour la question constitutionnelle au Chili et quelles leçons en tirer ?
Un peu plus d’un mois après les résultats du référendum, les partis ne sont toujours pas arrivés à un accord sur la suite à leur donner. Bien qu’une partie de la droite ait fait campagne en promettant un nouveau processus pour élaborer un autre texte plus conforme à ses intérêts, l’extrême-droite signale maintenant que cela ne l’a jamais intéressée. Les autres partis se débattent entre différentes alternatives, alors que la gauche de la gauche est encore déboussolée par la défaite.
En ce qui concerne les leçons à tirer, il est important de prendre en compte les effets d’illusion optique qui se produisent au moment d’événements politiques importants, ainsi que les interprétations que l’on en donne, comme le soulèvement social de 2019, dont les conséquences politiques se font toujours sentir trois ans plus tard – sans réponse pour l’instant. La gauche ainsi que la gauche de la gauche ont voulu y voir une possibilité de refondation politique et économique, qui n’a pas eu l’écho attendu au sein de la population sur le moyen terme. Mais il y a aussi de puissants effets optiques au cours des campagnes électorales et dans les médias : le 1 septembre 2022, trois jours avant le referendum, les adhérents au nouveau texte constitutionnel réunissaient 500 000 personnes à Santiago pour la soirée de clôture, face à quelques milliers de personnes participant à l’acte de clôture de l’option rejet[5]. Malgré cela, le non est massif, du fait de la majorité silencieuse issue du vote obligatoire.
D’autre part, la Convention chilienne n’a pas échappé à la crise de la représentation dont elle est issue et qu’elle devait résoudre. Comment réenchanter les citoyens avec la politique et la prise de décision si l’organe par excellence, une Convention citoyenne, née sous des augures favorables, n’a pas trouvé une formule a minima pour proposer un pacte social acceptable pour la population ? Ni les mécanismes de participation, ni la campagne de communication n’ont permis de construire un texte dans lequel la majorité de la population se reconnaisse.
Finalement, l’hypothèse de l’échec des « politiques identitaires » dans leur acception de gauche est sur la table : était-ce aller trop vite de proposer à la fois une Constitution qui déclare l’urgence climatique, des droits avancés pour les peuples autochtones, les femmes, les minorités, des droits sociaux amples, tout cela simultanément alors que l’État peine depuis longtemps à financer les droits déjà existants ? C’est en effet une tension mal gérée entre les ces droits présentés par la droite comme des particularismes et par la gauche comme de nouveaux universalismes qui n’a pas pu être résolue de manière consensuelle tout au long du travail de la Convention. Cette rupture explique en partie les contradictions aussi bien du processus constituant que le rejet du nouveau texte.
Références :
Bargsted, Matías, “El as bajo la manga de los derechos sociales no generó un empuje hacia el Apruebo”, La Segunda, 12 de septiembre de 2022 2022-09-12 | Conversación : Pág. 14 (lasegunda.com)
Barozet, Emmanuelle et Espinoza, Vicente (2016), “Current Issues on the Political Representation of Middle Classes in Chile”, Latin American Politics.
Boltanski, Luc et Esquerre, Arnaud (2022) Qu’est-ce que l’actualité politique ? Événements et opinions au XXIe siècle. Paris, Gallimard.
Fernández, Miguel Ángel et Eugenio Guzmán (2022), Resultados Plebiscito 2022. Análisis comunal sobre decisión de voto y participación, Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo, 5 septembre 2022.
González, Ricardo et Carmen Le Foulon, “The 2019-2020 Chilean Protests: a First Look at their Causes and Participants”, International Journal of Sociology, 2020.
Joignant, Alfredo, “La fin des militants ? Leçons du laboratoire chilien”, Revue AOC [Analyse, Opinion, Critique], 2 juin 2021.
Joignant, Alfredo et Emmanuelle Barozet, “L’élection de Gabriel Boric au Chili, porte de sortie du néolibéralisme”, Revue AOC [Analyse, Opinion, Critique], 5 janvier 2022.
Joignant, Alfredo et Nicolás Somma (éds), Social Protest and Conflict in Radical Neoliberalism: Chile, 2008-2020 (sous presse).
Luna, Juan Pablo; Sergio Toro et Sebastián Valenzuela, “Amplifiying Counter-Public Spheres on Social Media: News Sharing of Alternative Versus Traditional Media After the 2019 Chilean Uprising”, Social Media + Society, janvier-mars 2022, p.1-11.
Morales Quiroga, Mauricio, “Chile’s Perfect Storm: Social Upheaval, Covid-19 and the Constitutional Referendum”, Contemporary Social Science, 2021.
Scherman, Andrés et Sebastián Rivera, “Social Media Use and Pathways to Protest Participation: Evidence from the 2019 Chilean Social Outburst”, Social Media + Society, octobre-décembre 2021, p.1-13.
Somma, Nicolas M.; Matías Bargsted; Rodolfo Disi et Rodrigo M. Medel, “No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019-2020”, Social Movement Studies, 2020.
Somma, Nicolas M., “Power Cages and the October 2019 Uprising in Chile”, Social Identities, 2021.
Somma, Nicolas M., “Social Protests, Neoliberalism and Democratic Institutions in Chile”, Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 2022.
Tilly, Charles, Regimes and Repertoires. Chicago: The University of Chicago Press, 2006.
Velasco, Andrés, “The Change Chilean Really Want. Why They Rejected a Proposed Constitution”, Foreign Affairs, 28 septembre 2022.
