La santé mentale des enfants, entre inclusion et répression
En marge des discours politiques et médiatiques sur la crise du recrutement des enseignants, deux annonces officielles ont marqué la rentrée des classes 2022. Le 28 août paraissait un rapport dans lequel la Défenseure des droits dénonçait les insuffisances de l’accueil des enfants handicapés à l’école, jugé encore loin d’être « réellement inclusi[f] et sans discrimination ». Trois jours plus tard, le Président de la République adressait aux élèves de notre pays un message martial contre le harcèlement, assurant qu’« on ne laissera[it] plus faire » les auteurs de « ces insultes, ces menaces, ces injures » proférées à l’école.
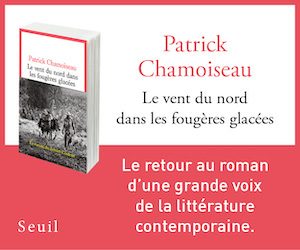
Participation sociale des personnes handicapées, protection contre les violences : ces promesses légitimes de l’État républicain constituent aussi deux bornes contemporaines d’une problématique qui traverse l’ensemble des institutions en charge des enfants et des adolescents, celle de leur santé mentale. L’inclusion scolaire est ainsi au cœur des politiques publiques actuelles en matière de pédopsychiatrie, telles que la « Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement » promulguée en 2018, tandis que la question des violences, notamment sexuelles, occupe le devant de la scène médiatique et se trouve également portée au plus haut niveau de la représentation nationale.
De manière compréhensible, l’attention publique se tourne en priorité, dans un cas comme dans l’autre, vers les sujets les plus faibles. En matière de violences, la préoccupation prioritaire porte ainsi sur la santé mentale des victimes, à travers la thématique des traumatismes. En revanche, hormis quelques cas médiatisés ravivant le débat sur les rapports entre la folie et le crime, il est frappant de constater la faible présence, dans le débat public contemporain, des réflexions de nature clinique sur la violence et sur ceux qui l’agissent. La prévention de la violence des plus jeunes, qui constituait l’objectif affiché de projets psychiatriques et médico-pédagogiques depuis le milieu du XIXe siècle, et plus encore après la seconde guerre mondiale, ne semble plus faire recette, laissant le champ libre à des approches uniquement répressives.
Bien que les raisons de cette évolution soient évidemment multiples et complexes, et que l’on puisse en observer des équivalents dans d’autres pays, il est possible de la relier, dans le cas de la France, à certains soubresauts de la diffusion locale des conceptions globalisées de la santé mentale, indissociables de conceptions anthropologiques et politiques de l’autonomie individuelle et de ses défaillances. Ceci peut être illustré par l’examen des destins croisés de deux catégories pédopsychiatriques : le trouble du spectre autistique et le trouble des conduites.
Heurs et malheurs de la santé mentale globalisée
Ces deux catégories illustrent l’une le succès et l’autre l’échec de l’introduction des nouvelles politiques de santé mentale, largement issues du monde anglo-saxon et qui ont connu une extension mondiale. Elles ont toutes deux en commun d’avoir fait l’objet de mobilisations publiques, dont la portée et le contenu ont été en revanche très différents. Particulièrement décisive dans les deux cas, l’année 2005 voit se dessiner ces destins contraires.
Dans le domaine de l’autisme, elle marque une étape importante dans un processus initié dix ans plus tôt, celui de la reconnaissance de l’autisme comme handicap relevant d’une politique publique spécifique. Le Plan autisme promulgué cette année-là s’inscrit dans une évolution générale marquée par la loi du 11 mars 2005, qui transforme l’organisation de la prise en charge de l’ensemble des handicaps à l’échelle nationale. Mais deux spécificités doivent être soulignées.
D’abord, l’attention spécifique dont l’autisme fait l’objet résulte pour l’essentiel de l’activisme d’associations de parents dénonçant les carences chroniques de la prise en charge des enfants autistes dans notre pays. Au cours des deux années précédant le premier Plan autisme, cette mobilisation associative a ainsi débouché sur la condamnation de la France par le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme, pour « non-respect des droits des personnes autistes ».
Or, c’est le deuxième point, ces condamnations et ces revendications ont porté, de manière singulière, sur la définition même de l’autisme. L’un des changements majeurs exigés par les associations et par les instances juridiques européennes était en effet l’adoption de la définition internationalement reconnue de l’autisme. Conformément aux classifications dominant alors la scène médicale internationale – CIM-10 et DSM-IV-R – l’autisme serait désormais caractérisé comme un trouble envahissant du développement, défini par des déficits plus ou moins sévères de la communication et des interactions sociales, associés à des comportements répétitifs et/ou à des intérêts restreints. Cette transformation impliquait l’abandon d’une conceptualisation inscrite dans la tradition clinique psychodynamique, à laquelle se référaient encore la plupart des psychiatres, psychologues et psychanalystes français, qui faisait de l’autisme une forme grave de psychose infantile.
On ne peut guère contester le succès de ces mobilisations. Sur le plan conceptuel et terminologique, le trouble du spectre de l’autisme (TSA), dernier avatar en date des troubles envahissants du développement et catégorie plus large des troubles neurodéveloppementaux qui se sont largement imposés, et concernent une population toujours plus large d’enfants et d’adultes. Sur le plan politique, les Plans autisme se sont régulièrement enchaînés depuis 2005, jusqu’à la « Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement » de 2018, dotée d’un budget global de 344 millions d’euros.
Les résultats sont certes plus nuancés en ce qui concerne les institutions et les pratiques : la lutte légitime contre la relégation des autistes dans des institutions de type asilaire est loin d’avoir entièrement résolu la question de la prise en charge des personnes aux handicaps les plus sévères, tandis que la politique d’inclusion scolaire rencontre des obstacles, sans même parler du problème de l’inclusion professionnelle des adultes. Mais ces problématiques n’en restent pas moins l’objet d’attentions politiques et médiatiques récurrentes.
Fort différente est la situation des enfants et adolescents dont les problèmes de comportement relèvent de la transgression, de l’agressivité, ou de la violence. En 2005 fut publié un rapport de l’INSERM proposant l’adoption d’une catégorie elle aussi issue des classifications médicales internationales : le trouble des conduites, désignant un « ensemble de conduites […] dans lesquelles sont bafouées les règles sociales correspondant à l’âge de l’enfant ». Rédigé par un groupe d’experts placé sous la tutelle symbolique de Richard Tremblay, chercheur québécois de renommée mondiale, le rapport proposait une approche de ce trouble en termes de facteurs de risque, notamment génétiques, et soulignait l’importance d’un dépistage précoce visant à prévenir le développement ultérieur des comportements antisociaux chez les enfants concernés.
La réponse des cliniciens français ne se fit pas attendre ; en quelques mois, la pétition lancée par le collectif « Pas de zéro de conduite » recueillit 300 000 signatures. Dénonçant le caractère réductionniste et l’excessive « médicalisation » de la turbulence infantile, ses signataires s’alarmaient de la coïncidence temporelle si ce n’est de la convergence programmatique avec un projet de loi sur la prévention de la délinquance, qui prévoyait un repérage des enfants violents avant l’âge de trois ans. La mobilisation fut un succès : le projet de loi fut retiré et le rapport de l’INSERM remisé. Les programmes de repérage, d’intervention précoce et de formation des parents prévues par les recherches de Tremblay ne furent jamais développés.
À la même période, des institutions éducatives adaptées, les Institut thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), furent spécifiquement dédiées aux « troubles du comportement », expression évinçant une fois encore le trouble des conduites. Au sein des réseaux et espaces de réflexion interprofessionnels tels que les formations universitaires sur les « adolescents difficiles », la tradition clinique française d’inspiration psychanalytique semble en outre avoir conservé son autorité. L’agressivité et la violence juvéniles ont continué d’être appréhendées, pour une part, comme des expressions symptomatiques d’une souffrance sous-jacente dont les causes doivent être cherchées du côté de la vie relationnelle et de la structure familiale de l’enfant.
Comme évoqué en introduction, on observe pourtant une érosion significative de la représentation publique de ce type d’approche. Les discours cliniques sur la violence des plus jeunes ont à peu près disparu de la sphère médiatique, et force est de constater, sur le plan politique, la prééminence de conceptions répressives qui résultent peut-être autant à de motifs idéologiques que de l’incapacité des décideurs à imaginer un autre type de réponse.
Dans le champ psychiatrique, enfin, le renouveau conceptuel et thérapeutique ne semble provenir que de la diffusion du TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité), une catégorie relevant elle aussi des troubles du neuro-développement, désormais soigneusement distinguée du trouble des conduites avec lequel elle était auparavant regroupée.
Il semble ainsi que les défenseurs d’une tradition psychiatrique française centrée sur l’individu singulier, la recherche du sens de ses symptômes et l’analyse de ses interactions subjectives avec son environnement humain n’aient pas su, ou pu, opposer autre chose qu’une posture de résistance idéologique ou politique au développement des nouvelles pratiques de santé mentale issues du monde anglo-américain.
Les défaillances de l’autonomie individuelle : le handicap ou la prison ?
Plusieurs travaux de sociologie ont mis en rapport l’expansion des savoirs et des pratiques psychologiques et psychanalytiques dans l’Occident de la deuxième moitié du XXe siècle avec les modalités spécifiques de la « gouvernementalité » démocratique, orientée vers la production d’individus autonomes. Dans cette perspective, les évolutions des catégories et pratiques pédopsychiatriques, et les controverses qui les accompagnent, sont révélatrices des mutations politiques et anthropologiques qui affectent le régime de l’autonomie individuelle dans nos sociétés.
Les approches neurodéveloppementales internationales qui s’imposent aujourd’hui face aux approches cliniques traditionnelles françaises apparaissent ainsi indissociables d’une anthropologie morale dans laquelle les capacités d’intégration sociale d’un individu relèvent avant tout de son équipement biologique de base, plutôt qu’elles ne se forgent dans la confrontation à des institutions éducatives, pédagogiques ou soignantes. Le succès des approches centrées sur la prédiction de troubles, l’intervention précoce et l’activation des compétences psychosociales s’explique dès lors au moins autant par leur solidité scientifique et leur arrimage à la médecine de précision et à l’épidémiologie, que par leur puissance d’objectivation des capacités et incapacités individuelles, lesquelles appellent tour à tour rééducation, compensation ou assistance.
Il en résulte d’une part une extension indéfinie du champ des handicaps, parfois dénoncée par les professionnels de terrain, pédagogues comme soignants, et qui joue certainement un rôle non négligeable dans les difficultés concrètes de la politique d’inclusion scolaire. Mais cette évolution s’accompagne aussi, d’autre part, d’un fort potentiel de négligence sociale et politique de populations telles que les enfants perturbateurs dont les troubles se situent au croisement de facteurs sociaux et de difficultés personnelles. Leur « traitement » reste problématique : irréductible à la seule question des capacités individuelles, il ne relève jamais de manière univoque de la médecine, de la rééducation ou de la compensation.
Des politiques publiques aux pratiques de terrain, il apparaît donc essentiel de maintenir ou de réinventer des approches souples et plurifactorielles de la santé mentale, sans quoi les destins de l’enfance en difficulté risquent de se partager uniquement entre le handicap et la prison.
