Singulier journalisme japonais
Le journalisme au Japon serait-il devenu un sujet « pop » ? Deux séries télé mises en ligne récemment sur des plateformes de distribution vidéo renommées se sont en tout cas emparées de cet univers professionnel, jusque-là largement méconnu en France. La première, produite par Netflix et sortie en janvier 2022, s’intitule sobrement The Journalist (ou Shinbun Kisha, pour le titre original). Réalisée au Japon, cette série suit les investigations de Matsuda Anna, une reporter (jouée par Yonekura Ryoko) travaillant pour un journal tokyoïte qui cherche à élucider une affaire de trafic d’influence mêlant monde politique et haute fonction publique.
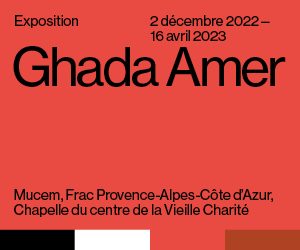
Les événements qui y sont dépeints sont ouvertement inspirés de l’Affaire Moritomo Gakuen remontant à 2018 et impliquant la femme d’Abe Shinzō, le Premier ministre de l’époque. Au moment de sa sortie, cette série a bénéficié d’une certaine couverture médiatique en France, à la suite de la publication d’articles publiés dans Le Monde et Libération, entre autres.
La seconde série est une adaptation de Tokyo Vice, un livre autobiographique écrit par le journaliste américain Jake Adelstein, connu notamment pour avoir été le premier Américain embauché en tant que reporter au sein du Yomiuri Shinbun, l’un des principaux quotidiens du pays. Produite et distribuée par HBO, la série se situe dans le Tokyo de la fin des années 1990. Elle raconte les aventures du jeune journaliste américain (joué pour l’occasion par Ansel Elgort) qui commence sa carrière dans le journal (dont le nom a été changé) et y découvre une culture du travail nouvelle pour lui. Passionné par le monde des Yakuzas, on le suit dans ses enquêtes sur la pègre japonaise, qu’il mène avec le soutien intéressé de membres de la police judiciaire.
Si le monde de la presse nipponne est mis à l’honneur par ces deux séries, précisons tout de suite qu’il n’en constitue pas véritablement le sujet principal. La série The Journalist entre en réalité assez peu dans le déta
