Passion(s) Ernaux – sur le Nobel de littérature 2022
Le 6 octobre 2022, Annie Ernaux reçoit le Prix Nobel pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ». Dans l’immédiat, laissons de côté le terme de « racines », inapproprié à la démarche ernausienne, pour souligner les valeurs mises en exergue : morale (« le courage »), herméneutique (recherche de type sociologique) et humaniste (dimension universelle des découvertes).
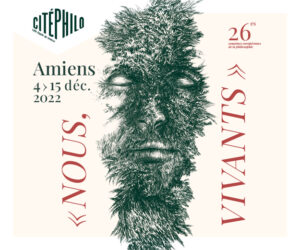
Comme à son habitude, la prestigieuse institution honore « un puissant idéal », privilégie une valeur transcendante puisque dépassant les esthétiques concurrentes dans les espaces littéraires particuliers : c’est ainsi que se trouve récompensée l’une des œuvres qui « participent de l’élaboration de ce que Durkheim appelait la “conscience collective”[1] », pour reprendre ici une formule que Gisèle Sapiro a utilisée dans un autre contexte. Tel est cet événement que l’on peut qualifier de miraculeux ou de paradoxal : la « miraculée sociale » qui a écrit contre les formes et représentants légitimes de la littérature instituée, accède par là-même à la dernière étape du processus de légitimation – selon Jacques Dubois dans L’Institution de la littérature (1978) –, celle de la canonisation, qui fait pénétrer tout écrivain modèle dans le panthéon mondial.
Au reste, l’écrivaine entrée dans le champ en 1974 par la grande porte de Gallimard s’est assez rapidement située dans l’espace de la « littérature », notion qu’elle n’a jamais voulu hypostasier et dont elle sait pertinemment qu’elle « est un principe de classement, mais aussi une valeur »[2]. C’est d’ailleurs au nom de cette valeur, entre autres griefs, qu’elle est attaquée depuis des semaines maintenant, par divers acteurs qui occupent des positions diverses mais ont en commun d’avoir vu leurs croyances heurtées par le choix qu’a proclamé une instance de consécration internationale de plus en plus décriée. Autrement dit, la réception de ce prix déchaîne des passions qui n’ont rien à voir avec celles qu’expose l’autrice de Passion simple dans ses écrits.
Après avoir examiné un spectre de prises de position tout à fait révélateur, nous nous pencherons sur l’univers et la posture de cette intellectuelle hétérodoxe.
Une réception clivée : Annie Ernaux, adorable et innommable
Du halo au haro, telle est la formule qui peut, si l’on ose dire, résumer la réception passionnément contrastée de ce prix Nobel. À cet égard, la trajectoire de l’écrivaine s’avère éclairante : l’habitus clivé de la transfuge de classe, qui se manifeste par la tension interne entre le monde populaire d’où elle vient et le monde de la bourgeoisie cultivée qu’elle a rejoint, et, dans l’œuvre, par une (auto)socioanalyse des dominés et une subversion des visions dominantes du monde social pour « venger sa race[3] » – notamment au moyen d’une double obscénité, sociale et sexuelle –, explique une réception, non pas totalement ouverte, universelle, mais qu’on pourrait appeler « clivée » par homologie.
D’une part, ceux qui se réjouissent qu’Annie Ernaux soit auréolée d’une gloire mondiale, situés à gauche de l’échiquier politique. On peut se faire une idée de ce public grâce à la première thèse publiée sur son œuvre (1999), que l’on doit à la politiste Isabelle Charpentier, Une intellectuelle déplacée : enjeux et usages sociaux et politiques de l’œuvre d’Annie Ernaux (1974-1998) : majoritairement féminin, il est essentiellement constitué de professionnels de la culture (professeurs de lycée et d’université, bibliothécaires, critiques divers) ; plus généralement, ces lecteurs sont des provinciaux diplômés, citadins d’origine rurale. Après avoir réalisé de multiples entretiens approfondis avec des bibliothécaires et des enseignants, et analysé statistiquement et qualitativement des centaines de courriers, dans son chapitre 5, la sociologue montre qu’une telle « écriture de l’intime social » étant « l’expression d’un ethos de classe », l’identification à l’œuvre d’Annie Ernaux est facilitée par « l’effet de génération » et des propriétés sociales proches.
D’autre part, ceux qui, classés à droite ou à l’extrême-droite, ne voient en elle qu’une néo-féministe woke, une intellectuelle racialiste, indigéniste, pro palestinienne et même antisémite (la nouvelle lauréate du Nobel a reçu des courriers l’intimant de déclarer, lors du discours officiel de remise du prix le 10 décembre prochain, qu’elle reconnaît l’existence d’Israël). Isabelle Charpentier nous avait déjà appris que, dès les années 1970-80, la presse de droite avait crié haro sur cette littérature triviale, obscène, sordide…
La polémique qui a fait rage en octobre dernier est révélatrice de l’état actuel du sous-champ de la critique journalistique. Sans entreprendre ici une exhaustive étude de réception, arrêtons-nous un moment sur les griefs égrenés par la critique (extrême) droitière, dont les titres et sous-titres sont parfois très virulents. La stigmatisation sociale et genrée, très méprisante, peut être mise en relation avec la dénonciation idéologique : « obnubilée par l’égalité », cette « âme de petite-bourgeoise embarrassée de ses origines » est une intellectuelle « féministe très engagée à gauche de la gauche » (Laurent Dandrieu, Valeurs actuelles), et donc ingénue en politique, qui, par excès de radicalité et manque de réalisme, tombe inéluctablement dans le simplisme…
Que penser de ce libellé, signé par un anti-Ernaux de la première heure, dans lequel la concession débouche sur un verdict sans appel : « Alors qu’elle fait part d’une maîtrise et d’une mesure parfaites dans ses écrits, Annie Ernaux mène un combat des plus simplistes dans sa vie publique » (Pierre Assouline, L’Express) ? En un temps où sont largement majoritaires les valeurs conservatrices et réactionnaires, la stratégie de l’inversion des rôles a de quoi surprendre : pour Laurent Dandrieu, dès lors que l’activisme de gauche fait quelque bruit, le positionnement de l’écrivaine relève de « la fausse audace, de la transgression canonisée, de la rébellion majoritaire » ; « L’audace de Mme Ernaux est noyée dans le troupeau des mutins de Panurge, et ses engagements politiques mélenchonistes, propalestiniens, féministes ou indigénistes n’ont rien de transgressif. »
De même, en un temps de repli identitaire, taxer de nombriliste l’autosociobiographe, dénoncer son repli narcissique, est pour le moins paradoxal : le titre de l’article publié dans Valeurs actuelles, par un journaliste qui arbore sa facilité à jouer avec les sonorités – façon de revendiquer sa part de gâteau poétique, sans doute –, est précisément « Annie Ernaux, le Nobel du nombril »… Comme renfort d’artillerie, le recours au réductionnisme dévalorisant : « La papesse de l’autofiction a reçu la récompense suprême pour une vie entière à écrire sur elle-même », tonne Nicolas Ungemuth dans Le Figaro en date du 18 octobre.
Voici donc renvoyée dans le magma de l’autofiction l’œuvre même qui a renouvelé l’autobiographie – comme on le verra plus loin. Selon le système axiologique des conservateurs, qu’illustrent parfaitement les articles de Causeur (Isabelle Larmat), du Figaro et de Valeurs actuelles, l’intime – forcément banal et « nombriliste » – s’oppose à l’extraordinaire « aventure collective », à l’épopée et à la tragédie. Dans cette optique, bien qu’Annie Ernaux soit préférable à Édouard Louis, celui qui aurait dû obtenir le Prix est Michel Houellebecq, malgré une Plateforme contrastant avec les grandes orgues de Richard Millet, dont la désormais lauréate de la plus grande distinction littéraire demeure impardonnable d’avoir ruiné la carrière en 2012, après la parution aux éditions P.-G. de Roux de Langue fantôme suivi d’Éloge littéraire d’Anders Breivik.
On se souvient en effet du brulot que l’auteure engagée a livré au Monde le 10 septembre 2012, faisant fi de la position éditoriale de son adversaire comme du topos de la totale liberté d’expression des artistes : « J’ai lu le dernier pamphlet de Richard Millet, dans un mélange croissant de colère, de dégoût et d’effroi. Celui de lire sous la plume d’un écrivain, éditeur chez Gallimard, des propos qui exsudent le mépris de l’humanité et font l’apologie de la violence au prétexte d’examiner, sous le seul angle de leur beauté littéraire, les “actes” de celui qui a tué froidement, en 2011, 77 personnes en Norvège. Des propos que je n’avais lus jusqu’ici qu’au passé, chez des écrivains des années 1930. » Dans la lignée de Sartre, elle sait que l’envers de la liberté se nomme responsabilité, et c’est pourquoi elle s’attaque à Richard Millet : son pamphlet est un acte qui soutient les actes criminels d’Anders Breivik.
Passion Ernaux… incapable de se taire, toujours prête à « ouvrir sa gueule », à l’instar de Sartre et de Bourdieu. Nul doute qu’on pourra dire à son propos ce que Pierre Bourdieu dit de Günter Grass, Prix Nobel 1999 : « Je me réjouis beaucoup que vous soyez Prix Nobel et je me réjouis aussi beaucoup que vous n’ayez pas été transformé[e] par le prix Nobel, que vous soyez aussi disposé[e] qu’avant à “ouvrir votre gueule”[4]. »
Au reste, dans Le Monde du 15 octobre 2016, elle n’a pas tu son désaccord vis-à-vis de l’illustre institution : « Je crois que les jurés du Nobel ont voulu se refaire une jeunesse avec Bob Dylan. Et vu les réactions, c’est peu dire que le coup est réussi. Mais au-delà de cette transgression des usages opérée par cette institution, je crois que cette récompense est le signe d’un tournant : ce qui est proprement littéraire se dissout. » Par cette prise de position, l’auteure de L’Écriture comme un couteau, écrivaine déjà reconnue, confirme que la « littérature » est bien une valeur étalon par rapport à laquelle tous les acteurs du champ se définissent : celle qui, dans Une femme (1987), a revendiqué se situer « au-dessous de la littérature » ne classe pas les textes de Bob Dylan dans la catégorie de ce qu’elle conçoit comme relevant de la littérature.
Six ans plus tard, la lutte pour la définition de cette notion se poursuit, au détriment de la nouvelle impétrante : des voix progressistes rejoignent les plus conservatrices pour dénigrer une écriture platement banale, minimale jusqu’à la transparence – mais pour des raisons différentes : les unes, élitistes, en opposant la lisibilité ernausienne à l’illisibilité des avant-gardes ; les autres, conformément à une conception réactionnaire[5], en lui préférant le Grand style classique, c’est-à-dire éternel. La violence des titres est éloquente : « Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature : et si c’était nul ? » (Nicolas Ungemuth, Le Figaro) ; « Annie Ernaux, ou la déchéance de la littérature française » (Isabelle Larmat, Causeur) ; « Annie Ernaux : le Nobel de littérature définitivement discrédité » (Marc Roudier, Inferno)…
Ce dernier article, publié dans un magazine moderniste, affiche explicitement ses préférences (d’où la photo de Pierre Guyotat, né en 1940 comme Annie Ernaux mais récemment décédé) et n’hésite pas à fustiger les « considérations purement politiques et opportunistes » de la vénérable institution suédoise, allant jusqu’à semer la suspicion sur la façon dont Gallimard a pu obtenir trois récompenses en une quinzaine d’années. Pire, la charge contre cette « écrivaillonne si franco-française et si autocentrée sur sa médiocre personne » est des plus féroces : « Consacrer une aussi insignifiante greffière, totalement égotique, se rengorgeant de sa jeunesse misérable de pauvresse de bar-épicerie de province, est simplement surréaliste. En quoi Annie Ernaux est-elle universaliste ? En quoi ses écrits rétrécis et nombrilistes intéressent-ils l’humanité ? Quelles briques a-t-elle apportées à la littérature française et mondiale ? De quel ciment a-t-elle consolidé l’assise universelle de la littérature ? Mystère. »
Avant que de répondre à ces questions assassines dans les sections suivantes, précisons, pour ajouter de l’eau trouble à notre moulin, qu’un autre journal qui se revendique de gauche remet vertement en question le succès de l’écrivaine nobélisée, preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que le clivage gauche/droite n’est pas si net qu’il n’y paraît. « Pour Annie Ernaux, sa réussite est une trahison : qu’elle se rassure, sa pensée est restée pauvre », lâche violemment l’ancien communiste Guy Konopnicki dans Marianne, façon de rejeter celle qui, pourtant, a conquis toutes les espèces de capital (social, culturel, symbolique et économique) dans une pauvreté intellectuelle rédhibitoire, comme si une transfuge de classe n’était jamais en mesure de développer une pensée singulière.
Toujours côté progressiste, dans l’espace numérique, la chronique qui a enregistré le plus grand retentissement est celle signée par Johan Faerber le 10 octobre, sur Diacritik : « Heureusement, Annie Ernaux n’est pas un “Grand Écrivain” ». Pour expliquer la tempête médiatique qui a accueilli en France le Nobel Ernaux, qui contraste avec l’accueil réservé à Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2008, à Patrick Modiano en 2014, ou encore à Svetlana Alexievitch en 2015, le critique avance cette thèse : Annie Ernaux s’est substituée à la figure mythique du Grand Écrivain national, qu’incarne en revanche Michel Houellebecq. Et l’essayiste de se lancer dans un vibrant plaidoyer – histoire de défendre son dernier essai, Le Grand Écrivain, cette névrose nationale, et, sait-on jamais, de se voir décerner un brevet de vertu.
Bien-pensance mise à part, la posture de Johan Faerber ne tient pas : jamais il ne cite l’écrivaine, et pour cause, son œuvre demeurant pour lui une Terra incognita. En fait, le héraut de la postlittérature ne considère pas Annie Ernaux comme une autrice contemporaine mais comme une figure historique, et même quand il passe en revue les représentations du peuple dans la littérature contemporaine, il ne se réfère pas à La Place ou à Une femme. Pour lui, la figure du Grand Écrivain est morte en même temps que la littérature : loin de toute idéalisation, il importe d’inventer des postures et des pratiques moins prétentieuses.
Le problème est que, dans sa volonté de démythification, il en vient à défendre ce que Sartre, dans Situations, II, appelait « une littérature des situations moyennes » ; quant à sa critique de la littérature engagée, doit-elle conduire à nier qu’en France on ne puisse trouver une figure équivalente à Alexievitch, qui, « depuis la littérature, n’appartient pas à la littérature[6] » ?
Une intellectuelle hétérodoxe
« Je ressens toujours une forme d’illégitimité dans le champ littéraire,
mais il faut bien avouer que j’ai fait de cette illégitimité une force »
Annie Ernaux, Matricule des Anges, n° 158, nov.-déc. 2014
Les passions suscitées par la réception du Nobel Ernaux doivent être confrontées à des faits objectifs. La trajectoire ascendante de l’écrivaine rend logique et légitime l’attribution de cette prestigieuse distinction : remarquée dès son entrée dans le champ littéraire français, en 1974 sous l’égide de Gallimard, Annie Ernaux voit grandir son nombre de lecteurs et son capital symbolique, d’abord avec Ce qu’ils disent ou rien (prix d’Honneur du roman 1977) mais surtout La Place (1984, prix Renaudot et prix Maillé-Latour-Landry de l’Académie française) ; au tournant du XXe et du XXIe siècle, la critique universitaire et les sociologues s’intéressent de plus en plus à une œuvre qui prend une dimension internationale, puis l’auteure multiplie les succès et les invitations à l’étranger, tout comme les distinctions honorifiques (le titre de Docteur honoris causa de l’Université de Cergy-Pontoise en 2014 et dix récompenses importantes, dont les prix Marguerite-Duras et François-Mauriac pour Les Années en 2008, le Prix de la langue française 2008 et le prix Marguerite-Yourcenar en 2017 pour l’ensemble de son œuvre, en plus des prix reçus en Italie, Espagne et Allemagne) ; on n’oubliera pas non plus les nombreuses adaptations théâtrales et, plus récemment, cinématographiques (dont L’Événement, film d’Audrey Diwan, Lion d’or de Venise en 2021).
Par ailleurs, l’engagement humaniste d’Annie Ernaux, son rayonnement international et la singularité de ses prises de position – l’envers, donc, de la bien-pensance dont ses adversaires la taxent – correspondent parfaitement aux attentes de l’Académie suédoise. Ayant « glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l’autre n’est qu’un décor[7] », cette déclassée par le haut ne peut du reste qu’adopter des positions hétérodoxes.
Examinons quelques exemples. D’une part, dans La Femme gelée (1981) et L’Événement (2000), elle semble abonder dans le sens du discours féministe en critiquant les représentations dominantes de la femme et de la maternité : « à d’autres le lyrisme, la poésie des entrailles déchirées » ; quant à la grossesse glorieuse, elle n’existe pas puisque « même les chiennes qui portent montrent les dents sans motif[8] ». D’autre part, elle ne cesse de prendre ses distances avec la doxa féministe, comme dans ce passage de L’Événement, où elle écarte « le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, imposées par la lutte des années 70 – “violence faite aux femmes”, etc.[9] ». Car écrire ne revient pas à affirmer son être-femme ; nul féminisme basique chez cette auteure réputée féministe.
Sans identité fixe – puisque entre deux mondes –, Annie Ernaux n’est pas dans l’être (être-femme, être-intellectuel), mais dans l’être-avec, l’être-comme, l’être-dans : faisant prévaloir le souci d’indistinction sur le désir de distinction, elle vise le partage d’une expérience commune ; ne se prévalant aucunement de son statut d’intellectuelle – ni intellectuel universaliste, ni intellectuel spécifique[10] –, elle souhaite demeurer au plan de la vérité sensible, c’est-à-dire de l’immanence.
On a vu à quel point la bouillonnante écrivaine n’hésite jamais à prendre position ; ajoutons, de façon vive et spontanée, comme dans cet entretien accordé au Monde mensuel en juillet 2012[11] : « Stupeur, colère – il ose faire ça ! –, ma première réaction à la proclamation de Nicolas Sarkozy de fêter “Le vrai travail” le 1er mai sur la place de la Concorde. Puis la sensation d’une blessure. Celle infligée à la mémoire des luttes de plus d’un siècle, partout dans le monde pour l’obtention de droits sociaux […]. »
Dans ses prises de position médiatiques – l’écrivaine affectionnant ce passage du temps particulier que constitue l’actualité – comme dans ses ethnotextes, elle prend bien garde de tomber dans le moralisme intellectualiste. Ainsi, pour être un lieu de spectacle, le supermarché n’en est pas pour autant un prétexte à donner dans la diatribe debordienne, sans doute pour cette raison précise : « Qu’on le veuille ou non, nous constituons ici une communauté de désirs ».
Et celle qui a horreur des positions de survol n’hésite pas à avouer l’inavouable : « Je ressentais une excitation secrète d’être au cœur même d’une hypermodernité dont ce lieu me paraissait l’emblème fascinant. C’était comme une promotion existentielle » ; « Je suis rendue à ma convoitise d’enfant et, durant quelques secondes, emplie du ravissement qu’un tel lieu de profusion existe »[12].
Si elle ne représente pas une intellectuelle engagée orthodoxe, c’est qu’elle s’engage tout entière dans une œuvre qui opère un perpétuel passage entre expérience singulière et expérience collective, entre identité et altérité, première et troisième personne, entre « je » et « on » / « nous ». Un exemple parmi tant d’autres : dans L’Événement, elle fait partie « des milliers de filles » qui « ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre[13] ».
À sa façon, l’écrivain engagé est celui qui réussit le passage du silence à l’exposition, du non-dit au dit, à faire advenir l’indicible dans l’écriture : « À chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu’il est prescrit de penser, autant par les livres, les affiches dans le métro que par les histoires drôles, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu’elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. Silence qui est brisé un jour brusquement, ou petit à petit, et des mots jaillissent sur les choses, enfin reconnues, tandis que se reforment, au-dessous, d’autres silences[14]. »
Et celle qui se reconnaît dans la pensée de Pierre Bourdieu sait parfaitement que ce dévoilement est politique. Comme son père qui la « conduisait de la maison à l’école sur son vélo », elle a trouvé son rôle : « passeur entre deux rives »[15]. Pour rendre le pauvre fier[16].
Traversée Ernaux : de l’innommable en héritage à l’innommable en partage…
Passion(s) Ernaux… Ses livres, autosociobiographies ou ethnotextes, offrent des histoires de passions sociales (histoires de famille, rites et rituels, hobbies et lubies au fil des décennies) et sentimentales (liaisons dévorantes, folies amoureuses, jalousie). Sur ce dernier point, on notera que, en régime ernausien, la passion est, comme l’écriture, une perte synonyme à la fois d’extase et de perdition, de liberté et d’aliénation. En témoigne encore cette phrase extraite de son dernier opus, Le Jeune Homme : « Nous communions imaginairement dans notre perte réciproque avec un plaisir extrême[17]. »
Mais Annie Ernaux souffle le « chaud » (celui des passions) et le « froid » (celui d’une écriture dite également « métallique », dotée d’une « précision d’entomologiste »). C’est que cette déclassée par le haut cherche à s’objectiver pour désubjectiver la honte, sentiment négatif dont elle veut se délivrer en faisant une place objective – c’est-à-dire sans misérabilisme ni populisme – au monde des dominés dans le monde des Belles-Lettres, et en le réfractant vers les lecteurs de l’autre bord ; d’où son goût pour une transgression totale qui consiste à se constituer en objet d’horreur, à se rendre immonde pour faire honte au « monde d’en haut », à le choquer en faisant entrer en littérature des réalités considérées comme triviales et obscènes.
Aussi, pour continuer de répondre aux interrogations inquisitrices citées plus haut, Annie Ernaux ne s’est pas contentée de cimenter quoi que ce soit, ni d’apporter des briques à la littérature (inter)nationale : elle a subverti les doxas et les formes dominantes pour lancer un pavé dans la mare de la « littérature », savoir l’ensemble des normes et thématiques reconnues, par le fait même de transposer dans le domaine des sciences sociales le paradigme de vérité et de sincérité propre à l’autobiographie traditionnelle.
Le résultat n’est pas conforme à l’autofiction en vogue depuis une trentaine d’années, comme le constate justement Élise Hugueny-Léger dans son dernier livre, soulignant au passage l’effet pervers d’une telle catégorisation : « Même si écriture signifie inévitablement transformation et construction, écrire chez Ernaux n’est pas, a priori, synonyme d’invention ou de fabulation. Ses positionnements n’empêchent pas nombre de critiques de positionner les textes d’Annie Ernaux dans la catégorie génériquement floue de l’autofiction, qui deviendrait d’abord un mode d’écriture féminin, visant à dire les expériences intimes[18] ». Dans la lignée de Simone de Beauvoir, cette figure emblématique de l’antidomination – qui se révolte à la fois contre la domination masculine et contre la domination néolibérale, tout en contestant la littérature officielle – a contribué à faire en sorte que l’écriture de l’intime ne soit plus un exercice gratuit qui est l’apanage d’une élite sociale masculine, sans pour autant devenir un sous-genre spécifiquement féminin, et donc mineur.
Le rejet de la littérature pure que manifeste Annie Ernaux à partir de La Place est caractéristique de l’innovation des Modernes, dont les projets originaux ont toujours été exogènes et/ou excentriques : pour s’arracher du « piège de l’individuel » (La Place), dans ses autosociobiographies comme dans ses ethnotextes, elle emprunte au sociologue le principe de la distance objectivante et sa méthode d’investigation ; son entreprise, qui consiste à rassembler les « signes objectifs » (La Place) pour mener à bien son « exploration » (L’Événement) ou « recherche » (L’Occupation), réside dans une écriture transgénérique et transdisciplinaire qui fait prévaloir l’exposition sur l’explication, démarche s’opposant à toute la tradition française d’analyse, de Mme de Lafayette à Proust, et à la philosophie et la rhétorique des profondeurs qui la sous-tendent.
Cela dit, le travail de l’écrivaine se distingue de celui du sociologue, dans la mesure où elle accorde une place importante à la sensibilité, met en jeu son être tout entier et, afin de traduire littérairement une sociologie immanente, recourt à des procédés d’écriture spécifiques (autobiographie matérielle) : écriture plate et inventaire matériel ; commentaires de photos, relevés de topographie sociale et tableaux d’époque ; note, italique et guillemets, opérateurs de distanciation ou moyens de retranscrire le plus objectivement possible un sociolecte (patois normand et, plus généralement, langue populaire).
On pourrait encore évoquer la fascinante écriture de la ritournelle qui, dans Les Années, rend sensibles les effets du temps sur les pratiques sociales. Indépendamment de toute polémique (car, dans le sous-champ restreint des écritures expérimentales – de la poésie action à la poésie numérique –, la notion réactionnaire de « style » est passée aux oubliettes depuis un demi-siècle !), insistons sur la singularité et l’authenticité de l’entreprise ernausienne : une éthique et une esthétique du neutre, sociologiquement fondées, selon lesquelles il s’agit de renoncer au « Beau-Style », qui est la langue des dominants, pour exprimer l’expérience d’un sujet transpersonnel. Cette authenticité est renforcée par les multiples interrogations de l’écrivaine sur les représentations mentales et sociales ainsi que sur les moyens littéraires qu’elle mobilise.
Concernant celle qui, fortement marquée par la phénoménologie de Sartre et la sociologie critique de Bourdieu, ne croit pas à une possible totalisation de soi dans un discours cohérent, en une possible analyse d’un « moi » stable, le sujet étant vide par lui-même et informé par ses interrelations avec le monde social, l’accusation de narcissisme, ou pire, de nombrilisme, est irrecevable. Annie Ernaux s’est orientée précisément vers une nouvelle forme d’autobiographie, dont elle donne une idée en novembre 1995 dans un journal d’écriture préludant à La Honte (1997) comme à Mémoire de fille (2016) : « L’autobiographie vide, complètement extérieure, à la limite sans personne, comme Journal du dehors, au travers de photos, non montrées. À partir d’elles, anecdotes (peu), gestes, époque, chansons, émissions de radio[19]. »
Nul repli sur soi, donc, de la part de celle pour qui exister c’est se perdre / se trouver dans les autres, dans la foule : « Sans doute suis-je moi-même, dans la foule des rues et des magasins, porteuse de la vie des autres[20]. » C’est, tel un lieu – un corps – public, être traversée de façon extrême : « Je suis traversée par les gens, leur existence, comme une putain[21] ». L’exergue du Journal du dehors nous l’avait signalé : « Notre vrai moi n’est pas tout entier en nous (Jean-Jacques Rousseau) »… La vérité du sujet Ernaux est à chercher dans l’écriture, là où elle peut exposer un corps et un esprit devenus publics, fondus dans le corps social : « que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l’écriture, c’est-à-dire quelque chose d’intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres[22] ». Là où elle peut s’exposer pour faire exploser les barrières et les préjugés.
Nul enracinement, donc, chez Annie Ernaux, qui s’inscrit fermement à l’encontre du renouveau identitariste pour ne pas dire barrésien : « L’identité française. Je ne sais pas ce que ça signifie, l’identité. La langue française, oui, la mémoire française, aussi, parce qu’on a été traversés par les mêmes choses, mais pas l’identité française[23] ». À la transcendance, elle préfère l’immanence, qui, pour Deleuze, n’est pas identité mais continuité de variation. À l’identité, à la continuité, à l’immobilité essentialistes, qui favorisent les positions de survol ou le point de vue de l’esthète, elle préfère la traversée, le passage, l’aller-vers. Écrire n’est pas une opération de transsubstantiation, d’identification à soi : c’est être hors de soi, se perdre dans une mémoire impersonnelle. D’où cette vision singulière : « Je ne suis qu’une caméra. J’ai simplement enregistré. L’écriture consiste à aller à la recherche de ce qui a été enregistré pour en faire quelque chose[24]. »
Et si la passion majeure d’Annie Ernaux était celle de l’Autre[25], celle d’un Nous qui, selon Alain Badiou dans À la recherche du réel perdu (2015), permet d’accéder au réel démocratique – de « se fondre dans une totalité indistincte » –, et par là même de s’ouvrir à « une sorte de vaste sensation collective[26] » ?
