Pour ou contre la cause animale : là n’est pas la question
À la faveur d’un déplacement dans un refuge de la SPA le 27 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a confirmé la création d’une division nationale d’enquête sur la maltraitance animale et annoncé la formation de 4 000 référents sur la question dans les unités de police et de gendarmerie de l’ensemble du pays. La déclaration, largement reprise dans les journaux, fait écho à une intervention plus ancienne du même ministre, contestant la mise à l’arrêt de la cellule de gendarmerie dite Déméter, dont l’un des objectifs était d’empêcher les actions de certains groupes de défense de la cause animale visant le monde agricole.
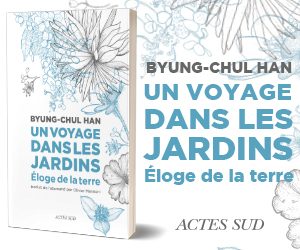
Célébrer les militants d’une cause, tout en appelant à la répression d’acteurs qui se réclament pourtant du même combat : ces prises de position peuvent paraître incohérentes à première vue, mais il n’en est rien. Elles participent en fait toutes deux de l’implication de plus en plus importante des institutions publiques dans les luttes pour la définition des formes légitimes de la prise de parole et de l’engagement au nom des animaux dans de nombreux pays. Alors que certaines mériteraient d’être encouragées, voire même soutenues par la puissance publique, d’autres au contraire devraient être interdites et réprimées.
Cet intérêt croissant pour la « question animale » n’est pas le fait des seules instances étatiques, comme en témoigne la multiplication des déclarations sur ce thème de nombreuses personnalités publiques, hommes et femmes politiques, journalistes et éditorialistes, intellectuels et artistes. Tous ou presque semblent désormais avoir un avis sur cette cause, et s’autorisent à le donner.
Devant l’avalanche de postures normatives sur la question animale, n’est-il pas important d’analyser le travail de celles et ceux qui la façonnent depuis bientôt deux siècles et qui la font vivre au quotidien ? Si les débats philosophiques et juridiques autour de cette entreprise de représentation sont désormais familiers du public, les travaux en sciences sociales sont en comparaison peu connus[1]. Ils éclairent pourtant toute une série d’événements et de phénomènes récents, à commencer par les propos de l’actuel locataire de l’hôtel de Beauvau.
Porter la parole des animaux : entre conceptions sectorielles et critiques systémiques
Les commentaires politiques et médiatiques sur ce mouvement de défense des intérêts supposés des bêtes, apparemment inédit par son ampleur, ne doivent pas faire illusion : il s’agit en fait d’un mouvement pluriséculaire, qui remonte au moins à la fin du XVIIIe siècle, et qui regroupe des courants distincts, voire concurrents, diversement appréciés par la puissance publique. L’une des principales lignes de fracture au sein de la cause oppose les conceptions sectorielles, qui se focalisent sur des catégories spécifiques d’animaux et d’activités, aux critiques systémiques de la cause, qui elles remettent en cause l’ensemble des formes d’exploitation des animaux.
Au sein du mouvement, les définitions sectorielles prédominent longtemps, à commencer par la protection animale. Émergeant à la croisée des XVIIIe et XIXe siècles, elle est portée par des membres issus de l’aristocratie et de la haute-bourgeoisie et se concentre sur des pratiques qualifiées de cruelles à l’encontre des animaux de rente, pratiques considérées alors comme étant essentiellement l’apanage des classes populaires. Les protecteurs conçoivent la cause comme un instrument d’intégration et de « civilisation » de ces derniers : l’inculcation de comportements plus doux à l’égard des « bêtes » doit permettre de pacifier les mœurs et d’éviter tout débordement révolutionnaire.
À la fin du XIXe siècle, de nouvelles luttes sectorielles se développent, comme les mouvements anti-chasse ou anti-corrida. Surtout, l’antivivisectionnisme, qui entend s’attaquer aux pratiques des savants vivisectant des cobayes, prend son essor. Conçue au sein des organisations de protection par des militantes jusque-là marginalisées et des représentants de la bourgeoisie culturelle, l’antivivisection opère une série de déplacements conceptuels : il ne s’agit plus seulement de se préoccuper des animaux de rente, mais aussi des chiens et des chats ; il ne suffit plus de condamner des actes de cruauté publique, il faut révéler des comportements dissimulés qui provoquent des souffrances considérables chez les animaux.
Alors que l’antivivisectionnisme tentait d’imposer l’idée d’un porte-parolat des animaux autonome et critique vis-à-vis de la science et des savants, la cause connaît paradoxalement dans la première moitié du XXe siècle un processus de scientifisation. Des individus et des groupes revendiquant une expertise sur le bien-être animal se mobilisent dans le but de réformer des dispositifs d’exploitation des bêtes eux-mêmes en pleine mutation (comme dans le domaine de l’élevage, avec l’apparition des fermes industrielles).
Cette dynamique de scientifisation et de développement de l’expertise entraîne une hausse du coût de la prise de parole au nom des animaux, qui fragilise et marginalise les militants les plus jeunes et les moins dotés. Relégués dès lors dans des positions subalternes, ils inventent de nouvelles façons de représenter les bêtes, valorisant l’action directe et articulant leur engagement à l’adoption de pratiques de consommation végétariennes ou véganes. Ces façons d’agir et de parler au nom des animaux sont par la suite formalisées au cours des années 1970 par de jeunes intellectuels anglophones, qui entendent notamment revisiter la philosophie morale en la confrontant à des problématiques contemporaines comme cette question animale.
Ainsi émerge l’animalisme, critique systémique qui renvoie à des mots d’ordre comme celui de la libération animale, de l’antispécisme ou du droit des animaux et qui bouleverse l’équilibre des forces au sein de la cause. Si les conceptions sectorielles perdurent, elles sont dorénavant comme reléguées au second plan par des mobilisations qui entendent mettre à bas le système global d’exploitation des animaux en attaquant ses soubassements idéologiques, économiques, politiques, philosophiques ou juridiques.
Le lecteur aura compris que c’est l’animalisme qui pose problème aux institutions publiques. Alors que des alliances et des partenariats ponctuels ou durables ont été conclus de longue date avec des organisations se réclamant des conceptions sectorielles de la cause – comme cette signature, le mois dernier, d’un partenariat entre la SPA et la Direction centrale de la sécurité publique –, la montée en puissance des critiques systémiques depuis les années 1970 engendre une concurrence des récits entre les États et ces militants au sujet des animaux et des relations que les humains entretiennent avec eux.
Une population et des pratiques militantes encore peu connues
Les informations disponibles sur les propriétés sociales des militants sont encore lacunaires, leur recueil n’étant pas systématisé et ne se focalisant que sur certaines aires géographiques (le monde angloaméricain pour l’essentiel). De ces quelques coups de sonde, on retiendra qu’aux États-Unis, par exemple, ils sont majoritairement issus des classes moyennes, voire des catégories sociales supérieures et intellectuelles, avec une forte représentation des cadres supérieurs, professions intermédiaires et emplois de services.
Mais certains travaux plus qualitatifs laissent à penser que cette sociographie militante varie fortement selon les contextes nationaux et les différents segments des mobilisations pour les animaux : il n’existe en fait aucun portrait-robot des acteurs de la cause. On sait néanmoins que les militants sont surtout des militantes : aux États-Unis, par exemple, elles forment la base du mouvement (composé de 67 à 80 % de femmes), sans pour autant y occuper des positions de pouvoir.
Cette majorité de femmes est cohérente avec le fait qu’elles sont également les plus nombreuses à adopter un régime alimentaire végétarien ou végane. Le développement des formulations systémiques de la cause a renforcé l’association entre végétarisme, véganisme et militantisme pro-animaux : parce qu’elle est une pratique quasi généralisée, la consommation de viande et de produits animaux est une ligne de front idéale pour une critique portant sur l’ensemble de nos rapports aux animaux. Souvent conçue comme le premier pas dans la carrière militante, l’adoption de ces régimes alimentaires permet de constituer une communauté soudée par le sentiment d’être marginalisé par le reste de la société.
Dans certains contextes, ce stigmate peut être retourné pour renforcer la cohésion du groupe vis-à-vis de l’extérieur, comme en témoignent l’organisation de Veggie Pride ou l’émergence du concept de « végéphobie ». La cause animale s’insinue ainsi dans des dimensions très intimes et prosaïques de la vie quotidienne, au point que ces nouvelles pratiques alimentaires sont parfois conçues comme des formes d’engagement en elles-mêmes.
L’engagement pour les animaux prend bien entendu d’autres formes. Si la production de supports visuels mettant en scène la maltraitance animale fait partie des répertoires d’action historiques de la cause, le tournant des années 1970 renouvelle le genre avec des campagnes médiatiques censées générer un « choc moral » chez le grand public, telle l’opération « Holocaust on your plate » où PETA avait accolé images de camps de concentration et photos d’élevage. Un objectif similaire est visé avec la diffusion de vidéos filmées clandestinement dans des abattoirs, des élevages ou des laboratoires d’expérimentation animale.
La logique consistant à rendre visible une condition animale méconnue se retrouve dans des actions de conception plus récente, où les militants occupent l’espace public en « se mettant à la place » des animaux : dans des cages, enchaînés, gavés comme des oies, installés nus et couverts de faux sang dans des barquettes recouvertes de film plastique, ou encore marqués au fer rouge. Il s’agit ainsi d’insister sur la commune corporéité entre humains et animaux, et d’éprouver, symboliquement ou réellement, la souffrance de ces derniers pour mieux porter leur parole.
Cette volonté de les représenter se joue aujourd’hui aussi au niveau politique. Depuis plusieurs années, certaines associations mandatent des instituts de sondage à l’approche des échéances électorales, dans le but de montrer que la condition animale est un sujet qui préoccupe les électeurs. Ces enquêtes régulières témoignent d’une évolution des modalités de politisation de la cause : jusqu’ici pensée de manière indirecte, s’appuyant sur la consultation ponctuelle d’associations pour l’élaboration de politiques publiques, la représentation des animaux semble désormais s’autonomiser et se spécialiser, avec un corpus idéologique ad hoc, justifiant la création de partis dédiés.
Depuis les années 2000, des partis « animalistes » émergent, principalement en Europe. Souvent fondés par des militants souhaitant donner à leur engagement une autre dimension, leur objectif est de faire élire des personnes pour qui les intérêts des animaux sont prioritaires par rapport à toute autre considération. Si le Parti animaliste français a surpris en récoltant 2,2 % des suffrages aux élections européennes de 2019, il n’a emporté aucun siège. Son homologue néerlandais, l’un des rares à avoir obtenu des mandats électifs, a quant à lui réussi à légèrement infléchir les débats parlementaires, y imposant davantage d’échanges autour du bien-être animal en élevage.
Ce que change la cause animale : alliances anciennes et inédites
La capacité de la cause animale à transformer la société est précisément l’objet d’interrogations : certains commentateurs déplorent l’absence de changements réels, quand d’autres s’affolent d’une véritable machine de guerre aux effets dévastateurs. Pour sortir de ces dramatisations, il importe d’examiner l’influence qu’a déjà la cause animale sur différents mondes sociaux.
Au niveau des politiques publiques, les associations porteuses d’une critique sectorielle ont longtemps dominé : se positionnant sur des dossiers précis, négociant des changements incrémentaux, ces collectifs sont devenus des interlocuteurs privilégiés d’institutions qui fonctionnent également de manière sectorielle. L’Union européenne, par exemple, constitue une arène particulièrement propice aux évolutions en matière de protection animale pour les ONG, réunies depuis 1980 au sein de l’Eurogroup for Animals, une fédération agissant auprès des eurodéputés à travers la coordination de l’Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals. Le Conseil de l’Europe fait figure d’institution pionnière en la matière avec l’adoption de cinq conventions visant à réguler la protection des animaux en transport international (1968), dans les élevages (1976), à l’abattage (1979), mais aussi dans les laboratoires scientifiques (1986) et dans les foyers avec la protection des animaux de compagnie (1987).
Mais cette forme d’institutionnalisation de la cause par le truchement des politiques publiques et de la législation est lente et coûteuse aux yeux de certaines ONG qui déportent leurs actions en direction d’autres secteurs : les marchés. Parmi celles-ci, on trouve des groupes se revendiquant de l’animalisme et de la critique systémique, qui par la promotion de modes de consommation alternatifs, entendent fragiliser les différentes formes d’exploitation des bêtes.
La figure du consommateur devient alors centrale pour la défense des animaux. Associations pro-animaux et acteurs économiques s’emploient ainsi à construire les préférences d’un consommateur « militant » soucieux des conditions de vie des animaux. Les sondages tels que l’Eurobaromètre se multiplient et fabriquent une majorité européenne de potentiels consommateurs-citoyens sensibles à la condition animale. Pour les mouvements de défense des animaux, la consommation devient un nouvel espace militant et les acteurs marchands des alliés pour l’investir. Certains industriels s’engagent dans le développement de marchés végans, tandis que des opérateurs de la grande distribution influent sur les politiques relatives à la protection des animaux en portant, par exemple, des initiatives d’étiquetage sur le bien-être animal.
Outre les politiques publiques et les marchés, les mouvements pro-animaux ont créé des relations fortes avec le monde universitaire. Avec le développement de l’éthique animale comme domaine à part entière de la philosophie, et l’émergence des Animal Studies, le souci des animaux a trouvé une nouvelle façon de s’exprimer, convergente avec des intérêts de recherche légitimes. Depuis les années 2010 en France, un nombre croissant d’universitaires affiche ouvertement l’engagement de leur expertise au service de la cause et de nouvelles formations en lien avec la protection des animaux se développent. Ce qui n’est pas sans susciter des inquiétudes voire des oppositions franches, où le risque d’instrumentalisation de l’université à des fins idéologiques est dénoncé.
Suivant un processus assez classique, l’institutionnalisation de la cause s’accompagne donc de tentatives de délégitimation, voire de criminalisation, de certaines de ses déclinaisons. En partie sous l’impulsion des services de renseignement britanniques au sein d’Europol, la surveillance et la répression de formes d’action directe liées au militantisme pro-animaux (notamment les intrusions dans les laboratoires d’expérimentation animale, dans les abattoirs ou les élevages) s’organisent en Europe.
En France, l’antispécisme constituait l’un des axes prioritaires de la cellule de gendarmerie « Déméter ». Saisi en 2022 par l’association L214, le Tribunal administratif a enjoint le ministère de l’Intérieur à mettre fin à certaines activités de cette cellule visant les actions militantes portant atteinte au monde agricole. Décision dont le ministre de l’Intérieur a donc fait appel.
Pour ou contre la cause animale ? Une bien mauvaise question
Entre normalisation et répression, ces dynamiques d’institutionnalisation participent à instituer la cause animale comme une question de société ne laissant plus personne complètement indifférent. Elles contribuent dans le même temps à une polarisation des débats, se traduisant notamment par une prolifération d’énoncés normatifs au détriment d’analyses empiriques plus distanciées sur nos relations aux animaux.
Le monde académique a sans doute une part de responsabilité dans cet état de fait : la « question animale » a d’abord été discutée par des philosophes et des juristes développant des analyses à la portée fortement prescriptive. Leur emboitant le pas, les chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui prennent la parole sur le sujet adoptent une posture davantage normative que descriptive et analytique. Comme s’il fallait nécessairement se positionner pour ou contre la cause animale, justifier son bien-fondé, dénoncer ses excès, ou louer ses actions.
Pour ou contre la cause animale ? D’un point de vue sociologique, répondre à cette question n’a qu’un intérêt limité et tenter de le faire masquerait le fait que les débats actuels ne remettent finalement jamais en question le principe d’une prise en compte politique et éthique des animaux : si les controverses concernant les modalités de traitement de ces derniers sont vives et engagent souvent des prises de position à géométrie variable – comme l’illustrent les déclarations de M. Darmanin –, la cause animale semble paradoxalement faire consensus aujourd’hui. Ce consensus est le fruit de l’histoire de la cause, la preuve de ses succès, de sa capacité à transformer nos sociétés, et à ce titre, à devenir un objet sociologique à part entière.
NDLR: Fabien Carrié, Antoine Doré et Jérôme Michalon ont récemment publié Sociologie de la cause animale aux éditions La Découverte.
