Soudan : les sacrifiés
Les réseaux sociaux servent aussi à prendre la température. Depuis le 15 avril, les messages postés depuis le Soudan, en arabe, en anglais, en français plus rarement, bouillonnent de rage, de tristesse, de peur et de solidarité. Ils décrivent, au fil des heures, les familles sauvées ou perdues, les besoins de plus en plus urgents, de plus en plus basiques, l’exode, les rares bonnes nouvelles. Et les colères.
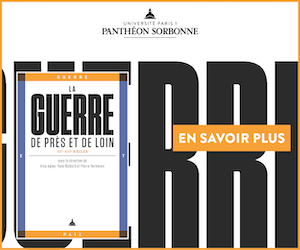
Colère, d’abord, contre les deux fauteurs de guerre, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et le général Abdelfattah al-Bourhan, commandant en chef de l’armée nationale (FAS). Personne, parmi les Soudanais ou les observateurs les plus avisés, n’a vraiment été étonné du déclenchement des hostilités. Le feu couvait depuis longtemps. L’allumette a été avancée très près, trop près, par Hemetti le 12 avril quand des milliers d’hommes des Forces de soutien rapide ont encerclé l’aéroport de Méroé, ville à 220 km au nord de la capitale soudanaise, et massé des troupes autour de Khartoum. Le chef des paramilitaires craignait un coup de force contre lui, alors que des manœuvres aériennes étaient prévues entre pilotes soudanais et égyptiens. Il est trop tôt pour savoir s’il avait raison ou s’il s’agissait, de la part de ses ennemis dans l’armée, d’une intoxication pour le pousser à la faute.
Mais il l’a fait. Lui qui a presque autant d’hommes que l’armée nationale, près de 100 000, mais qui est dépourvu d’aviation, a joué son va-tout. Et le feu, trois jours plus tard, a embrasé Khartoum et le Darfour. Depuis, les quartiers résidentiels parmi les plus huppés de la capitale soudanaise sont devenus des zones de guerre évacuées par tous ceux qui l’ont pu.
Il ne s’agit pas là d’une guerre civile où se combattraient dans des actions de guérilla des groupes armés plus ou moins organisés. Il s’agit d’une guerre entre deux institutions militaires constituées, dont les soldats sont entraînés et bien équipés. Les deux forces possèdent des mitrailleuses lourdes, des tanks, des missiles, des canons, des lance-roquettes. Les Forces de l’armée nationale ont en plus des avions de combat.
Dans les rues, selon les témoignages recueillis à distance, les hommes des FSR quadrillent une partie importante de la ville, les quartiers stratégiques, autour de l’aéroport international, du palais présidentiel, du siège de commandement de l’armée. Ils progressent chaque jour. Dans les airs, les jets de l’armée nationale bombardent les bases des paramilitaires, disséminées dans des maisons ordinaires depuis plusieurs années. Les soldats des FAS sont à distance de leurs ennemis, dans les quartiers encore relativement épargnés.
Les deux armées possèdent-elles les munitions pour faire durer la guerre sans intervention extérieure ? Elles sont riches, en tout cas, bien plus que le PIB par habitant du pays, tombé de 2 885 € en 2017 à 679 € en 2021, ne pourrait le laisser penser. L’armée nationale dévore à elle seule 70 % du budget de l’État, héritage du régime militaro-islamiste d’Omar al-Bachir. Les FSR se financent grâce à l’exploitation et la contrebande d’or dont regorge le sous-sol, et à l’envoi de mercenaires au Yémen pour les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.
Les deux forces militaires parallèles ne se sont pas constituées du jour au lendemain et les Soudanais ont eu le temps de s’en inquiéter. « Le pays a deux armées et c’est très dangereux, disait en février dernier Babiker Faisal, un des responsables du parti unioniste et membre de la grande coalition civile des Forces pour la liberté et le changement (FFC selon l’acronyme anglais). S’ils ne réussissent pas à s’entendre, il y a un risque de déflagration et de destruction du Soudan. » L’unification des deux constituait un des points centraux et délicats du processus politique en cours avant la déflagration. Elle a très probablement précipité l’affrontement.
La réforme du secteur militaire et de la sécurité a été laissée de côté par l’accord-cadre signé entre les militaires et une quarantaine de représentants de la société civile le 5 décembre 2022. La coalition des Forces pour la liberté et le changement (FFC), pierre angulaire de ces négociations avec les militaires, voulait, pour les questions les plus sensibles, élargir les consultations. La conférence sur le secteur militaire, la dernière programmée avant la signature d’un accord final prévu en avril et la constitution d’un gouvernement civil, est la seule à s’être tenue à huis-clos et seules les grandes lignes en sont connues. Le général al-Bourhan exigeait une intégration des FSR en deux ans seulement et un passage des paramilitaires sous le contrôle complet du commandement de l’armée nationale. Hemetti a refusé de perdre ainsi sa force, exigé que l’intégration se déroule sur dix ans et qu’il garde un contrôle sur ses troupes. Quelques jours plus tard, ces divergences se sont transformées en combat sans merci.
La colère, sur les réseaux sociaux, dans les discussions avec les Soudanais coincés dans les combats, a très vite visé la « communauté internationale », en particulier l’Unitams, la mission de l’ONU à Khartoum, et les pays occidentaux, États-Unis et Union européenne en tête. Colère décuplée après l’évacuation des ressortissants étrangers. Pourquoi ? Au-delà du sentiment d’abandon, il leur est reproché d’avoir poussé à la négociation avec les militaires et d’avoir soutenu l’accord-cadre signé le 5 décembre 2022 sans écouter les voix discordantes. En somme, d’avoir cru que les généraux voulaient vraiment rendre le pouvoir aux civils et retrouver leurs casernes.
Certes, Hemetti avait fait son mea culpa : le coup d’État du 25 octobre qu’il a mené avec le général al-Bourhan et qui a mis fin à la transition démocratique était une « erreur ». Le voilà qui défendait la démocratie et la révolution, se posait en protecteur des manifestants réprimés à balles réelles chaque semaine et assurait vouloir remettre le pouvoir aux civils. Al-Bourhan, lui, se joignait aux promesses du bout des lèvres.
Il n’empêche, les parrains du processus politique, l’Unitams, les États-Unis, les Européens, tout le monde voulait y croire. Volker Perthes, chef de la mission de l’ONU, voyait chaque semaine le général al-Bourhan. Les poignées de main avec Hemetti se multipliaient. « Nous n’avons eu aucune alerte », a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU après le début de la guerre.
Pourtant, nombre d’analystes critiquaient l’accord-cadre. Les Comités de résistances, organisations de quartier, colonne vertébrale de la révolution, restaient fermes sur leurs positions martelées dans chaque manifestation depuis le coup d’État : « Pas de négociation. Pas de partenariat [avec les militaires]. Pas de compromission ».
« Nous avons fait confiance une fois aux généraux, et ils nous ont trahis. Al-Bourhan et Hemetti ont été côte à côte pour mener le coup d’État d’octobre 2021. Et il faudrait les croire quand ils disent qu’ils veulent rendre le pouvoir aux civils ? », cinglait quelques semaines avant le début des combats Ahmad Ismat, porte-parole de la coordination des Comités de résistance de Khartoum. « Les militaires sont persuadés que le pouvoir leur revient car ils gouvernent ce pays presque sans discontinuer depuis l’indépendance et ils ont des intérêts économiques énormes qu’ils ne veulent pas perdre. Nous devons leur arracher le pouvoir avec la pression de la rue, comme nous l’avons fait en 2019 quand nous avons fait tomber Omar al-Bachir. Pas leur donner encore du souffle. »
Jeunes, sans organisation verticale, sans direction identifiée, les Comités de résistance n’ont pas été écoutés. Ni la sagesse populaire d’un dicton africain parfaitement applicable au Soudan : « il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans le même marigot ». En l’occurrence deux forces armées rivales dans le même pays.
Tous les conflits internes qu’a connus ce pays encore jeune sont liés à cette opposition entre le centre et ses périphéries.
Comment ce pays gouverné par l’armée quasiment sans discontinuer depuis son indépendance en 1956 s’est-il retrouvé avec deux institutions militaires rivales ? Il ne faut pas négliger dans les événements actuels un vieux démon soudanais : le conflit entre le centre et la, ou plutôt les, périphéries.
Le Soudan est une mosaïque complexe d’ensembles géographiques et démographiques différents. Depuis la domination anglo-égyptienne, ce sont les élites de la vallée du Nil et du Nord du pays qui gouvernent. Elles qui possèdent les pouvoirs politique, économique et culturel, elles qui donnent le ton de l’identité : celle d’un pays arabe, membre de la Ligue arabe, doté d’un drapeau aux couleurs des États arabes, (noir, vert, rouge, blanc), où l’origine géographique et la couleur de la peau peuvent être cause de discriminations. Tous les Soudanais sont noirs. Mais certains ont la peau plus foncée que d’autres. Le dialecte arabe soudanais, d’ailleurs, distingue les nuances de peau en attribuant à chacune un nom… de couleur : le « bleu » est le plus foncé, puis le marron, le vert, le jaune, le « lait ».
Tous les conflits internes qu’a connus ce pays encore jeune sont liés à cette opposition entre le centre et ses périphéries, qui se décline en de multiples dimensions : discriminations dans l’accès à l’éducation et au travail, problèmes fonciers, manque d’infrastructures, absence de considération et de reconnaissance culturelles. Deux longues guerres civiles entre le Nord et le Sud ont conduit, en 2011, à la scission du Sud, devenu Soudan du Sud. La question religieuse était bien moins centrale que celles citées ci-dessus. Le conflit, éteint par la séparation, couve encore dans les Monts Nouba et l’État du Nil bleu, parties les plus septentrionales de l’actuel République du Soudan. Dans l’Est du pays, des tentations séparatistes ont, un temps, menacé l’unité du pays.
Au Darfour, les populations « africaines », ou « bleues » si l’on adopte les dénominations en arabe soudanais se plaignaient des conflits avec les « arabes » éleveurs dont le bétail passaient sur les terres cultivées pendant les transhumances. Elles réclamaient aussi d’être représentées au niveau décisionnel régional et national. Une partie a pris les armes. La guerre, déclenchée en 2003, continue à bas bruit, malgré des accords de paix successifs. C’est dans ce contexte qu’a été formée l’armée du général Hemetti.
Jusqu’en 2018, les Forces de soutien rapide étaient cantonnées au Darfour. Elles se sont constituées à partir de milices armées issues de certaines tribus « arabes » nomades et éleveuses de bétail. Ces janjawid combattaient, au nom du pouvoir central de Khartoum et aux côtés des FAS, les groupes darfouris en rébellion depuis 2003. Elles ont acquis une terrible renommée en brûlant des villages et massacrant des civils.
Hemetti a pris la tête des FSR en 2013 et a acquis la confiance d’Omar al-Bachir. Le dictateur, se méfiant de plus en plus de son armée les a fait venir à Khartoum. Il les a déclarées « forces régulières » tout en les utilisant comme garde prétorienne. Ni Hemetti ni ses hommes n’ont jamais été acceptés, ni par l’élite militaire, ni par les hautes classes sociales de Khartoum. Ces « éleveurs de chameaux » et « gardiens de chèvres », comme ils sont aujourd’hui qualifiés avec mépris dans certains cercles de la bourgeoisie khartoumaise, venus de l’ouest du pays, lointain et sauvage, ne pouvaient pas appartenir aux cercles dirigeants du pays.
Entre deux diables, les FFC ont choisi de dîner avec l’un pour neutraliser l’autre.
Les officiers, et le général al-Bourhan en est un exemple parfait, viennent majoritairement de la vallée du Nil. Ils ont fréquenté les académies militaires et les écoles de guerre, ont reçu des formations en Égypte. Les hommes du rang reflètent la diversité démographique du pays. Mal payés, certes, mais ce sont de vrais soldats, des soldats de métier. « Un peuple, une armée », a martelé le général al-Bourhan dans sa seule intervention depuis le 15 avril.
Ce qui se joue aujourd’hui à Khartoum est le contrôle du centre du pouvoir. « La plupart des conflits au Soudan ont émergé pour asseoir une domination sur le centre politique », assurait, avant le déclenchement de la guerre, Mohamed Hassan Arabi, ancien gouverneur du Darfour pendant la transition démocratique et responsable du parti du Congrès, un des piliers des FFC. « Les institutions militaires sont instrumentalisées dans cette lutte. C’est extrêmement dangereux. Cela peut mener à une guerre civile. »
La finesse de l’analyse n’empêchait pas, curieusement, Mohamed Hassan Arabi de soutenir l’accord-cadre. Car il s’agissait, pour la coalition civile des FFC, de neutraliser les partisans du régime défunt d’Omar al-Bachir, les islamistes du parti aujourd’hui interdit du Congrès national (NCP, à ne pas confondre avec le parti du Congrès de Mohamed Hassan Arabi), dont le général al-Burhan est proche. Hemetti, au contraire, s’en est éloigné au point d’arrêter en personne Omar al-Bachir. Entre deux diables, les FFC ont choisi de dîner avec l’un pour neutraliser l’autre. Mais aussi long que fut le manche, il s’est révélé encore trop court.
Le samedi 15 avril, le processus politique s’est effondré en même temps qu’étaient tirés les premiers obus. Dans la capitale soudanaise connaissant, pour la première fois de son histoire contemporaine, le même genre de violences que celles subies par les périphéries du pays, seuls sont demeurés actifs les jeunes révolutionnaires. Ils ont d’abord lancé le hashtag « Ce n’est pas notre guerre », expliquant à longueur de communiqués que la population civile n’avait pas à prendre parti dans le jeu mortel de deux généraux. Quelques courageux ont écrit sur les murs de Khartoum « Non à la guerre ».
« Nous ne nous soumettrons pas au chantage nous intimant d’être aux côtés de l’un des deux camps de la guerre. C’est une guerre dans laquelle il n’y a pas de vainqueur et notre patrie est la perdante », écrit le 22 avril Amgad Farid, militant de longue date pour la démocratie et ancien chef de cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok, à la tête d’un gouvernement civil de transition de septembre 2019 à octobre 2021.
Au fur et à mesure des jours, cependant, l’opinion dans la capitale a basculé du côté de l’armée régulière. Malgré les communiqués soigneusement pesés des communicants payés par les RSF – allant jusqu’à mettre en place un numéro d’urgence, sorte de « numéro vert » pour les citoyens en détresse – les Khartoumais ont retenu les pillages et les exécutions sommaires par les hommes de Hemetti.
« Mais attention, le soutien à l’armée est provisoire, face au danger des paramilitaires, assure Mohamed, un étudiant en sciences du développement, joint dans un quartier populaire de Khartoum. Nous n’accepterons jamais que le pays soit gouverné par les militaires. Cette époque-là est révolue. Ils ont prouvé pendant toute l’histoire du Soudan qu’ils étaient incapables d’apporter la stabilité, la paix et le développement à leurs concitoyens. Ils prouvent maintenant qu’ils sont prêts à détruire le pays pour le contrôler ! » Mohamed, comme beaucoup, craint cependant que le jour où la population reprendra les rues pour envoyer les forces armées dans leurs baraques ne soit lointain.
Dans l’immédiat, les comités de résistance ont pris en main les affaires de la cité. Plus d’autorités, plus de services, plus d’organisations humanitaires, ces réseaux de quartier, très bien implantés, ayant la confiance de la population, restent les seuls vers lesquels les habitants coincés sous le feu peuvent se tourner.
Au risque de leur vie, des jeunes parcourent les rues pour renseigner de manière précise une carte interactive créée par une ONG soudanaise, sur laquelle sont indiqués les points tenus par les belligérants, les barrages militaires, les zones d’affrontement. « Nous informons ceux qui veulent quitter leur domicile quelles sont les rues les moins dangereuses, explique Abdallah, qui a attendu près d’une semaine avant de quitter son quartier, devenu invivable. Nous communiquons avec les chauffeurs de cars pour trouver des endroits de stationnement sûrs. Nous avons apporté de la nourriture aux personnes incapables de se déplacer. Nous avons fait de notre mieux pour apporter des médicaments et du matériel médical aux hôpitaux dans les premiers jours, mais nous avons été dépassés par les besoins. »
Bientôt, ils ne pourront plus rien faire. Au douzième jour de guerre, quand sont écrites ces lignes, les quartiers les plus exposés sont désertés, seuls restent ceux qui ne veulent ou ne peuvent quitter leur domicile. Les prisons ont été vidées de leurs condamnés de droit commun et aussi des caciques de l’ancien régime qui y étaient détenus depuis la révolution. « J’ai été menacé aujourd’hui par un homme du NCP qui me connaît, s’inquiète Ibrahim, membre d’un comité de résistance. Je dois partir, mais je n’ai plus d’argent liquide, les banques sont fermées, et même marcher à pied est trop dangereux : beaucoup de gens se sont armés de machettes pour se défendre, tous les voleurs et les criminels sont de sortie. »
Dans cette période de terribles incertitudes, une leçon peut déjà être tirée : le Soudan confirme, s’il en était besoin, que les militaires longtemps considérés comme des gages de gouvernance stable, cajolés par les chancelleries occidentales rêvant d’hommes forts, mènent leurs pays et leurs populations à la catastrophe. Ce temps du gouvernement des officiers est révolu, il est temps d’écouter les sociétés civiles, leurs aspirations, leurs compétences et leurs projets politiques.
