L’Extrême droite et le nom de l’Un
Le 9 mai 2018 naissait de la dépouille du Front national (FN) le Rassemblement national (RN). Était-ce encore la construction d’une de ces ruptures dont le parti d’extrême droite aime à se prévaloir ? En effet, l’extrême droite, dans sa course à la dédiabolisation, déploie une étrange temporalité heurtée qui, à chaque scansion, cherche à se présenter sous des auspices nouveaux. Ces effets de discontinuité ne trompent guère les chercheur.se.s qui ont depuis longtemps montré la permanence des pratiques, des idées et des personnels frontistes par-delà les sursauts du temps comme lors de la précédente rupture de 2011 marquant le passage de l’ère lepéniste à l’ère mariniste[1].
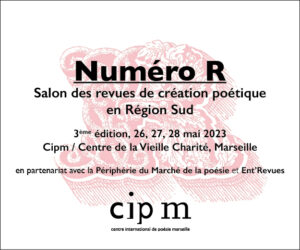
Le changement nominatif de 2018 a été construit médiatiquement et politiquement[2] comme une nouvelle étape devant envelopper un passé jugé trop tourbeux sous la glace de l’efficacité électorale. Marine Le Pen pouvait ainsi proclamer au congrès du parti tenu à Lyon, le 1er juin 2018, que ce changement de nom « ferme un chapitre de l’histoire de notre mouvement national ouvert il y a un peu plus de quarante-cinq ans, mais c’est pour mieux en ouvrir un autre qui, je le crois, ne sera pas moins glorieux ». Volonté exemplaire de contrôle du temps et de sa mise en récit.
Le réflexe immédiat de toute personne nourrie de sciences sociales est alors de débusquer l’écart entre le discours de nouveauté et la pratique du continu ou, pour le dire autrement, entre les Mots et les Choses. Je souhaiterais ici retourner la perspective en cherchant non pas à critiquer une rupture nominative qui masquerait la permanence d’une réalité frontiste mais plutôt de prendre ce changement de nom au sérieux, pour lui-même, aux mots[3] et d’y rechercher les imaginaires politiques qui s’y condensent plus ou moins consciemment.
Pour cela, deux penseurs nous accompagneront pour comprendre de quoi le « Rassemblement national » est le nom : en premier lieu Claude Lefort, militant de la première heure dans le groupe-revue
