Le(s) métier(s) du photojournaliste indépendant à l’ère numérique
«On est une petite entreprise à soi tout seul. », résume Thomas[1], photojournaliste indépendant depuis 2001, pour rendre compte de ses activités quotidiennes en tant que photographe freelance.
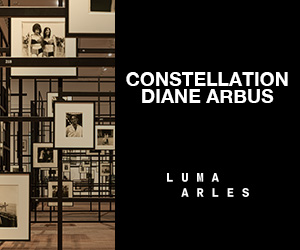
De la comptabilité jusqu’aux démarches commerciales, de la construction des sujets jusqu’à la post-production des photographies réalisées sur le terrain, le photographe de presse indépendant jongle entre les tâches. Plus encore, il endosse le rôle de plusieurs professionnels à la fois : photographe, journaliste, éditeur, retoucheur, commercial et même diffuseur, sont autant de métiers distincts qui se retrouvent parmi les compétences du photojournaliste moderne.
Se pencher sur le métier de photojournaliste aujourd’hui demande de prendre en compte une réalité ancienne, que partage ce professionnel de l’image avec le journaliste de presse écrite : son activité repose et a toujours reposé sur un flou définitoire, se constituant en « métier de frontière[2] ». Définir le métier de photojournaliste s’impose d’emblée comme un défi, dès lors que ses frontières sont peu définies, mouvantes, et que les statuts et conditions d’existence regroupés derrière cette même appellation sont multiples.
Les différentes définitions existantes, juridiques comme historiques, invisibilisent d’ailleurs les pratiques concrètes de ces travailleurs. D’un côté, la loi définit le photojournaliste, au même titre que le journaliste[3], comme celui dont au moins la moitié du revenu provient de collaborations régulières avec des organes de presse, repoussant ainsi hors des limites du métier les photographes indépendants ayant un revenu majoritairement issu d’autres marchés de la photographie. D’un autre côté, une définition plus ouverte du métier prend en compte le double statut du photojournaliste, à la fois photographe et journaliste, et son rôle dans la construction d’un sujet journalistique : loin de simplement illustrer un papier, il produit des images capables de « devenir […] l’histoire qui ra
