Quand les plateformes SVOD investissent dans la production hexagonale
La crise de la Covid-19 et les restrictions promulguées pour endiguer l’épidémie ont accéléré les changements d’habitudes de consommation des Français. Alors que le visionnage en ligne des films et séries est longtemps resté marginal – essentiellement cantonné aux contenus piratés –, il s’est rapidement démocratisé avec l’arrivée sur le marché d’acteurs étasuniens offrant un accès à des catalogues de films et séries moyennant abonnement (VàDA ou SVOD).
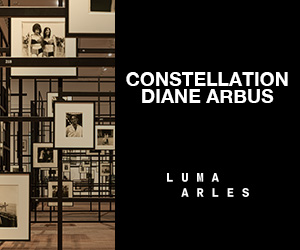
Le chiffre d’affaires généré par cette nouvelle fenêtre de diffusion a ainsi connu une croissance exponentielle (estimé à 1,726 milliard d’euros en 2022), au point de dépasser celui des salles (que nous pourrions estimer à 1,060 milliard d’euros en 2022[1]) – y compris lorsque celles-ci profitaient d’un contexte plus « favorable » (atteignant 1,448 milliard d’euros en 2019).
Quand bien même les publics reviennent progressivement devant le grand écran – sans pour autant que la fréquentation des salles ne retrouve les niveaux de 2019 –, ces nouvelles pratiques domestiques semblent s’être durablement installées et profiter à quelques sociétés : Netflix, Amazon, Disney et Apple. Comme l’essentiel des industries culturelles, le marché de la vidéo délinéarisé – qui compte près de 80 services en France – prend la forme d’un oligopole à frange. Ces quatre acteurs dominent en effet le marché, en captant l’essentiel des abonnements et des revenus afférents (plus de 90 %, selon certaines estimations), quand d’autres, de tailles plus modestes, attirent à eux un public limité, généralement autour de contenus spécialisés (films patrimoniaux, documentaires de création, etc.).
Cette transformation des modes de consommation et de diffusion des œuvres – qui a retenu largement l’attention des commentateurs et des universitaires – a eu tendance à reléguer au second plan les évolutions relatives aux univers de la production. Pourtant, dans le cadre de leur déploiement à l’international, les acteurs de l’oligopole investissent de
