Ce que le coup d’État fait à la démocratie – à propos du Chili
Un coup d’État est une rupture de l’ordre constitutionnel et juridique. On peut ajouter qu’il est une action perpétrée de l’intérieur de l’appareil d’État, alors qu’une révolution est une action qui émane de l’extérieur et d’en bas, du peuple ou des masses.
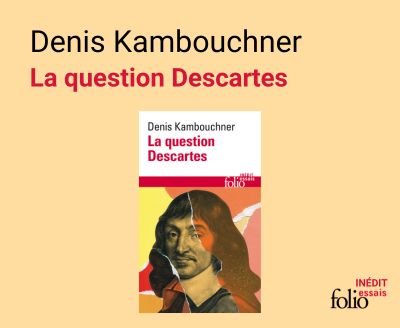
De plus, alors qu’un coup d’État ne va généralement pas au-delà d’un changement de gouvernement, une révolution produit des effets de longue durée qui affectent la structure sociale[1]. Mais cette double distinction est-elle si aisée à mettre en œuvre ? À titre d’exemple, le juriste Miguel Reale a considéré le coup d’État du 31 mars 1964 au Brésil comme une révolution et non un simple coup d’État « latino-américain »[2]. Mais, à l’examen, ce discours relève d’un mythe des origines, celui d’une « révolution démocratique et rédemptrice », qui n’est que l’un des « imaginaires » militaires parmi d’autres[3]. En règle générale, les auteurs d’un coup d’État se défendent de faire un coup d’État. Pour en juger, il faut certes prendre en compte la stratégie et l’idéologie de ses auteurs, à l’encontre de l’idée défendue par Malaparte dans Technique du coup d’État (1931)[4], mais à condition de faire subir à cette idéologie l’épreuve de l’histoire.
De 1964 à 1976, les coups d’État du Cône sud se font au nom de la doctrine de la « sécurité nationale ». Mais derrière cette « idéologie » commune, il y a des situations singulières qui ne peuvent être amalgamées. Ainsi du coup d’État du 11 septembre 1973 : ses auteurs affirment lutter pour la « restauration de l’ordre et de l’institutionnalité », rejetant ainsi la responsabilité de la rupture sur l’Unidad Popular (Arrêté N°1)[5]. Au sens strict, il est une contre-révolution qui entend liquider la révolution sociale en cours depuis 1970. Pour décider de sa portée effective, on doit s’interroger sur sa relation au passé national et sur ses objectifs de transformation de la société.
Une rupture avec près d’un demi-siècle d’histoire nationale
Le coup d’État, minutieusement préparé, renverse le gouvernement élu de S. Allende, impose la loi martiale, fait régner une terreur d’État d’une ampleur inégalée, ferme le Congrès, suspend la Constitution et interdit l’activité de tous les partis politiques. Il met fin à l’expérience de l’UP (Unidad Popular) en mettant brutalement fin à la démocratie. Selon une vue encore assez largement partagée, après une longue interruption de 17 ans (1973-1990), la démocratie aurait été « restaurée » avec l’arrivée au pouvoir du président Patricio Aylwin, premier président élu depuis le coup d’État. Cette expression de « démocratie restaurée » mérite qu’on s’y arrête tant elle concentre à elle seule des problèmes. En effet, elle présuppose que la démocratie « retrouvée » de 1990 est la même que celle qui prévalait avant 1973. Elle aurait en quelque sorte rétabli une continuité rompue par le coup d’État pendant 17 ans.
Regardons cela de plus près. Le premier gouvernement est entré dans l’histoire chilienne sous l’appellation de « gouvernement de la transition à la démocratie ». Si on la prend à la lettre, cette appellation exclut celle de « démocratie restaurée » : le gouvernement de transition à la démocratie peut être un gouvernement « démocratique » au sens où il a été élu démocratiquement mais il n’est pas encore la démocratie restaurée. Mais peut-on dire des gouvernements qui ont succédé à celui de P. Aylwin qu’ils n’étaient plus des gouvernements de transition à la démocratie mais des gouvernements de la démocratie ? De deux choses l’une : ou bien la démocratie se réduit à l’élection du président de la République au suffrage universel direct, soit à une procédure de désignation des dirigeants (ce que pense Hayek). En ce cas, le gouvernement d’Aylwin est déjà la démocratie restaurée, ou bien l’on considère que la démocratie est irréductible à une procédure électorale parce qu’elle désigne un régime politique et pas seulement un type de gouvernement, et en ce cas, ni le premier gouvernement ni ceux qui lui ont succédé ne sont la « démocratie restaurée ». Pour cela, il faudrait qu’un régime vraiment démocratique ait été établi, ce qui aurait impliqué une véritable rupture avec l’héritage de la dictature et pas seulement le retour à la pratique de l’élection des présidents.
Mais qu’en était-il au juste de la démocratie chilienne avant le coup d’État de 1973 ? Certes, le Chili des années 60-70 faisait figure d’« exception » sur le continent. La raison en était non seulement des « élections démocratiques régulières », mais aussi « le rôle de l’État en tant qu’acteur et régulateur de l’économie » et garant d’une « certaine équité sociale »[6]. Autrement dit, c’est à tout un ensemble législatif organisant l’État providence, et pas seulement aux nouvelles lois promulguées sous l’UP, que se sont attaqué les vainqueurs du coup d’État. Alors que la Démocratie chrétienne voulait renverser Allende tout en conservant le cadre juridique et législatif existant, les militaires ne cherchaient « pas seulement à renverser un gouvernement de gauche, mais surtout à faire disparaître les conditions sociopolitiques mêmes qui avaient permis son avènement » (Ricardo Parvex).[7]A cette fin il leur fallut « remonter à presque 50 ans d’histoire politique chilienne », très exactement à la Constitution de 1925 qui avait consacré pour la première fois dans son article 10 le droit à la protection sociale et avait affirmé : « C’est un devoir de l’État de veiller à la santé publique et d’assurer le bien-être et l’hygiène du pays. »[8]
Aussi l’assemblée militaire qui succède au gouvernement d’Allende abroge la Constitution de 1925, considérant que la volonté de la nation avait été mise à mal par cette Constitution. Et c’est pour rétablir les conditions d’expression de cette volonté que la junte procède à la destruction des registres électoraux et à la suspension sine die de la vie démocratique dans le pays. Plus largement, les textes constitutionnels émanant du gouvernement militaire comme les discussions au sein de la commission chargée de rédiger une nouvelle Constitution, ne laissent aucune place au doute : « l’intention initiale est effectivement de détruire la Constitution en vigueur de 1925 ». Le décret-loi 178 déclare à cet effet que la junte détient à la place du peuple la plénitude du pouvoir constituant, s’arrogeant ainsi le droit d’établir une nouvelle Constitution[9]. Sous ce rapport, celui de l’histoire politique et institutionnelle, septembre 1973 opère une rupture avec près d’un demi-siècle d’histoire.
Les objectifs : changer de fond en comble toute la société
Venons-en à présent à une deuxième question : quel nouvel ordre la junte militaire entendait-elle établir pour remplacer l’ancien ? Dès 1974, la junte proclame dans sa Déclaration de principes de 1974, sa volonté de donner au Chili une « nouvelle base institutionnelle » afin de « reconstruire le pays moralement, institutionnellement et matériellement. »[10] La reconstruction se veut donc intégrale : elle ne doit épargner aucun domaine. La même année, Pinochet s’arroge le pouvoir exécutif avant de se faire nommer en décembre président de la République. Finalement, en avril 1975, alors que la junte se débat avec une grave crise économique, ce dernier fait taire toute opposition interne, impose le tournant néolibéral et appelle les Chicago boys à prendre en main l’économie du pays. L’extrême centralisation du pouvoir va de pair avec le tournant néolibéral. Il y a là une caractéristique propre au processus chilien qui tranche avec ce qui se passe en Argentine à partir de 1976. Car si l’influence de l’école de Chicago s’exerce également dans les deux pays, si l’unité n’y a pas précédé les coups d’État, on observe en Argentine, tout à l’inverse de la centralisation qui l’emporte au Chili, une tendance au morcellement et aux dissensions : la structuration du pouvoir censée garantir un contrôle réciproque entre les forces et une élaboration consensuelle des décisions ne permet pas d’éviter les fractures et les négociations permanentes entre les trois armes conduisent par moments à la paralysie totale.[11]
Le centralisme autoritaire apparaît dans cette mesure comme la condition de la durée des réformes opérées par la junte. Ce n’est pas un hasard si la figure de l’histoire chilienne qui a la prédilection de Pinochet est celle de Diego Portales, ministre en 1830, considéré comme le « père fondateur de la nation » et partisan d’un « gouvernement fort et centralisateur ». Ce dernier est le véritable inspirateur de la Constitution de 1833 qui consacre « l’autoritarisme présidentiel » comme norme[12]. Le chef de l’exécutif a ainsi le pouvoir de désigner députés, sénateurs, juges et intendants, ces derniers placés à la tête de chaque province étant responsables devant lui seul et chargés d’exécuter ses ordres, selon une tradition qui s’est maintenue dans la Constitution de 1925[13] et qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Cependant, si la junte oppose la Constitution de 1833 à celle de 1925, cette instrumentalisation rhétorique ne doit pas nous abuser : avec la centralisation autoritaire, il ne s’agit pas de revenir de 1925 à 1833, mais d’accomplir une véritable « révolution capitaliste » (Tomas Moulian) et de la rendre irréversible.
En d’autres termes, l’objectif poursuivi par la junte est de changer radicalement la société chilienne. Entre 1978 et 1982, des pans entiers de l’activité sociale sont partiellement ou totalement privatisés : ces réformes, dites des « sept modernisations », concernent la législation du travail, les retraites, la santé, l’éducation, la justice, le secteur agricole et agraire, et la régionalisation. Si certaines réformes en Argentine font écho à ces modernisations, leurs limites viennent de ce qu’elles ne s’inscrivent pas toutes dans un nouveau cadre institutionnel[14].
Au Chili, la nouvelle Constitution promulguée en 1980, 7 ans après le coup d’État, fait apparaître très clairement la stratégie à long terme de la junte. L’objectif poursuivi par son artisan, Jaime Guzman, révèle une stratégie mûrement réfléchie. Dans un texte de 1979 intitulé El camino politico, ce professeur de droit constitutionnel disciple de Hayek affirme : « L’essentiel n’est pas de savoir qui gouverne, mais plutôt quelle est l’étendue de son pouvoir en accédant à la conduite de l’État. C’est-à-dire que si les adversaires parviennent à gouverner, ils se retrouveront contraints à suivre une action pas si différente de celle que l’on souhaiterait parce que… la marge d’alternatives que le terrain impose en fait à ceux qui y jouent est suffisamment réduite pour rendre le contraire extrêmement difficile. » La métaphore des règles du jeu imposées par le terrain est ici parfaitement explicite. Elle a pour fonction de signifier que ces règles doivent s’imposer à tous les gouvernants, y compris aux « adversaires ». Il s’agit en d’autres termes d’empêcher par avance qu’une alternance électorale ne se transforme pas en une alternative politique : « Une démocratie ne peut être stable que si dans les élections populaires l’essentiel de la forme de vie d’un peuple n’est pas en jeu. » [15]
En fait, « règles du jeu » et la « forme de vie » renvoient au fonctionnement d’une société de marché. Au cœur de la nouvelle Constitution, on trouve en effet un principe fondamental, le principe de subsidiarité. Ce principe tire son origine de la doctrine sociale de l’Église catholique élaborée au XIXe siècle et récupérée au XXe siècle par le corporatisme qui entendait réhabiliter la valeur de toute une série d’organismes intermédiaires, comme la famille, les corporations, les régions, l’Église, les Forces armées, à l’encontre de l’individualisme du contrat social. La Constitution de 1980 déclare d’ailleurs dans son article 1 : « La famille est le noyau fondamental de la société. L’État reconnaît et soutient les groupes intermédiaires à travers lesquels s’organise et se structure la société »[16]. Jaime Guzman réinterpréta ce principe dans le sens d’une suppression de l’étatisme paralysant et d’une défense de la liberté individuelle dont la base fondamentale résiderait dans la liberté économique, la propriété privée et le marché[17]. On vérifie là une constante de l’histoire du néolibéralisme : ce dernier ne fait jamais qu’emprunter à un vieux fond qui l’a précédé, il le transforme pour mieux la subordonner à sa propre logique.
Sur le plan idéologique, l’avantage du principe de subsidiarité est de concilier une représentation naturaliste de l’ordre social avec une valorisation du marché où les individus sont en relation de concurrence les uns avec les autres. Mais élevé au rang de principe constitutionnel, il signifie que l’État et ses organismes ne peuvent participer aux marchés que lorsque l’initiative privée est insuffisante et sous réserve d’une autorisation préalable donnée par le Congrès. Cette logique privilégie la privatisation des services de base, la remise des droits fondamentaux (santé, éducation, logement, pensions, etc.) aux mains de particuliers, et enlève à l’État la responsabilité de garantir les droits des individus. Cela ne veut pas dire que l’État reste inactif : il s’agit pour lui d’œuvrer activement à la formation de marchés. Ce fut particulièrement le cas de la formation d’un marché de l’eau puisque la Constitution de 1980 et le Code de l’eau de 1981 stipulent l’une comme l’autre que celui qui a des droits sur l’eau est le propriétaire de ces droits et que la propriété des droits sur l’eau confère la propriété de l’eau. Loin d’être « faible » ou « minimal », l’État néolibéral est un État « activiste et efficace » (Marcus Taylor) : il se défend d’intervenir en faisant directement des offres sur les marchés, mais il intervient en amont sur les conditions de formation et de fonctionnement des marchés.
Ce que la « démocratie sous tutelle » issue du coup d’État fait à la démocratie
Nous sommes à présent en mesure de répondre à une troisième question : qu’est-ce que cela fait à la démocratie ? L’élection des présidents de la République à partir de 1990 ne remet nullement en cause la logique néolibérale mise en place par la dictature. Pour le comprendre, il faut remonter à la situation politique chilienne de la fin des années 1980. Dès avant 1989, dans une lettre de Boeninger à la DC de 1986, l’exclusion de la gauche communiste et l’acceptation de la Constitution de 1980 sont présentées comme deux conditions non négociables de la paix civile. Le pacte conclu par les partis de la Concertacion avec les Forces armées a sa propre logique : toute tentative de revenir sur ces conditions est par avance condamnée comme faisant le jeu des militaires. Dans ces conditions, le chantage d’un retour à la dictature (l’« épée de Damoclès » d’un nouveau coup d’État) est vite intériorisé par les acteurs politiques de la « transition », quelle que soit leur couleur politique, et ce chantage continue encore de peser, soit inconsciemment, soit utilisé consciemment à des fins politiques. Le plus grave est qu’un tel chantage ne peut opérer qu’au prix d’une dépolitisation de la démocratie, théorisée par Boeninger en 1997 avant d’être reprise par toute la Concertacion. Son idéologie, qui est celle de la « gouvernabilité », repose sur trois objectifs : la stabilité politique, le progrès économique, la paix sociale.
Le plus remarquable est que ces objectifs sont présentés comme étant indépendants de l’opposition entre démocratie et autoritarisme et donc indifférents à l’opposition des régimes politiques. Ainsi, la paix sociale est définie comme une situation où « la négociation remplace la pression de masse ou les menaces militaires ». Cette présentation justifie rétrospectivement un bilan à charge de la stratégie de l’UP rendue largement responsable de la crise de la démocratie en 1973 en raison de sa « radicalisation idéologique ». La démocratie est redéfinie, non plus comme un régime opposé au régime autoritaire, mais à partir de l’opposition entre démocratie de consensus et démocratie majoritaire (Lijphart) : alors que la démocratie majoritaire impose la volonté d’une courte majorité, ce qui est en fait un système conflictuel, la démocratie consensuelle privilégie la conclusion d’accords entre les partis par la voie de la négociation et du compromis. Cette démocratie s’avère une démocratie contre-majoritaire. Elle favorise la construction de grandes coalitions multipartites de gouvernement dans lesquelles les projets politiques sont relégués au second plan, car ils sont considérés comme des facteurs de « polarisation » et de « division » (Boeninger).
Loin de rester lettre morte, cette idéologie eut des conséquences très pratiques sur les politiques mises en œuvre par les gouvernements de la « transition ». Prenons quatre exemples : la question de la justice, la loi sur les pensions, la réforme des universités, la loi sur le crédit étudiant. La Commission Vérité et réconciliation (1990) subordonne explicitement la recherche de la vérité à l’impératif de réconciliation de tous les Chiliens, au lieu d’exiger l’abrogation de la Loi d’amnistie de 1978 (à la différence de ce qui s’est passé en Argentine entre 1983 et 1985). Deuxièmement, la Loi sur les Pensions votée en 1980 qui remet aux mains des AFP (sociétés privées qui administrent les fonds de pension) la gestion des capitaux générés par les cotisations des salariés : les modifications apportées à ce système par les gouvernements de la Concertacion ont accentué la fonction de l’État qui est de faciliter la concurrence entre les AFP. Troisièmement, la réforme des universités de 1981 fut modifiée au début des années 2000 de manière à encourager la concurrence entre les universités privées et publiques pour l’obtention des ressources publiques. Enfin, la Loi sur le Crédit avec l’aval de l’État, promulguée en 2005, fait de l’État le garant des dettes des étudiants auprès des banques. Dans ces deux cas (universités et fonds de pension), la fonction de l’État consiste à structurer un marché en organisant les conditions de la concurrence. Avec la Concertacion, on ne sort jamais de la logique de l’État subsidiaire. En fin de compte, ni les nouvelles relations sociales et économiques de la société de marché, ni la nouvelle organisation politico-administrative de l’État autoritaire ne furent jamais remises en cause.
Un pas en avant, deux pas en arrière ?
C’est tout ce système de gouvernement fondé sur le consensus et l’accord entre les partis que remet directement en cause le « Réveil d’Octobre ». La proposition de Constitution faite par la Constituante traduisait à sa manière cette révolte sociale par ses avancées les plus significatives : la reconnaissance de la plurinationalité, l’extension des droits sociaux, la fondation de l’État sur les droits des citoyens, la réinterprétation féministe de la parité comme plancher et non comme plafond, le statut de l’eau comme bien commun naturel inappropriable qui interdisait tout marché de l’eau. Elle rompait avec le principe de subsidiarité, mais sans opérer un retour à la Constitution de 1925, qui restait présidentialiste et centralisatrice. Elle ambitionnait en effet de refonder l’État sur l’obligation de garantir les droits des citoyens, et rompait avec le centralisme portalien en mettant fin au système des intendants par une décentralisation inédite en substituant au Sénat une Chambre des régions. Elle cherchait à expérimenter une voie originale en rompant avec la longue tradition de l’État-nation centralisateur. Ce fut et, à mes yeux, c’est toujours sa grandeur, même si cette remise en question de tout l’héritage du centralisme d’État en 12 mois tenait d’un pari difficile à gagner.
Où en sommes-nous aujourd’hui, un peu plus d’un an après le Rechazó du 4 septembre 2022 ? La victoire électorale de l’extrême-droite aux élections au Conseil constitutionnel le 7 mai semble exprimer une loi de la mécanique politique bien connue : en vertu d’un mouvement de balancier, le retour de l’extrême droite participerait d’un mécanisme propre à maintenir l’équilibre ou la stabilité, comme une sorte d’équivalent de la loi de l’égalité de l’action et de la réaction en physique[18]. Mais cette transposition superficielle occulte l’essentiel : la violence de la réaction actuelle répond sans conteste à la force et à l’intensité de l’« explosion sociale », mais elle ne lui est pas égale et ne cherche nullement à rétablir un équilibre rompu : elle est avant tout dictée par une soif de revanche due à la peur éprouvée par l’élite politique et sociale. Ce qui se manifeste aujourd’hui au Chili c’est une volonté politique délibérée, non de rétablir un certain équilibre, mais de tout faire pour annuler le cycle qui s’est ouvert le 18 octobre 2019 et qui s’est fermé le 4 septembre 2022, ce qui ne revient nullement au même. La droite et l’extrême-droite font tout ce qu’elles peuvent pour effacer jusqu’aux traces de ce mouvement inédit par sa durée comme par sa radicalité. Qu’on en juge par l’attitude des députés de droite approuvant le projet de résolution du 22 août 1973 qui déclare inconstitutionnel le gouvernement d’Allende ou encore par l’amendement proposé au Conseil constitutionnel par des républicains visant à élever la Constitution au-dessus des traités internationaux sur les droits de l’homme, ce qui serait un recul y compris par rapport à la Constitution de 1980.
Ce que le coup d’État fait à la démocratie, par ses effets à long terme, c’est qu’il tend à la réduire à une recherche d’accords techniques qui la vident de tout contenu politique au détriment de la participation du plus grand nombre à la délibération collective. Mais il y a plus grave encore. Selon la Constitution de 1980, appeler aux plébiscites est une prérogative du président. Selon Boeninger, qui y voit le « rétablissement de la légitimité du processus démocratique », l’opposition aurait fini par reprendre à son compte le recours au plébiscite. Cette confusion entre le recours au plébiscite et la légitimité démocratique est lourde de conséquences. En 1932, Carl Schmitt vantait en ces termes le « système plébiscitaire de la démocratie directe » : « Le peuple ne peut que dire “oui” ou “non”. Il ne peut pas conseiller, délibérer ou discuter ; il ne peut gouverner ni administrer ; il ne peut pas non plus édicter de normes, mais seulement sanctionner par son “oui” un projet de loi qui lui est soumis. Surtout, il ne peut pas poser de question, mais seulement répondre par “oui” ou “non” à une question qui lui a été posée. »[19]
Privilégier la recherche d’accord entre les partis et recourir au plébiscite comme voie de la démocratie directe sont deux manières de tourner le dos à la démocratie. Ce que fait aujourd’hui encore le coup d’État, c’est qu’il nous fait intérioriser des pratiques qui relèvent de la démocratie plébiscitaire. Or démocratie plébiscitaire comme type de consultation populaire et recherche du consensus entre les partis comme méthode politique ont en commun de présupposer la passivité de citoyens tenus à distance de la participation à la délibération collective qui fait la véritable démocratie.
Pour prendre la mesure du mal profond fait à la démocratie par ces effets différés du golpe, il faut considérer la transformation subjective profonde opérée par plus de 40 ans de domination néolibérale. La norme du vote obligatoire fut adoptée par le Congrès en juin 2021, rompant avec une longue tradition de volontariat. Elle a aggravé le fardeau subjectif du plébiscite de sortie : modifier à la veille de l’ouverture de la Constituante les règles du vote a eu pour effet de faire retomber par avance sur les épaules de l’individu menacé de sanctions financières la lourde charge d’une décision collective engageant le destin du pays. Dans ces conditions, la subjectivation néolibérale, en remodelant le rapport de l’individu à la propriété, a généré une peur de l’incertitude consubstantielle à la démocratie qui a pesé à l’instant du vote, tout particulièrement chez ceux qui avaient très peu de propriétés.
Le coup d’État du 11 septembre ne fut pas une révolution, mais une contre-révolution. Mais, loin de se limiter à un changement de gouvernement, il permit d’initier une révolution profonde et durable qui a bouleversé toute la structure sociale et continue aujourd’hui encore de miner les bases de la démocratie. Le passé du présent continue ainsi d’insister dans le présent.
NDLR : Pierre Dardot a récemment publié La mémoire du futur. Chili, 2019-2022 chez Lux éditeur
