Multipolarité dystopique : portrait d’un monde qui vient
Le monde est-il redevenu bipolaire ? Tirée des propos de Joe Biden aux premiers jours de l’agression subie par l’Ukraine, l’hypothèse d’un retour à la case guerre froide a fait son chemin depuis lors, d’abord sous la forme, choisie par le président américain, d’une confrontation planétaire entre « démocraties et autocraties », puis dans la version privilégiée par Vladimir Poutine lui-même, qui oppose l’« Occident global » aux pays réfractaires à son hégémonie.
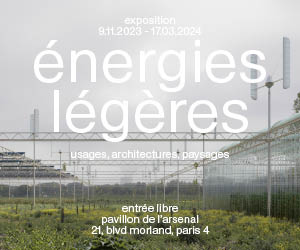
Sans doute trouvera-t-on peu d’observateurs sérieux pour valider les prétentions colportées par ces représentations. Respecter les libertés fondamentales de ses concitoyens n’est pas une condition requise pour recevoir l’aval de Washington et le Kremlin peut difficilement être tenu pour le quartier général des partisans du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Reste que de telles objections n’affectent guère l’attrait du prisme qui rapporte les conflits en cours à un antagonisme entre deux blocs.
Ainsi en va-t-il des avocats respectifs du droit d’Israël à se défendre et de la lutte des Palestiniens pour leur libération : les premiers ne manquent jamais de présenter l’État hébreu comme un avant-poste exposé du monde libre, tandis que les seconds en sont réduits à gager le sort de leur cause sur la mobilisation des populations rétives à l’impérialisme occidental. Il se pourrait toutefois que, sous ses deux modalités, cette clé de lecture des conflits internationaux se révèle bientôt caduque.
Parallèles hasardeux
Non content de jeter un même opprobre sur l’incursion meurtrière des miliciens du Hamas et l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, Joe Biden a justifié son blanc-seing à la riposte israélienne en l’associant à la résistance ukrainienne, comme si l’une et l’autre relevaient de la légitime défense de démocraties menacées par les visées expansionnistes de leurs autocratiques voisins. Concurremment destiné à fixer les regards de ses électeurs sur les crimes du 7 octobre 2023 et à convai
