Quand l’anthropologie perd le Nord
«À quoi pense le Sud[1] ? » : cette question fait écho à une thématique qui, si j’ose dire, colle à la peau de l’anthropologie depuis ses origines, celle de l’Altérité. Cette interrogation est coextensive au projet ethnographique qui s’est longtemps défini comme une exploration de l’ailleurs, une quête aux antipodes. À quoi pensent ces gens, et par ricochet que nous apprend sur nous-mêmes cette confrontation avec leur pensée ?
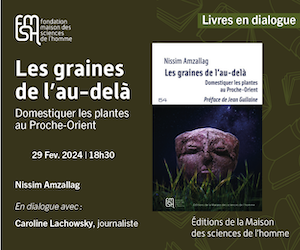
Ce rapport constitutif à l’altérité a fait l’originalité de la démarche des anthropologues, mais nous savons aujourd’hui à quel point il est problématique et à quelles dérives il a pu conduire sur les plans éthique et épistémologique. Interprété dans ce contexte, le fameux : « Je hais les voyages et les explorateurs » qui ouvre Tristes tropiques prend un tout autre relief. Il met en cause l’idée selon laquelle une translation géographique, un déplacement aux antipodes, serait productrice de savoir, l’idée qu’on peut saisir, appréhender, la pensée de ces Autres.
L’une des spécificités de l’anthropologie par rapport aux autres sciences sociales est son arrimage à un terrain. Ethnographie, terrain, ce modèle a longtemps été inséparable d’un trajet spatio-intellectuel entre les deux hémisphères. La globalisation néolibérale et les transformations qu’elle a induites ont profondément remis en cause la réification altéritaire qui caractérisait ces approches du réel. En sorte qu’on a vu s’esquisser un renversement de perspective qui s’est concrétisé dans la critique postmoderniste de l’ethnographie et plus récemment dans le courant postcolonial très présent dans ce secteur des sciences sociales.
Le moment gramscien en anthropologie
C’est ce contexte qui amène à réinterroger des œuvres et des engagements qui relèvent d’une période relativement éloignée de notre époque, celle qui va de l’après-guerre aux années 1960 lorsque le structuralisme s’est imposé et que les théories qu’il a suscitées se sont révélées particulièrement attractives. De
