La morsure et le pot : l’envenimation entre arts et sciences
Un petit village du sud de l’Inde héberge une initiative étonnante. Chaque jour pendant la saison de la chasse, des dizaines de villageois adivasi appartenant à la communauté Irular (catégorisée dans les populations dites tribales) apportent des serpents parmi les plus dangereux du pays tels que cobras, vipères ou bongares, auprès d’un centre coopératif de collecte de venin, le seul d’Inde et géré par la communauté.
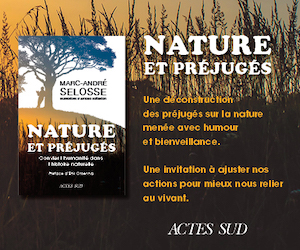
Les serpents sont conservés par centaines dans de simples pots de terre, disposés au sein d’une fosse pendant quelques semaines, le temps d’extraire leur venin, puis ils sont relâchés dans la nature. Le venin fait alors l’objet d’une série d’opérations : réfrigéré, purifié et lyophilisé, il est acheminé vers des firmes pharmaceutiques qui l’injectent pendant plusieurs mois à des chevaux afin de développer leur immunité face à l’envenimation. Les anticorps de chevaux seront à leur tour employés dans la fabrication de sérum antivenin, un médicament essentiel.
Une approche réflexive du « rendre compte »
L’envenimation, vue depuis la coopérative Irular, pose une série de questions aux sciences de la nature, aux sciences sociales et aux arts visuels : comment dire le processus de production des antivenins, depuis la capture des serpents jusqu’à l’injection du sérum à des patients ? Comment expliciter les conceptions associées au venin à partir des différentes positions sociales ou professionnelles des groupes impliqués (depuis les chercheurs scientifiques jusqu’aux villages irulas) ? Comment y associer des connaissances traditionnelles, légendes, pratiques rituelles associées au serpent et au venin en Inde et comment les connecter à l’histoire des relations sociobiologiques entre espèce humaine et espèces de serpents[1] ? Dans quelle mesure les confrontations de ces conceptions manifestent la mise en commun de mondes et d’ontologies contradictoires[2] ? In fine, comment rendre compte des processus de recherche par des méthodes « sensibles » ? Quels
