Porto Rico : de la pauvreté à la paupérisation
La pauvreté est un sujet récurrent dans la presse portoricaine. Avec 44,5% de la population et 40% des familles vivant sous le seuil de pauvreté – défini au niveau fédéral américain par un revenu familial de 26.000 dollars annuels – Porto Rico reste en 2019 la juridiction la plus pauvre des États-Unis. Une étude de 2018[1] montre que depuis 2000, la pauvreté affecte en particulier des groupes ciblés – principalement les femmes, les enfants et les mères seules avec enfants, avec des taux moyens supérieurs à 50%.
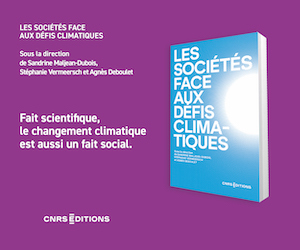
Si la hausse du salaire minimum en 2022 puis 2023 (désormais 9,5 dollars de l’heure) et la baisse significative du chômage témoignent d’une meilleure situation économique, l’inflation a limité les effets positifs de ces deux facteurs, et n’a pas empêché une augmentation significative du niveau de pauvreté dans certaines petites villes, au cours de la période 2014-2018[2].
Malgré ces données et le solide travail des sociologues[3], le sujet demeure polémique en raison d’un schéma de pensée courant identifiant la pauvreté à l’absence de ressources vitales, et conduisant à nier la réalité du phénomène. À l’appui de cette vision des choses, qui tend parfois aussi à stigmatiser la personne pauvre en en faisant une personne paresseuse voire alcoolique, il est fréquent de citer la République dominicaine, Haïti et certains pays d’Amérique du sud, qui fourniraient l’étalon de la pauvreté, la « vraie » – celle que les classifications qualifient d’absolue, quand manque le nécessaire à la survie, par différence avec la pauvreté relative qui se définit par rapport à un certain niveau du revenu médian dans un pays donné.
Le motif de cette mise à distance tient notamment à l’existence de programmes d’aides fédérales permettant de pallier jusqu’à un certain point le manque de ressources. Ainsi du Programme d’Aide Temporaire aux Familles dans le Besoin (Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas ou TANF), ou du Programme d’Assistance Alimentaire (Programa de Asistencia Nutricional ou PAN) dont bénéficient à Porto Rico 61% des familles avec des enfants mineurs[4], et qui permet l’achat dans les supermarchés de denrées alimentaires sélectionnées.
C’est cette tension que résume à lui seul le lieu commun local selon lequel « on dit que les gens sont pauvres, mais le parking de Plaza las Américas [le plus grand centre commercial des Caraïbes, situé à San Juan] est toujours plein ». Si depuis les années 1960 est révolue l’époque du Fanguito – le bidonville de San Juan construit sur un marais, avec ses baraques et ses passerelles en bois – alors parler de pauvreté n’a, pour beaucoup, plus vraiment de sens.
Ce débat autour de la pauvreté n’est certes pas propre à Porto Rico mais il est significatif d’un impensé que partagent les deux positions : il consiste à ne pas voir que la pauvreté est construite, historiquement et socialement, et qu’il serait plus juste de parler de paupérisation, au sens de processus qui rend pauvre, que de pauvreté comme d’un état ou d’une condition, de même que certaines études sur l’esclavage invitent à parler de personnes asservies plutôt que d’esclaves.
En tant que processus, la paupérisation est une forme d’injustice produite par des facteurs historiques matériels et idéologiques ainsi que des politiques publiques, qui intègrent souvent des principes discriminatoires liés à la race, au genre ou à l’âge. Prise en ce sens, la pauvreté devrait être moins abordée comme un manque mesuré à la lumière d’une norme dont l’évaluation est souvent problématique (ce qui ne veut pas dire qu’elle est inutile) que conçue comme une relation.
On entend par là non pas la « pauvreté relationnelle », soit le fait, pour un individu ou une famille, d’avoir peu de relations sociales, mais une approche consistant à examiner les relations sociales, politiques et économiques qui produisent et entretiennent la pauvreté, et qui constituent ainsi le processus de paupérisation.
Si les travaux d’Amartya Sen et de Martha Nussbaum ont montré que celle-ci est avant tout un manque de liberté des individus causé par une situation matérielle les empêchant de développer leurs « capabilités », soit la possibilité de faire des choix parmi les biens qu’ils jugent estimables et de les atteindre, il reste à déplacer l’analyse des symptômes vers les causes, et de signaler le caractère toujours actif de ces causes, c’est-à-dire la permanence du processus de paupérisation.
Cette approche adoptée par certains chercheurs[5] est par nature polémique parce qu’elle signale, pour le dire rapidement, que la paupérisation des uns est le résultat d’une oppression économique, sociale ou politique conduisant à l’enrichissement des autres. Corrélative d’une analyse des injustices fondée sur les rapports de force ou de domination entre groupes sociaux, elle est décisive pour transformer en profondeur la vision de la pauvreté, en la dynamisant et en l’élargissant bien au-delà des seuls manques matériels, et pour transformer aussi les politiques publiques destinées à la combattre.
Cette approche invite aussi à comprendre que la pauvreté n’est pas une question seulement économique – pour autant que l’économie se limite à mesurer les biens disponibles ou non – mais plus largement une question aussi et peut-être avant tout politique, au sens où elle relève d’une réflexion sur les principes de justice et de liberté qu’une société se choisit et la façon dont elle les met en œuvre.
Ce changement de perspective à l’œuvre dans le film de la portoricaine Glorimar Marrero, La Pecera (2023) (« L’aquarium »), explique peut-être, entre autres facteurs, son succès relatif dans les salles de cinéma locales et les festivals internationaux – il a été nominé dans la catégorie du meilleur film ibéro-américain lors de la cérémonie des Premios Goya 2024 en Espagne.
Le scénario est le suivant : Noelia, portoricaine d’une quarantaine d’années, connaît une récidive agressive de son cancer après quelques années de rémission. Incitée par son médecin et son compagnon à se rendre en Espagne pour y être opérée, elle décide de se libérer de toute injonction médicale et de quitter San Juan, la capitale de Porto Rico, pour se rendre sur sa petite île natale et rurale de Vieques, à l’est de l’île principale de Porto Rico, où habite sa mère Flora. Tout en lui cachant un temps son état de santé, elle rejoint un mouvement associatif local qui œuvre pour éliminer les explosifs et les débris, terrestres et marins, laissés par les bases américaines qui, de 1941 à 2003, occupèrent les deux tiers de l’île et y menèrent des exercices militaires.
Ses forces s’épuisent dans cette lutte dangereuse, notamment lors d’une plongée sous-marine où surgissent, devant la caméra, les restes en lente décomposition d’un arsenal aussi impressionnant par sa taille que par ce qu’il laisse supposer de la qualité de l’eau et de ses effets sur les écosystèmes et les corps. L’annonce de l’arrivée imminente de l’ouragan Irma – qui frappa Porto Rico en septembre 2017 – met fin temporairement à cette mission, et correspond aux derniers moments de Noelia dont le spectateur sait que la maladie va l’emporter sous peu.
Si la réalisatrice reconnaît avoir introduit dans son film des éléments autobiographiques liés à la maladie de sa propre mère, elle assume aussi la dimension métaphorique du scénario : le cancer envahit le corps de Noelia comme le « cancer » légué par la situation coloniale mine Porto Rico, sous la forme directe de la pollution provoquée par les infrastructures abandonnées près des côtes. On dira que cette métaphore est trop appuyée pour être convaincante, et que le pathologique appliqué au politique peut conduire à de douteuses dérives.
Le film échappe toutefois à ces pièges car le corps de Noelia est plus qu’une métaphore du Porto Rico actuel : il est aussi et surtout le lieu même des difficultés économiques, politiques et sociales que l’île connaît depuis deux décennies. Il est le lieu même de la paupérisation, comme l’est celui de la majorité des femmes de Porto Rico[6]. La paupérisation n’est pas ici dans le manque d’accès à des ressources matérielles, en l’occurrence médicales – la protagoniste choisit de ne pas partir se faire soigner en Espagne, sans que ce soit pour des raisons économiques – mais dans l’injonction à se soumettre à un ordre des priorités prédéterminé, plaçant par exemple l’individu avant le commun, la préservation de la personne avant celle de la nature.
Telle est la situation de « l’aquarium » qui donne son titre au film : une injustice structurelle entre celui qui l’acquiert et l’aménage, et le poisson qui s’y meut sans se savoir prisonnier d’un environnement qui détermine et limite le champ de ses possibilités. L’aquarium est, en ce sens, une structure ou un appareil de paupérisation, en ce qu’il dépossède le sujet de l’initiative de ses choix et de leur configuration, en ayant en outre ici des effets négatifs sur son corps. En prenant le double parti de ne pas se soigner et de s’engager à Vieques, Noélia n’abolit pas l’aquarium mais le rend palpable et le fait trembler, parce qu’elle configure ses propres choix hors des schémas attendus.
Au-delà de la part métaphorique du film, des politiques publiques portoricaines participent plus directement de « l’aquarium » en tant que structure de paupérisation. Ainsi de la Loi 22 (2012) puis la Loi 60 (2019), qui accordent des exemptions fiscales à des particuliers prenant leur résidence à Porto Rico, aux trois conditions suivantes : résider plus de 183 jours par an à Porto Rico, y acheter une résidence dans un délai de deux ans, et donner chaque année 10.000 dollars à deux organisations sans but lucratif (2 fois 5.000).
Ce haut ticket d’entrée destiné à attirer des investisseurs est par définition inaccessible aux Portoricains vivant sur place. Ces derniers subissent de plein fouet l’augmentation des tarifs de l’immobilier (23% en moyenne entre 2014 et 2020) qu’une telle mesure a contribué à accentuer, selon le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz : « Les personnes qui entrent dans le cadre de la Loi 22 n’apportent pas grand-chose à l’économie portoricaine. Ils dépensent un peu, mais très peu, et en même temps ils augmentent les prix de l’immobilier et le coût de la vie pour les autres. »
Ainsi, le double fait de comprendre la pauvreté uniquement en termes économiques de manque matériel, et d’adopter une politique publique se limitant à débourser des fonds pour y pallier montre ici toutes ses limites et ses vrais effets : c’est un facteur de paupérisation.
