« Bifurcation » : comment un mot est devenu concept
Le terme bifurquer a connu une carrière médiatique et politique remarquable. Il y a deux ans, un groupe d’étudiants d’AgroParisTech a popularisé le mot via son discours de fin d’année. Depuis, le mot a été repris dans de nombreux livres, émissions radio et débats publics. Dans la presse, le nombre d’articles sur le sujet a triplé, voire quadruplé[1]. Afin de saisir son essor, sa portée politique et sa multiplicité, revenons sur l’histoire – à la fois récente et longue – du terme bifurcation.
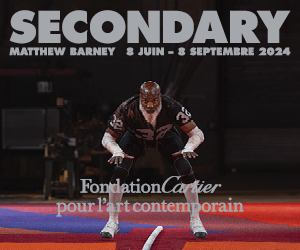
Reprises dans les grandes écoles
On est le 6 avril 2024 aux Folies Bergères à Paris, à la cérémonie de remise de diplôme de l’école d’ingénieur AgroParisTech. Après deux heures et demie de discours, tous positifs et bienveillants, un groupe de onze étudiants monte sur scène pour une prise de parole collective. Le ton change radicalement et les critiques fusent. Le discours fustige la « domination » et « l’exploitation du vivant » et le statut privilégié des ingénieurs et il critique la direction de l’école pour avoir censuré plusieurs événements alternatifs. « Nous aurions honte d’accepter, sans les repenser, nos diplômes, nos métiers et nos rôles dans ce système défaillant ». Le but du discours, explique le groupe, est de « faire perdurer la brèche ouverte par les déserteurs et les déserteuses ».
Piqûre de rappel. Deux années plus tôt, huit élèves « déserteurs » de la même école provoquent un coup d’éclat lors de leur remise de diplôme. À la fin de leur célèbre discours, ils lancent : « Vous pouvez bifurquer maintenant. Commencer une formation de paysan-boulanger […] Vous investir dans un atelier vélo autogéré ou rejoindre un week-end de lutte avec les Soulèvements de la Terre. Ça peut commencer comme ça. À vous de trouver vos manières de bifurquer » (discours du 30 avril 2022).[2]
Le discours d’il y a deux ans a été vu plus d’un million de fois, donné lieu à des centaines d’articles, et impacté considérablement l’enseignement supérieur. Engagé, fataliste, caricatural, inspirant, prometteur, moralisateur, affligeant, condescendant, naïf, lâche, légitime, minoritaire, excessif, injuste, marginal, indécent, responsable, optimiste, tonitruant, franc, fort, … : les mots utilisés pour qualifier le discours ont été nombreux et variés.
Dans un entretien, les déserteurs reviennent sur leur choix du mot bifurquer : « c’est une métaphore qui parle d’elle-même ». Bifurquer, selon leur interprétation, renvoie à un choix professionnel et personnel, celui de ne pas se lancer dans des jobs qualifiés de « destructeurs » qui font « partie des problèmes ». D’où leur appel à s’engager dans des activités et des professions qui font sens individuellement.
Après le discours à AgroParisTech, le terme a été repris dans de nombreux autres discours de fin d’année. Ainsi, à HEC, en juin 2022, une étudiante proclamait « Let’s branch-out together. […] The solutions are there, the alternatives too ». Le terme avait ici une connotation plus positive et moins radicale. En octobre 2022, à l’ESSEC, une étudiante taclait « Indignons-nous, que nous désertions, donc, bifurquions, infiltrions ou combattions ». Si bifurquer était utilisé dans un sens très similaire à celui des déserteurs, l’accent était mis sur l’indignation, avec une référence à Stéphane Hessel, auteur de Indignez-Vous !.
C’est à l’ENSAT, en juin 2022, que la discussion sur le terme fut la plus philosophique et théorique. Le discours, prononcé par un groupe de onze étudiants, donna une triple définition de la bifurcation : faire différemment (prendre une autre voie, changer de monde, quitter des projets) ; critiquer, questionner, et interroger ; créer du lien, produire du commun.
Un mot pluriel
Rien qu’en regardant ces quelques discours, on voit que la signification du mot est loin d’être singulière et stabilisée. Au lieu d’essentialiser le mot, ce que de nombreux commentateurs ont fait, il faut plutôt ouvrir les questionnements : comment le terme bifurquer est-il utilisé, repris, redéfini, référencé ? Qu’est-ce qu’il a fait faire ?
Le discours à AgroParisTech a largement contribué à publiciser et politiser le terme bifurquer. Il l’a mis sur l’agenda politique des jeunes diplômés qui prennent la parole en public. Nombreux sont les étudiants – mais aussi les enseignants-chercheurs – qui se positionnent par rapport au terme, pour le critiquer, l’approuver ou se l’approprier et le redéfinir. Le terme ne s’est donc pas seulement politisé, il s’est en même temps collectivisé et pluralisé. Les mots déserter et bifurquer sont dorénavant des points de passage quasiment obligés du champ lexical de la prise de parole en public de jeunes ou futurs diplômés. Lors des cérémonies de remise de diplômes qui se tiendront les prochaines semaines, on peut donc s’attendre à des discours y faisant référence – et, en coulisses, à des directions d’établissements inquiètes de voir la bifurcation se transformer en mouvement.
Qu’en disent les chercheurs ?
Si le terme bifurquer a connu une publicisation importante depuis avril 2022, il a aussi une histoire plus longue. Quand on fouille dans les publications scientifiques, on voit que le terme est majoritairement utilisé en sciences dures : en mathématiques, en mécanique, en médecine (chirurgie, maladies vasculaires) et en chimie[3]. En médecine, par exemple, le terme est utilisé au début du XIXe siècle pour parler de la bifurcation de vaisseaux sanguins. Puis, vers la fin du XIXe siècle, le terme fait son apparition en mathématiques. C’est notamment suite à un article de Henri Poincaré de 1885, qu’on verra l’émergence de la « théorie des bifurcations »[4]. Au sein des sciences sociales cependant, le terme n’est que peu utilisé : parmi toutes les publications qui se réfèrent à la notion, environ 1% proviennent des sciences sociales.
Dès le milieu des années 1990 le terme commence à être utilisé en sciences sociales au niveau international, par exemple en droit ou en économie. Dans la littérature académique francophone, par contre, le terme apparaît plus tardivement, notamment via les travaux du philosophe Bernard Stiegler et de certains sociologues. Ces derniers proposent de définir la bifurcation comme des « configurations dans lesquelles des évènements contingents, des perturbations légères, peuvent être la source de réorientations importantes dans les trajectoires individuelles ou les processus collectifs »[5].
La bifurcation est souvent synonyme de changement, de réorientation, de tournant. Mais pourquoi les gens bifurquent-ils ? Les facteurs déclencheurs et les causes peuvent être multiples : séparations, naissances, décès, rencontres, lassitude, considérations éthiques ou écologiques, etc. Les personnes qui bifurquent dans leur vie professionnelle vont notamment vouloir redonner du sens à leur travail et retrouver plus d’autonomie et de temps pour soi[6]. Elles vont souvent préférer des activités manuelles, socialement utiles et/ou écologiques, et ne pas réduire leur activité professionnelle à une question purement économique. Dans un même ordre d’idées, l’ouvrage Bifurcations[7] propose la création de « laboratoires territoriaux » pour revaloriser les savoirs locaux et l’artisanat, tout en militant pour une « désintoxication de l’économie industrielle ».
Depuis une dizaine d’années, on parle aussi plus spécifiquement de « bifurcation écologique ». Cette bifurcation peut englober plusieurs domaines : l’efficacité énergétique, l’éco-construction, le démantèlement des centrales nucléaires, les énergies renouvelables, ou encore l’alimentation[8]. Certains utilisent la notion de bifurcation écologique – tout en se démarquant de mots comme « transition » et « décroissance » – pour réfléchir à un monde économique et industriel plus en phase avec l’écologie.[9]
Comprendre la bifurcation estudiantine
Rares sont encore les enquêtes qui s’intéressent à ce qu’on peut appeler la « bifurcation estudiantine ». Selon une étude publiée début 2024, ce type de bifurcation n’est peut-être pas si différent des bifurcations professionnelles – même si la crise sanitaire due au Covid-19 est un élément nouveau[10]. Les discours estudiantins prononcés ces dernières années révèlent une ligne de tension autour du positionnement par rapport aux problèmes écologiques : si certains discours appellent à « s’écarter » (Centrale Nantes), « bifurquer » (AgroParisTech, ENSAT), « boycotter » (ENSAT), « miner les lobbys et entreprises, stopper l’agro-industrie » (ESSEC), d’autres (notamment HEC et Mines Paris) appellent à changer le système de l’« intérieur ».[11]
Tandis que 2022 est une année importante dans la biographie du terme bifurcation (l’année de sa mise en concept publique), un autre moment mérite d’être mentionné. « 2018 c’est une année marqueur »[12] : 2018, c’est l’année durant laquelle on a vu différentes catastrophes climatiques, des marches pour le climat, la démission du ministre de la transition Nicolas Hulot, la création de collectifs dont Pour un réveil écologique, la publication de manifestes et de tribunes, le lancement de Extinction Rebellion par exemple. 2018 représente « l’année zéro »[13] pour ce qu’on appelle la génération climat.
Cette génération remet en question les entreprises non respectueuses de l’environnement, les inégalités et ne désire plus des salaires avantageux à tout prix. La génération climat remet aussi en question les formations au sein des universités et grandes écoles. Chaires universitaires financées par des acteurs économiques peu éthiques, partenariats avec des entreprises, cours trop apolitiques et managériaux ne remettant pas en question le modèle sociétal actuel, absence de cours interdisciplinaires sur les enjeux écologiques et climatiques : les sources de frustration sont nombreuses. Par conséquent, les étudiants vont de plus en plus critiquer ouvertement leurs formations tout comme ils vont s’informer et se former en dehors de leurs cursus, à travers des films, des conférences, des lectures et des rencontres.
Au sein de l’enseignement supérieur, cette frustration soulève une question complexe : « jusqu’où et comment un système d’enseignement et de formation, peut-il, doit-il aller dans l’accompagnement ou l’anticipation des transformations sociétales, qu’elles soient promues ou pas par des politiques publiques ? »[14]. La bifurcation sera-t-elle bientôt un sujet traité dans les universités et les grandes écoles ?
On ne peut pas réduire la bifurcation estudiantine à une simple politisation des étudiants – ceci pour deux raisons. Premièrement, l’argument d’une politisation signifierait, en creux, que les générations précédentes auraient été apolitiques. Or, les mouvements contestataires existent depuis longtemps. Deuxièmement, le terme de politisation ne recouvre qu’imparfaitement toutes les dynamiques observées, car, en même temps, se dessine aussi une écologisation des formations universitaires et une mise en émotion des liens entre les étudiants et l’économie, la technologie et le vivant[15].
L’épaisseur de la bifurcation
Bifurquer, ce n’est pas seulement changer de trajectoire, c’est aussi problématiser la trajectoire, c’est-à-dire penser le temps – la continuité et la discontinuité – comme problème et comme épreuve (et donc pas comme quelque chose de déjà tracé). Bifurquer, c’est laisser derrière soi un monde, tout en imaginant un autre monde en devenir. La bifurcation se joue donc sur un double registre, celui de la critique et celui du care : tout en mettant à distance et en produisant une rupture, la bifurcation définit aussi ce dont on prend soin et ce à quoi on tient.
La bifurcation est une question à la fois politique, sociale, écologique, économique, temporelle, professionnelle, émotionnelle, éthique, technique, psychologique, médiatique et philosophique. Si le terme bifurquer a donné lieu à de nombreuses analyses, il nous faudra encore pousser nos réflexions sur le sujet, afin de pouvoir saisir la bifurcation dans toute cette épaisseur.
