Le peuple à venir (2/2) : pour un « contre-populisme »
Le peuple du front « populaire » n’est pas donné, d’une certaine façon on peut aller jusqu’à dire qu’il n’existe pas, qu’il est « à venir ». C’est sur ce point que je voudrais proposer une hypothèse. Ce n’est évidemment pas le lieu de reprendre la discussion théorique qui a occupé récemment encore toute une partie de la pensée démocratique dite « radicale » à propos de la construction des « hégémonies » politiques, et de la façon dont elles résolvent le problème que pose la pluralité des intérêts « émancipateurs » et des « sujets » historiques hétérogènes, pour la transformer en une force politique plutôt qu’en un facteur de paralysie et de rivalités idéologiques permanentes.
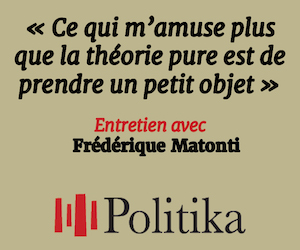
Il est bien clair, cependant, que c’est de ce problème des « contradictions au sein du peuple » qu’il s’agit, et que nous avons affaire à lui de façon urgente, ne serait-ce que parce que (j’y reviendrai plus bas) le Rassemblement national est désormais capable de rallier des partisans dans presque toutes les classes de la société française (ce à quoi précisément le macronisme a complètement échoué) : il semble en avoir trouvé une solution qu’on peut qualifier de populiste. Le Rassemblement National est bel et bien en passe de trouver son « peuple » : qu’en sera-t-il de la gauche ? Du « populiste » au « populaire » il y a à la fois une incompatibilité radicale, et un voisinage, une analogie troublante de la question posée qui doit nous solliciter au premier chef.
Voici donc mon hypothèse de travail sur ce point. Je ne pense pas que nous puissions en rester aux deux façons classiques de penser la formation d’un peuple au sens politique du terme, qui ont alimenté les théories et les stratégies de « l’hégémonie » dans la tradition de la gauche européenne et mondiale, marxiste ou non : celle qui raisonne en termes de groupes sociaux dont il s’agirait de faire la liste et de concilier les intérêts (les ouvriers ou plus généralement les salariés, les travailleurs indépendants et notamment le
