Le droit constitutionnel n’est pas une science exacte
Dans la séquence politique que nous vivons depuis le 9 juin dernier, les constitutionnalistes sont très sollicité(e)s dans les media pour « éclairer le débat public ». On les interroge, en leur qualité d’expert(e)s de la Constitution, sur ce que peut mais aussi ce que doit faire le Président de la République en matière de nomination du Premier Ministre, puis, en cas de cohabitation, quels seront les pouvoirs de l’un et de l’autre au sein de l’exécutif : à qui appartiendra le décret, l’ordonnance, le 49 alinéa 3, le référendum, le pouvoir de commandement de l’armée, etc. Le président pourrait-il être destitué, utiliser l’article 16, réviser la Constitution par référendum, re-dissoudre l’Assemblée… devra-t-il démissionner, et d’ailleurs, pourrait-il se représenter pour un troisième mandat ?
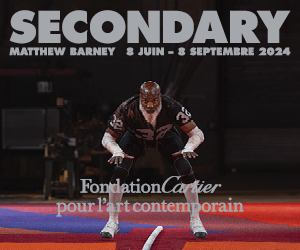
Au-delà de la politique-fiction, on demande aussi aux constitutionnalistes de proposer des pistes pour sortir de la crise institutionnelle : changement du mode de scrutin, du calendrier électoral, suppression de l’élection du Président au suffrage universel direct, rédaction d’une toute nouvelle constitution – et alors s’ouvre une toute nouvelle série de questions : quelles institutions, quel mode de scrutin, quelles procédures de mise en jeu de la responsabilité des élus, quel type de régime ? etc.
Mais la Constitution n’est d’aucune utilité pour désigner le vainqueur des élections législatives ; elle n’est pas non plus d’un grand secours pour identifier la personne que le Président devrait nommer au poste de Premier ministre. Sur le premier point, elle est absolument silencieuse – la seule victoire actée par la loi (et non par la Constitution) est celle de l’élection d’un.e député.e et ce, par circonscription électorale. Sur le second point, l’article 8 alinéa 1er de la Constitution donne au président de la République un « pouvoir propre » dispensé de contreseing, c’est-à-dire un pouvoir pleinement discrétionnaire. Le Président nomme, en droit, absolument qui il veut. A
