Dans les villes moyennes, l’effritement d’une alliance de classe
Les élections européennes et législatives du printemps 2024 ont été marquées par le score historique du RN, qui s’est imposé, à l’occasion de ces scrutins, comme la première force politique du pays. De fortes variations territoriales peuvent toutefois être constatées, en grande partie tributaires d’effets de composition sociale[1] : les espaces ruraux, en moyenne plus populaires, sont caractérisés pour un net survote en faveur du RN quand les électeurs des grandes agglomérations, en moyenne plus favorisés, se tournent davantage vers l’offre politique de gauche, du centre et de la droite dite « républicaine ».
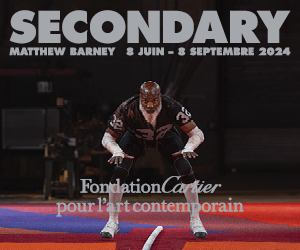
Un tel modèle présente toutefois plusieurs écueils, en particulier celui de simplifier à l’excès la réalité par l’utilisation de catégories spatiales fourre-tout (rural vs urbain), mais aussi celui de laisser dans l’ombre le cas particulier des villes moyennes. En dépit de leur hétérogénéité, une large partie de ces villes sont marquées par un ancrage à gauche depuis la fin des années 1970. Elles se caractérisent pourtant aujourd’hui par une forte montée du RN[2], initiée lors des élections municipales de 2014 et confirmée à l’occasion des derniers scrutins, en particulier au sein des couronnes périurbaines et, plus récemment, des quartiers d’habitat social.
Dans ces espaces comme ailleurs, des facteurs structurels permettent d’expliquer ces transformations : précarisation des classes populaires, montée du sentiment de déclassement, ou encore normalisation du racisme[3]. Pourtant, l’intensité particulière qu’y prend le phénomène s’explique également par le fait qu’une grande partie de ces villes est aujourd’hui le théâtre d’une crise du travail d’encadrement politique des classes populaires historiquement assuré par une petite bourgeoisie culturelle locale[4].
Tandis que cette dernière fait l’objet d’une importante fragilisation, en particulier sur les scènes politique, professionnelle, associative ou encore résidentielle[5], elle incarne de moins en
