Haine en ligne : de l’insulte à la remise en cause de la démocratie
Les références à la haine sont désormais légion dans le discours politique. La stratégie visant à délégitimer un adversaire politique en le qualifiant de haineux ou en l’accusant d’attiser la haine est banalisée. Ces procédés entraînent des dérives qui demandent une analyse politique précise de la haine en démocratie. Vincent Martigny, professeur en science politique, le mentionne clairement lors d’un débat télévisé il y a peu : « Nous-mêmes en tant que commentateurs, on devrait faire attention au terme de haine […] À force de parler de haine entre forces politiques, qui à mon avis n’ont pas de haine les unes vis-à-vis des autres contrairement à ce qu’elles mettent en scène, on donne l’idée que nous-mêmes sommes légitimes à haïr nos politiques[1]. »
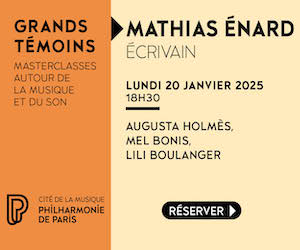
Le phénomène de haine en ligne, sur les réseaux sociaux, joue un rôle d’épouvantail dans le débat public. Il est mentionné pour qualifier une myriade de comportements violents, qui ne relèvent pas nécessairement d’actes de haine. S’impose donc un travail précis pour définir ce que nous entendons par haine, comment la situer et la distinguer de la violence et de l’agressivité. La singularité de la haine se trouve certainement dans sa radicalité, qui s’exprime par une volonté de destruction ou de mise à distance d’un objet jugé menaçant pour notre existence même. Le réceptacle, qui est aussi victime, de cette haine, peut être un individu, un groupe social ou une personne morale comme l’État. Dans l’espace numérique, les cibles potentielles sont plus nombreuses, et les occasions et possibilités d’exprimer de la haine en ligne sont facilitées par la structure même de ces nouveaux espaces.
Un des éléments explicatifs de cette prolifération de haine sont les conditions de construction d’une relation de confiance elles aussi bouleversées par la numérisation de nos échanges et de la vie politique. De fait, la dimension physique, et non numérique, de la relation, est primordiale à l’établissement du lien de confiance. L
