Experts privés pour l’action publique : quelle responsabilité ?
Il y a plus de quarante ans, le politologue américain Michael Lipsky affirma que les véritables « faiseurs des politiques publiques » n’étaient pas les politiciens ou les fonctionnaires mais bien les acteurs de première ligne en contact direct avec les bénéficiaires de l’action publique[1]. Depuis lors, cette théorie de la « bureaucratie de rue » s’est développée et a été appliquée à travers le monde pour montrer sa portée heuristique dans l’étude des défis de la mise en œuvre de l’action publique.
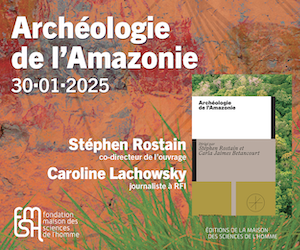
Mais, dans un monde où les États et les gouvernements sont de plus en plus imprégnés des personnes et des idées du secteur privé, à l’image du recours sans cesse croissant aux cabinets de consultants privés, y compris pour gérer des crises, et où les décideurs et politiciens sont imbriqués dans des réseaux d’interconnaissances à la porosité grandissante et d’organisations interdépendantes (l’Organocène[2]), on peut se demander si les « faiseurs des politiques publiques » ne sont pas devenus plutôt ces consultants et autres experts appelés à la rescousse pour proposer des solutions (souvent les mêmes) à des problèmes devenus urgents à résoudre selon ces personnes élues ou nommées exerçant un pouvoir politique.
Or, si la responsabilité sociale des États et des entreprises privées est souvent convoquée lors de catastrophes sanitaires, environnementales ou commerciales (avec souvent peu d’impact, comme on peut le voir par exemple pour les entreprises privées minières en Afrique), il nous semble que celle des personnes (fonctionnaires, experts et consultants) conseillant les politiques l’est beaucoup moins. Cela confirme les défis des propositions actuelles, certains pensant utile de créer un poste unique de conseiller scientifique, directement relié au Prince ou à la Princesse, plutôt qu’un collectif de conseillers disposant de réseaux et surtout de connaissances interdisciplinaires utiles face à la complexité des solutions à trouver dans un monde faisant face à des
