Dépoussiérer les réserves de nos musées
À l’automne 2024 s’est tenue à Paris, à l’université Sorbonne Nouvelle, la conférence internationale « Les réserves de musée : état des lieux et nouveaux défis »[1]. L’événement a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues du monde entier pour discuter rationalisation des espaces, logistique et rangement, nouvelles architectures, enjeux écologiques, rapport au territoire, parmi de nombreuses autres thématiques.
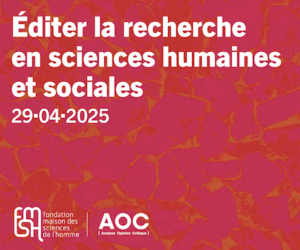
La portée de l’événement peut sembler, de l’extérieur, un peu limitée – ou du moins restreinte : il s’agit, après tout, d’une rencontre spécialisée comme on en organise fréquemment, dans le monde muséal et dans de nombreux autres univers professionnels. Le Conseil international des musées (International Council of Museums, ICOM), partenaire de l’événement, compte d’ailleurs une grosse trentaine de comités nationaux et internationaux (sur l’éducation et l’action culturelles, la sécurité dans les musées, le développement des collections…) qui se réunissent régulièrement.
Mais, dans ce cas précis, la tenue de cette rencontre n’avait rien d’ordinaire. En dépit de leur rôle central dans les musées – car c’est là que sont conservées les collections quand elles ne sont pas exposées (entre 80 % et 95 % en moyenne) –, les réserves ne bénéficient, jusqu’à présent, d’aucun comité professionnel dédié. Comme l’a rappelé dans son allocution de clôture Gaël de Guichen, grande figure du monde des réserves[2], le précédent de cette conférence remonte à 1977.
À l’initiative du Français Paul Perrot, secrétaire général des musées de la Smithsonian Institution à Washington, une rencontre avait été organisée pour faire un état des réserves des musées dans le monde, et les conclusions n’étaient pas positives : lieux de stockage souvent inadaptés, encombrement des espaces, conditions climatiques (température, hygrométrie) instables, mauvais référencement des objets les rendant difficilement accessibles, absence de formation des équipes étaient autant de problèmes pa
