Faire entrer les femmes dans une institution masculine – 1945, la seconde universalité du suffrage (1/2)
«Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint Pierre, éloigné d’une lieue de notre village. Le matin de l’élection, tous les électeurs, c’est-à-dire toute la population mâle au-dessus de vingt ans, se réunirent devant l’église. Tous ces hommes se mirent à la file deux par deux suivant l’ordre alphabétique ; je voulus marcher au rang que m’assignait mon nom ; car je savais que dans [les] pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple et ne pas s’y mettre soi-même.
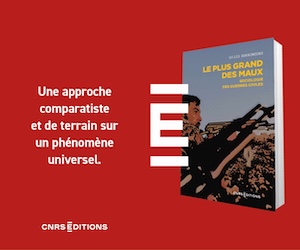
Au bout de la longue file venaient sur des chevaux de bât ou dans des charrettes, des infirmes ou des malades qui avaient voulu nous suivre. Nous ne laissions derrière nous que les enfants et les femmes ; nous étions en tout cent soixante-dix ». C’était le 23 avril 1848, au départ du village de Tocqueville pour les premières élections au « vote universel », comme il était dit alors, d’après la relation classique d’Alexis de Tocqueville dans ses Souvenirs[1].
Il n’y a pas de Tocqueville pour raconter la journée du 29 avril 1945*.
97 ans et 6 jours après les hommes, les femmes françaises peuvent pour la première fois voter. Henri Calet qui commence à devenir un écrivain connu, brosse pourtant un croquis ironiquement masculin de la première « intrusion » des femmes dans le concert démocratique : « Ça a été un dimanche des plus intéressants. Dommage que la température n’ait pas été pour nous. Neuf ans déjà que l’on n’avait pas voté. Mais, à peine entré dans le préau, on a été repris. Rien n’a changé, dirait-on, depuis 36, et même depuis le temps plus lointain où nous fréquentions ces écoles, vêtus de petits tabliers de satinette noire. […] Là aussi, il a fallu faire la queue. Et les électrices matinales tenaient presque toutes un filet à la main, ce qui faisait penser que l’on vendait quelque chose dans le fond de la salle. Mais il ne s’agissait nullement de cela. […] Atmosphère gaie, des femmes, des enfants, du muguet, des sourires, des drapeaux… Dommage vrai
