Quand le règlement d’un demi-siècle de conflit kurde se joue en quelques mois (1/2)
Dans cet article, je me propose d’établir un bilan de l’appel d’Abdulah Öcalan au désarmement et à la dissolution du PKK, organisation qu’il avait cofondée en 1978, et qui mène une guérilla contre l’armée et l’État turc depuis plus de 40 ans. Les développements en cours à la suite de cet appel semblent marquer la fin de la lutte armée pour le mouvement kurde en Turquie.
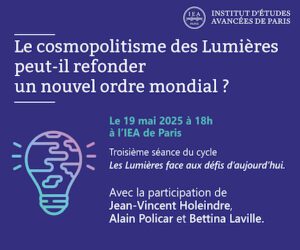
Afin d’en sonder les chances de succès et d’en saisir les conséquences, il faut tenir compte d’une série de données fondamentales. Certaines concernent la très mouvementée actualité turque et moyen-orientale, d’autres se trouvent dans l’histoire plus ou moins récente du conflit turco-kurde. Je propose ici d’examiner le contenu de cet appel au prisme de plusieurs dimensions. : le tempo spécifique de sa genèse, ce qu‘il révèle de l’évolution du mouvement kurde en Turquie depuis l’échec du précédent processus de paix en 2015, enfin, sa réception, ce qu’il ne dit pas et les perspectives qu’il ouvre. En effet, comme nous le verrons, du fait des dynamiques parallèles parfois paradoxales de la guerre et des pourparlers de paix, qui revêtent systématiquement en Turquie un caractère opaque, un tel appel engendre un effort herméneutique conséquent de ceux à qui il s’adresse, dans le contexte très contraint de la vie publique et politique locale, régionale et internationale.
Pour comprendre le sens et la portée de ce texte, nous nous efforcerons de le replacer dans son contexte historique et géopolitique certes, mais aussi émotionnel en adoptant une perspective anthropologique plus large.
Comment expliquer le timing de cet appel ? Comment Öcalan, placé en isolement absolu depuis plus de trois ans, a-t-il pu finalement faire entendre sa voix ? Que dit-il et en quels termes ? Quelles similitudes et quelles différences entre cet appel au désarmement et les précédents (notamment celui de 2015) ? Comment l’interpréter, quels en sont les enjeux explicites et implicites ? Quelles dynamiques nationales, régio
