Pourquoi la guerre ? (1/2)
Les nécessités de l’actualité internationale et l’aimable invitation du festival pacifiste Cahors Mundi, les 27-29 juin, m’ont amené, ces dernières semaines, à réfléchir à deux vieux objets des sciences sociales du politique : ceux de la guerre et de la paix, prétextes de tant d’ouvrages ou d’articles et de sujets d’examens universitaires – questions bateaux, pour ne pas dire galères.
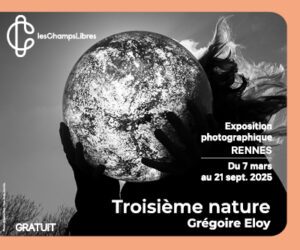
Car, d’emblée, un malaise saisit la plume (ou le clavier). Que dire de décent, est-il même imaginable de le faire, à propos de telles expériences historiques et politiques de la mort, de la souffrance, de la destruction, du deuil, quels que soient le courage, l’abnégation, l’enthousiasme, la solidarité ou l’idéalisme dont elles sont le creuset ? Que pouvoir dire du 7 octobre 2023, de Gaza, de l’Ukraine, ou d’autres conflits tout aussi cruels bien que moins couverts par les médias, tels que ceux du Soudan ou de la République démocratique du Congo ? Que pouvoir en dire, qui ne soit déplacé ou creux ? Il y a, dans la guerre et dans la paix, comme dans la foi ou dans le plaisir sexuel et beaucoup d’autres expériences de la vie, une irréductibilité impénétrable dont les sciences sociales doivent prendre acte alors même que celle-ci fait partie du problème exigeant connaissance, explication, éclaircissement, interprétation.
Aucune des deux notions de la guerre et de la paix ne va d’ailleurs de soi, nonobstant le sens commun. D’abord parce qu’il est des situations d’entre-guerres, pour reprendre l’heureuse formule de Marielle Debos à propos du Tchad[1]. Ces dernières tendent même à se multiplier, y compris en Europe. Le Kosovo et aussi, sans doute, la Bosnie malgré les accords de Dayton (1996), ou le Donbass (de 2014 à 2022), peut-être l’Ulster en offrent des cas de figure.
Ensuite, parce que la guerre et la paix font toujours l’objet d’une énonciation plurielle de la part de leurs protagonistes, selon leur âge, leur sexe, leur statut social, leurs origines régionales, nationales ou
