À la fin des marchés parisiens
Si vous le voulez bien, je vous invite à me suivre au marché… ou plutôt à la fin des marchés de plein vent. Le marché se défait mais ne s’éteint pas. Il change de mains et d’acteurs : un épilogue est à l’œuvre. D’autres voix deviennent perceptibles, des gestes rapides s’ébauchent, des silhouettes furtives se dessinent. Celles de femmes, parfois clientes un peu plus tôt. Elles investissent le pavé encombré, se penchent, fouillent vite et bien, récupèrent les fruits oubliés, les légumes fatigués, les herbes fanées. Ce qui a été méprisé par les échanges marchands retrouve soudain une valeur dans leurs sacs.
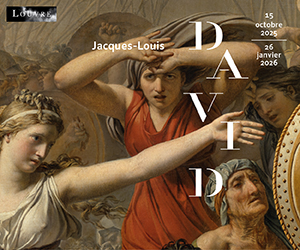
À la marge des ventes officielles, une autre économie prend place, discrète mais persistante, et qui perdure au cœur des quartiers populaires de Paris, au-delà des tendances et des chapelles. On appelle ces pratiques, qui peuvent sembler désuètes ou hors du temps, le glanage alimentaire. Elles participent à la fois d’une gestion informelle des rebuts alimentaires et de pratiques populaires de subsistance[1].
Dans l’imaginaire collectif, le glanage renvoie aux moissons des campagnes, à ces femmes penchées dans les champs, immortalisées par Millet. Pourtant, cette manière d’agir traverse l’Histoire bien au-delà de la ruralité. Mentionnée dans la Bible, codifiée par un édit royal de 1554 en France – qui autorise encore aujourd’hui la récupération des restes d’une récolte – cette pratique millénaire a été réinventée dans les marchés parisiens des quartiers populaires. Ici, il ne s’agit plus de grappiller quelques épis après la faucille, mais de sauver de la destruction les restes alimentaires. Les rebuts du marché deviennent alors une ressource, dans une société qui se rêve durable mais où, chaque soir, des tonnes de denrées encore consommables finissent à la benne.
Ma recherche se concentre sur un glanage individuel et autogéré : une activité informelle, discrète, encore peu étudiée par les sciences sociales[2]. Cette enquête s’inscrit dans un champ plus larg
